Cunéiforme
L'écriture cunéiforme est un système d'écriture mis au point en Basse Mésopotamie autour de 3200 av. J.-C., qui s'est par la suite répandu dans tout le Proche-Orient ancien, avant de disparaître dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Au départ pictographique et linéaire, la graphie de cette écriture a progressivement évolué vers des signes constitués de traits terminés en forme de « coins » ou « clous » (latin cuneus), auxquels elle doit son nom, « cunéiforme », qui lui a été donné aux XVIIIe et XIXe siècles. Cette écriture se pratique par incision à l'aide d'un calame sur des tablettes d'argile, ou sur une grande variété d'autres supports.
| Cunéiforme | |

| |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type | Logogrammes et phonogrammes |
| Langue(s) | Sumérien, akkadien (babylonien et assyrien), élamite, éblaïte, hittite, hourrite, urartéen |
| Historique | |
| Époque | Du IVe millénaire av. J.-C. au IIIe siècle (?) |
| Système(s) dérivé(s) | Alphabet ougaritique, Vieux-persan cunéiforme |
| Codage | |
| Unicode | U+12000 to U+1236E (cunéiforme suméro-akkadien) U+12400 to U+12473 (Nombres) |
| ISO 15924 | Xsux (cunéiforme suméro-akkadien)
|
Les conditions d'élaboration de cette forme d'écriture, qui est la plus vieille connue avec les hiéroglyphes égyptiens, sont encore obscures. Quoi qu'il en soit, elle dispose vite de traits caractéristiques qu'elle ne perd jamais au cours de son histoire. Le système cunéiforme est constitué de plusieurs centaines de signes pouvant avoir plusieurs valeurs. Ils sont en général des signes phonétiques (phonogrammes), transcrivant uniquement un son, plus précisément une syllabe. Mais une autre catégorie importante de signes sont les logogrammes souvent désignés comme des idéogrammes, qui représentent avant tout une chose et ne renvoient que secondairement à un son. D'autres types de signes complémentaires existent (signes numériques, compléments phonétiques et déterminatifs).
À partir de son foyer sud-mésopotamien où vivait le peuple qui en est probablement le créateur, les Sumériens, le système d'écriture cunéiforme est adapté dans d'autres langues, à commencer par l'akkadien parlé en Mésopotamie, puis des langues d'autres peuples du Proche-Orient ancien (élamite, hittite, hourrite entre autres), et il est le système dominant dans ces régions pendant tout le IIe millénaire av. J.-C. La graphie cunéiforme est parfois adaptée à des systèmes d'écriture obéissant à des principes différents de l'original : l'alphabet dans le Levant de la seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C., et un syllabaire dans la Perse de la seconde moitié du Ier millénaire av. J.-C. L'écriture cunéiforme décline lentement par la suite, avant de se replier sur son foyer de Mésopotamie méridionale où elle disparaît aux débuts de l'ère chrétienne.
Le cunéiforme a été un élément marquant des cultures du Proche-Orient ancien qui ont développé un rapport à l'écrit et des littératures à partir de ce système. Sa redécouverte à l'époque moderne, son déchiffrement au XIXe siècle et la traduction des textes qu'il notait ont donné naissance aux disciplines spécialisées dans l'étude des civilisations du Proche-Orient ancien, à commencer par l'assyriologie, et ainsi permis de mettre en lumière les accomplissements de ces civilisations jusqu'alors oubliées. L'étude des types de textes et des pratiques d'écriture a également mis en évidence l'existence d'une « culture cunéiforme » commune aux peuples ayant utilisé cette écriture, fortement marquée par l'empreinte mésopotamienne.
La nature des sources : tablettes d'argile et autres supports
La Mésopotamie étant une région pauvre en matériaux, ses habitants n'avaient pas un vaste choix d'instruments utilisables pour écrire. C'est l'argile et le roseau qui devinrent les matériaux privilégiés de l'écriture, car ils sont abondants dans le sud où les locaux avaient l'habitude de les utiliser énormément, surtout pour des constructions (briques en argile, maisons en roseau) et des contenants (poterie, vannerie)[1].
À partir d'une motte d'argile, on confectionnait une tablette (sumérien dug, akkadien ṭuppu(m)[note 1]). L'argile était généralement aisément accessible, peu coûteuse, mais il fallait qu'elle soit d'une bonne qualité et dégagée de ses impuretés. La taille des tablettes devait être pensée en fonction de la longueur du texte que l'on voulait écrire. Il s'en trouve donc de taille et de forme variées, le plus souvent rectangulaire. Les plus petites mesurent quelques centimètres, les plus grandes ont des côtés d'environ 40 centimètres de longueur. On écrivait les signes dessus, avant de les faire sécher au soleil pour les durcir ou, parfois, de les cuire pour obtenir une meilleure solidité. Les tablettes déjà utilisées, mais qui n'avaient plus à être conservées étaient recyclées. On les remodelait en effaçant les inscriptions antérieures puis on les réutilisait (ce qui n'était pas possible si elles étaient cuites). De ce fait, un site livre généralement des archives datant de quelques années avant la destruction ou l'abandon, mais pas plus, puisque les tablettes plus anciennes ont été réutilisées. Souvent, la cuisson des tablettes conservées est due au fait que le site a été ravagé par un incendie accidentel ou provoqué. L'argile pouvait également servir à confectionner des supports d'écriture autres que des tablettes, de formes diverses : certaines inscriptions étaient faites sur des cônes, des clous, des cylindres, des prismes en argile, des briques (qui pouvaient être glaçurées aux périodes tardives) ou encore des maquettes de foie servant pour la divination[2].

L'instrument utilisé pour écrire sur l'argile est le calame (sumérien gi-dub-ba, akkadien qan ṭuppi(m), littéralement « roseau de/pour tablette »), un morceau de roseau (parfois d'os, d'ivoire, de bois ou de métal) surtout pointu ou arrondi au départ, puis avec une forme triangulaire plate ou en biseau par la suite[3]. L'incision de cet instrument dans l'argile fraîche rend difficile l'opération consistant à tracer des lignes et des courbes et incitant à inscrire des segments courts, ce qui a donné aux écritures mésopotamiennes leur aspect cunéiforme : on plante d'abord la pointe, ce qui donne la forme d’une tête de clou vue de profil, puis on bascule le calame horizontalement ou verticalement pour imprimer le corps du clou (le trait) après (certains signes étant composés de clous simples). En sumérien, on parle de « triangle » (santag), ou encore de « coin » (kak ou gag, tikip santakki(m) en akkadien)[4]. L'incision de signes sur un support malléable donne finalement une écriture non pas plate comme celle qui allie l'encre et le papier, mais en relief, et les signes doivent être lus avec un éclairage qui permette de repérer toutes les incisions, sans quoi ils peuvent être mal interprétés[5].
Les tablettes d'argile pouvaient porter d'autres inscriptions que des signes cunéiformes. Pour authentifier les actes juridiques, il était courant d'y appliquer l'empreinte de sceaux ou de sceaux-cylindres, comportant parfois des inscriptions en cunéiforme indiquant l'identité de leur propriétaire. L'authentification pouvait aussi passer par la marque d'un ongle ou de la frange d'un vêtement dans l'argile. Les tablettes pouvaient aussi être enfermées dans des enveloppes en argile comportant une copie du texte de la tablette. Cette pratique concernait les contrats, permettant de vérifier que le texte de la copie n'avait pas été altéré, en protégeant l'original. Au-delà de la sphère juridique, les tablettes de textes plus techniques pouvaient porter des plans, cartes, représentations du ciel, d'autres fois des trous pour les suspendre (dans le cas de textes littéraires), des traces de peinture ou d'encre, notamment pour écrire dans une autre langue (araméen)[6].
D'autres matériaux pouvaient servir de supports pour des inscriptions cunéiformes. Certains textes étaient rédigés sur des surfaces en cire supportées par des tablettes en bois ou en ivoire ; seul ce dernier matériau a résisté aux assauts du temps ; on a trouvé des tablettes d'ivoire notamment à Kalkhu où elles pouvaient être reliées pour former une sorte de polyptyque, et elles sont mentionnées en pays hittite (où elles ont peut-être été écrites en hiéroglyphes hittites). Les inscriptions sur pierres sont mieux connues, que ce soient des objets votifs (sculptures surtout), des tablettes et briques de fondation, des stèles ou des rochers naturels. Des objets en métal étaient également gravés, là encore surtout des objets votifs (statues, vases), mais aussi des tablettes. Les supports en pierre ou en métal avaient pour but de solenniser le message et d'assurer qu'il persiste à travers le temps[7]. Il fallait dans ces deux cas travailler la matière avec une pointe en fer. Il s'agit donc de gravures, réalisées par des artisans (notamment les lapicides, spécialistes de la gravure[8]) dont on ne sait pas s'ils comprenaient le cunéiforme. Ils recopiaient le texte à partir d'un brouillon rédigé par un scribe et qui avait sans doute été contrôlé par le commanditaire, le roi en particulier[9].
- Exemples de supports de l'écriture cunéiforme.
 Tablettes d'argile de taille, format et mise en page variés, Ägyptisches Museum(de) de Leipzig.
Tablettes d'argile de taille, format et mise en page variés, Ägyptisches Museum(de) de Leipzig. Tablette cunéiforme et l'enveloppe qui la contenait. Kish, période paléo-babylonienne (v. 1900-1600 av. J.-C.). Ashmolean Museum.
Tablette cunéiforme et l'enveloppe qui la contenait. Kish, période paléo-babylonienne (v. 1900-1600 av. J.-C.). Ashmolean Museum. Acte de vente d'un esclave et d'une maison à Shuruppak, Dynasties archaïques III A, v. 2500 av. J.-C. Musée du Louvre.
Acte de vente d'un esclave et d'une maison à Shuruppak, Dynasties archaïques III A, v. 2500 av. J.-C. Musée du Louvre. Clou de fondation portant une inscription commémorative du roi Gudea de Lagash, (v. 2120 av. J.-C.). Musée des beaux-arts de Lyon.
Clou de fondation portant une inscription commémorative du roi Gudea de Lagash, (v. 2120 av. J.-C.). Musée des beaux-arts de Lyon. Empreinte du sceau-cylindre avec inscription, appartenant à Ibni-sharrum, scribe du roi Shar-kali-sharri (v. 2217-2193 av. J.-C.), période d'Akkad. Musée du Louvre.
Empreinte du sceau-cylindre avec inscription, appartenant à Ibni-sharrum, scribe du roi Shar-kali-sharri (v. 2217-2193 av. J.-C.), période d'Akkad. Musée du Louvre. Tablette en basalte rapportant la vente de champs, provenance inconnue (Isin ?), v. 2600-2500 av. J.-C. Musée de l'Oriental Institute de Chicago.
Tablette en basalte rapportant la vente de champs, provenance inconnue (Isin ?), v. 2600-2500 av. J.-C. Musée de l'Oriental Institute de Chicago.
 Plaque votive en or célébrant la construction d'une estrade pour le dieu Shara par la reine Bara-irnun d'Umma, v. 2370 av. J.-C. Musée du Louvre.
Plaque votive en or célébrant la construction d'une estrade pour le dieu Shara par la reine Bara-irnun d'Umma, v. 2370 av. J.-C. Musée du Louvre. Deux jarres en albâtre portant le nom du roi assyrien Sargon II (722-705 av. J.-C.), palais nord-ouest de Nimroud. British Museum.
Deux jarres en albâtre portant le nom du roi assyrien Sargon II (722-705 av. J.-C.), palais nord-ouest de Nimroud. British Museum.
 Perle en agate vouée au dieu-lune Nanna/Sîn par le roi Ibbi-Sîn de la troisième dynastie d'Ur (v. 2010 av. J.-C.). Musée du Louvre.
Perle en agate vouée au dieu-lune Nanna/Sîn par le roi Ibbi-Sîn de la troisième dynastie d'Ur (v. 2010 av. J.-C.). Musée du Louvre.
Le déchiffrement du cunéiforme
Après sa disparition, le système d'écriture cunéiforme fut oublié ; il n'avait jamais suscité le même intérêt que les hiéroglyphes égyptiens chez les peuples de l'Antiquité européenne (Grecs et Romains). Sa redécouverte fut progressive. Elle passa d'abord par les voyages d'Européens sur des sites de Mésopotamie et de Perse d'où ils ramenèrent quelques objets inscrits de signes que l'on nomma finalement cunéiformes. Au début du XIXe siècle, l'essor de l'intérêt scientifique pour les civilisations antiques orientales conduisit aux premières explorations poussées de sites du Proche-Orient ancien (d'abord en Perse et en Assyrie), et le déchiffrement de leurs textes devint une tâche majeure pour comprendre ces civilisations, les savants s'intéressant à ceux-ci ayant sous les yeux les exemples des succès récents du déchiffrement de l'alphabet palmyrénien par Jean-Jacques Barthélemy et des hiéroglyphes égyptiens par Jean-François Champollion. Il leur fallut une cinquantaine d'années pour maîtriser les principes de l'écriture cunéiforme, et plusieurs décennies supplémentaires pour redécouvrir les langues qui avaient été notées par ces écritures.
La redécouverte des inscriptions cunéiformes à l'époque moderne

À l'époque moderne, plusieurs voyageurs occidentaux s'aventurent au Moyen-Orient et notamment en Mésopotamie, où ils découvrent des exemplaires de l'écriture cunéiforme, qui par son caractère mystérieux peine à être perçue comme une forme d'écriture. Pietro Della Valle, originaire de Rome, est le premier à recopier des inscriptions cunéiformes sur le site de Persépolis en 1621. En 1771, l'Allemand Carsten Niebuhr rapporte également des copies d'inscriptions cunéiformes de son voyage en Mésopotamie et en Perse, les premières copies fidèles de textes cunéiformes mises à la disposition du public européen. En 1784, le botaniste français André Michaux découvre à proximité des ruines de Ctésiphon un kudurru (stèle de donation) babylonien, premier document épigraphique en écriture cunéiforme à être introduit en Europe. Il le dépose en 1800 au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France où il est connu depuis sous le surnom de « caillou Michaux »[10]. Au début du XIXe siècle le nombre de textes cunéiformes connus croît encore : de nouveaux objets inscrits qui parviennent en Europe, comme une longue inscription de Nabuchodonosor II rapportée à Londres par la Compagnie des Indes orientales (East India House Inscription), à partir de laquelle on établit un premier syllabaire du cunéiforme babylonien, et les inscriptions de la région du lac de Van sont copiées en 1828 par Friedrich Eduard Schulz et publiées en 1840, dont une longue inscription royale d'un roi d'Urartu, bilingue en assyrien et urartéen). Ces inscriptions suscitent l'intérêt de certains savants qui commencent à chercher à percer leurs mystères[11].
Premiers jalons pour un déchiffrement
Pour les méthodes de déchiffrement des écritures antiques, celles-ci ont bénéficié des avancées cruciales qui ont eu lieu auparavant avec le déchiffrement de l'alphabet palmyrénien et de l'alphabet phénicien par Jean-Jacques Barthélemy dans les années 1750, puis avec celui des hiéroglyphes égyptiens (système présentant des caractéristiques similaires à celles du cunéiforme) par Jean-François Champollion, qui a lieu en 1822. Les bases de la méthodologie du déchiffrement alors définie consistent à : poser une hypothèse sur l'identité de la langue du texte que l'on veut traduire et chercher les langues apparentées pour faciliter la compréhension ; chercher des textes bilingues ayant un même contenu mais dans deux langues différentes, dont une est connue, et s'appuyer en priorité sur eux ; comptabiliser le nombre de signe pour savoir si l'on est en présence d'un système alphabétique, syllabique ou logosyllabique ; chercher à identifier en priorité des mots qui se répètent souvent, notamment des noms propres, et s'en servir de base pour traduire les autres mots[12].
Mais au début du XIXe siècle aucune inscription connue n'associe une écriture antique comprise à une écriture cunéiforme, ce qui implique que les premières avancées soient faites en déchiffrant un texte sans savoir au préalable son sens. Les premiers éléments pour la traduction du cunéiforme sont avancés en 1802 par un philologue allemand, Georg Friedrich Grotefend. Utilisant l'intuition de certains de ses prédécesseurs qui avaient émis l'hypothèse que plusieurs des inscriptions venues de Perse dataient de la période des rois Achéménides, il analysa quelques inscriptions de Persépolis en présumant qu'il s'agissait d'inscriptions royales, puis isola le terme le plus courant, qu'il identifia comme signifiant « roi » ; il identifia également les groupes de signes voisins du précédent comme étant le nom des rois, en se basant sur les noms connus par les historiens grecs antiques (Cyrus II, Cambyse, Darius Ier, Xerxès Ier). Il put ainsi tenter d'attribuer des valeurs phonétiques à certains signes. Mais il fallait identifier la langue des textes : Grotefend voulait y voir du vieux-perse, ce qui était juste, mais il voulut le lire en utilisant la grammaire de l'Avesta, connue en Europe depuis son édition entre 1768 et 1771 par Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron. Or la langue avestique est différente bien que proche du vieux-perse des inscriptions achéménides. Au total, Grotefend identifia une dizaine de signes, avancée considérable, mais il ne put poursuivre plus loin, car il s'enferma dans une série d'erreurs qui l'empêchèrent d'améliorer ses premiers résultats. Ses réussites dans le déchiffrement du cunéiforme ne furent d'ailleurs pas bien reçues à la Société des sciences de Göttingen, qui ne sut pas reconnaître ses mérites[13]. Elles trouvèrent néanmoins une première reconnaissance quand Champollion traduisit en 1823 le nom de Xerxès écrit en hiéroglyphes sur un vase de la collection du comte de Caylus, qui comprend également une inscription en perse cunéiforme où on pouvait trouver les signes qui selon Grotefend transcrivaient le nom de ce roi, comme le mit en évidence Antoine-Jean Saint-Martin. Cela incita d'autres à poursuivre sur la voie tracée par Grotefend[14].

Les travaux de Grotefend servirent finalement à d'autres philologues mieux armés dans le domaine des langues indo-iraniennes anciennes, notamment Christian Lassen qui identifia des termes géographiques sur les représentations des peuples tributaires à Persépolis. Ce furent les copies d'inscriptions trilingues vieux-perse, akkadien babylonien et élamite de l'empire achéménide qui permirent aux traducteurs de progresser dans le déchiffrement des différentes écritures, comme celle par l'anglais Henry Creswicke Rawlinson au mont Elwand en 1835 (il ne put alors copier que la version vieux-perse de celle, plus célèbre de nos jours, de Behistun, puis revint pour copier les autres versions une dizaine d'années plus tard[15]) et d'autres provenant de Naqsh-e Rostam et Persépolis copiées par le danois Nils Ludwig Westergaard[16]. Bien qu'on ne connût alors aucune des trois langues de ces textes, cela allait permettre de comparer différents systèmes d'écriture cunéiforme et différentes langues. Le système le plus simple à déchiffrer était le vieux-perse, car il est composé d'une quarantaine de signes surtout syllabiques, à l'inverse des deux autres composés de centaines de signes, et que la connaissance d'une langue voisine, l'avestique, avait connu des progrès importants durant les années précédentes. La copie de plusieurs inscriptions des sites perses permit de disposer d'un corpus de signes conséquent. Finalement, les travaux conjugués de plusieurs chercheurs (Rawlinson, Lassen, Edward Hincks, Jules Oppert et d'autres) permirent d'identifier la totalité des signes de l'« alphabet » vieux-perse en 1847[17].
Une fois le vieux-perse cunéiforme déchiffré, on allait pouvoir tenter le déchiffrement des deux autres écritures des inscriptions trilingues achéménides, à l'image de ce qu'avait fait Jean-François Champollion avec la Pierre de Rosette une vingtaine d'années auparavant. L'akkadien allait être la deuxième langue déchiffrée, de nombreuses inscriptions dans cette langue étant redécouvertes à partir des années 1840 quand les sites assyriens commencent à être explorés, notamment Khorsabad. En utilisant la version perse des inscriptions trilingues, Hincks (qui avait déjà une solide expérience du système hiéroglyphique, qui suit des principes similaires à ceux du cunéiforme) identifia plusieurs signes et confirma qu'il s'agissait d'un système à dominante syllabique, avant de découvrir la nature idéographique d'autres signes, ainsi que leur polysémie. Lorsqu'il traduisit l'idéogramme signifiant « argent » et lui trouva la valeur phonétique kaspu(m), il put rapprocher ce terme de l'hébreu kasp- et ainsi établir qu'il s'agissait d'une langue sémitique après avoir trouvé d'autres parallèles identiques. Rawlinson établit de son côté le caractère polyphonique des signes et identifia aussi des homophones, ce qui confirma la complexité de ce système d'écriture[18] - [16].
Le cunéiforme déchiffré

En 1857, les avancées dans le déchiffrement du cunéiforme font penser que les mystères de ce système d'écriture sont révélés, alors que les premiers chantiers de fouilles dans l'ancienne Assyrie ont livré une grande quantité de tablettes cunéiformes. La Royal Asiatic Society de Londres décide alors de tester la réalité du déchiffrement de ce qui est considéré à l'époque comme de l'assyrien cunéiforme. William Henry Fox Talbot lui fournit une copie, avec la traduction qu'il en a faite, d'une inscription du roi Teglath-Phalasar Ier qui venait juste d'être exhumée sur le site archéologique de Qala'at Shergat, l'ancienne Assur, et lui demande d'envoyer la copie de l'inscription aux trois des principaux acteurs du déchiffrement du cunéiforme, Henry Rawlinson, Edward Hincks et Jules Oppert. Ils devaient travailler sans communiquer avec qui que ce soit (mais il semble avéré que certains aient eu accès à des traductions d'autres), et devaient faire parvenir leur traduction sous pli cacheté à la société. Quand les traductions furent reçues, une commission spéciale les analysa, et remarqua qu'elles coïncidaient : les principes du système cunéiforme mêlant phonogrammes et idéogrammes étaient compris, et la connaissance de la langue qu'on appellerait plus tard akkadien était suffisante pour comprendre les textes que l'on exhumait de plus en plus chaque année sur les terres de l'ancienne Mésopotamie. Cet événement est considéré comme l'acte fondateur de l'assyriologie en tant que discipline. Elle prenait le nom du peuple dont on déchiffrait alors les textes, puisque ni Babylone ni les cités de Sumer n'avaient encore été mises au jour[19].
 Edward Hincks (1792-1866).
Edward Hincks (1792-1866). Henry Creswicke Rawlinson (1810-1895).
Henry Creswicke Rawlinson (1810-1895).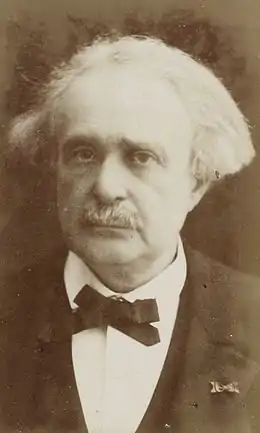 Jules Oppert (1825-1905).
Jules Oppert (1825-1905).
La suite de l'aventure des déchiffrements en assyriologie concerne essentiellement la découverte de nouvelles langues, qui utilisaient le cunéiforme selon le système identifié pour l'akkadien, nom que commençait à porter dans les ouvrages érudits la langue sémitique des peuples de l'ancienne Mésopotamie à partir de la fin du XIXe siècle. Au même moment, les spécialistes établissaient, après de longues querelles, l'identité des probables inventeurs du système d'écriture mésopotamien d'où dérive le cunéiforme, les Sumériens[20]. C'est l'ouvrage Les Inscriptions de Sumer et d'Accad de François Thureau-Dangin publié en 1905 qui consacre l'emploi des termes Sumer et Akkad. D'autres langues sont ensuite identifiées dans un système cunéiforme similaire, en plus de celle d'Élam repérée en même temps que l'akkadien grâce à l'inscription de Behistun, mais encore mal connue au début du XXe siècle. En 1915, le Tchèque Bedrich Hrozny traduit le hittite, Johannes Friedrich jette les bases de la traduction de l'urartéen dans les années 1930, alors que la compréhension de la langue hourrite progresse lentement depuis la fin du XIXe siècle, tandis que l'éblaïte est redécouvert en 1975[21]. Mais cela concerne plutôt l'histoire de la linguistique, et moins l'histoire du déchiffrement d'un système d'écriture, puisque ces langues reprennent le même système qui est décodé depuis le milieu du XIXe siècle. Il a néanmoins fallu à chaque fois établir le syllabaire cunéiforme pour chaque langue, car l'écriture avait été adaptée au système phonétique de chacune des langues pour lesquelles elle était employée. Cela a pu être possible par le comparatisme linguistique dans le cas des langues avec parenté connue hors des textes cunéiformes (langues sémitiques comme l'akkadien, l'éblaïte et l'ugaritique, langues indo-européennes d'Anatolie comme le hittite et le louvite) et bien souvent avec le secours de textes antiques bilingues (ou tri- et quadrilingues), qui forment la base de notre compréhension des langues isolées (sumérien, élamite, hourrite, urartéen), sans lever certaines incertitudes.

Le système d'écriture cunéiforme le plus récemment déchiffré est celui de l'alphabet d'Ougarit, identifié sur des tablettes et objets provenant de cette cité découverte en 1929. Là encore, la traduction est l'œuvre de plusieurs savants travaillant au même moment : Édouard Dhorme, Charles Virolleaud et Hans Bauer. Il fut rapidement établi qu'il s'agissait d'un alphabet vu le nombre réduit de signes, probablement d'une langue sémitique, apparentée au phénicien vu la localisation du site de provenance, et qui n'écrivait que les consonnes et semi-consonnes. Progressivement les trois identifièrent les premières lettres. Dhorme repéra le l, qui signifiait la préposition « à » en phénicien, puis traduisit le terme b'l, Ba'al, divinité principale de la région. Bauer lut sur une hache le terme « hache », grzn (qu'il aurait en fait fallu lire ḫrṣn, mais cette approximation n'entrava pas les recherches). Reprenant ces données, Dhorme put lire sur un autre objet l rb khnm, « au chef des prêtres ». Les trois spécialistes identifièrent finalement tous les signes, et ce dès 1931, puis ils établirent que la langue avait bien un caractère « cananéen », bien qu'on l'appelle plutôt ugaritique. La publication de nouvelles tablettes par la suite permit de compléter le déchiffrement[22].
Histoire
Les débuts de l'écriture : le « proto-cunéiforme »
Le système d'écriture mésopotamien apparaît vers 3200 av. J.-C.[23] ou avant (dès 3400-3300) sur des tablettes exhumées à Uruk et sur d'aures sites, durant la période d'Uruk récent (stade de l'écriture dit « Uruk IV », v. 3400-3200 av. J.-C.) et celle de Djemdet Nasr (« Uruk III », v. 3200-3000 av. J.-C.). Cette invention se fait au milieu de nombreux changements : émergence de la première société urbaine, des premiers États, d'une économie agricole plus productive et de réseaux d'échanges plus importants, tout cela s'accompagnant de changements dans la symbolique, auxquels participe l'écriture. Cette première écriture a une graphie linéaire et pas encore cunéiforme stricto sensu, mais les signes employés et les principes annoncent ceux du système cunéiforme. On parle donc parfois de « proto-cunéiforme », selon l'expression de R. Englund. Les textes sont pour la plupart de nature administrative : enregistrement de livraisons et de distributions de biens, essentiellement des denrées d'origine agricole, notamment des rations versées à des travailleurs ou des produits qui vont être employés pour fabriquer de la bière, ou encore des animaux, aussi des attributions de champs avec calcul de leur surface. Une minorité de textes (environ 15 %) sont des inventaires de signes, les listes lexicales. Cette écriture a des liens avec d'autres systèmes d'enregistrement d'informations et d'administration, parfois développés depuis longtemps : les jetons (ou calculi) qui servent probablement à identifier des biens faisant l'objet de transfert, les bulles d'argile qui contiennent certains de ces jetons, afin de conserver l'information, et la doublent parfois par des signes à leur surface, puis les tablettes comprenant uniquement des signes numériques qui précèdent directement les débuts de l'écriture, quelques-unes comprenant même des idéogrammes (tablettes « numéro-idéographiques »). Une hypothèse populaire, promue par D. Schmandt-Besserat, trace une filiation directe entre les jetons, les bulles, et les premières tablettes écrites, en proposant que les premiers signes écrits ne soient rien d'autre que la transcription des jetons sur une tablette. Mais les cas de liens assurés entre les deux sont très limités, aussi cette hypothèse n'est pas suivie par les spécialistes du sujet[24]. Il est néanmoins couramment admis que l'écriture émerge en lien avec ces instruments administratifs et d'autres (notamment les sceaux), élaborés pour des finalités administratives, comptables, reflétant le même contexte d'émergence d'institutions complexes, et qu'ils sont bien d'une certaine manière des « précurseurs » de l'écriture proto-cunéiforme. En l'état actuel des connaissances, rien n'indique qu'il y ait un stade de développement antérieur aux premiers textes écrits connus[25].
Le proto-cunéiforme est un système logographique : les signes renvoient à un sens et pas forcément à un son précis. Ainsi le signe signifiant la « tête » pourra être lu et compris par une personne ne parlant pas la langue de celui qui l'a écrit et elle le prononcera différemment. Ce ne serait donc pas une écriture au sens strict du terme puisqu'elle ne cherche pas à retranscrire une langue, mais plutôt une forme sophistiquée d'aide-mémoire. La question de savoir s'il existe dès l'origine des signes phonétiques, employés uniquement pour le son auquel ils renvoient et non leur sens, reste en débat, mais même si c'est le cas ils seraient très minoritaires. En identifier avec assurance permettrait de trancher la question des inventeurs de l'écriture : si on isole parmi les premiers textes des signes phonétiques renvoyant assurément à la langue sumérienne, il serait clair que les Sumériens sont les inventeurs de l'écriture. Mais d'autres peuples inconnus de nous ont pu exister et participer à l'élaboration de l'écriture et à son utilisation, qui ne nécessite pas la connaissance d'une langue précise. Il est néanmoins couramment admis, en s'appuyant sur quelques exemples débattus de lecture phonétique parmi les textes les plus anciens et sur l'adéquation entre le système d'écriture et la langue sumérienne, que ce sont bien des Sumériens qui ont mis au point cette écriture[26], quoique l'un des principaux spécialistes des origines de l'écriture, R. Englund, ait à plusieurs reprises manifesté son scepticisme devant cette affirmation et pense qu'on ne peut se prononcer[27].
_appears._From_Uruk%252C_Iraq._End_of_the_4th_millennium_BCE._Vorderasiatisches_Museum%252C_Berlin.jpg.webp) Tablette de comptabilité d'Uruk, portant des signes pictographiques, dont le vase (DUG) au milieu. Pergamon Museum.
Tablette de comptabilité d'Uruk, portant des signes pictographiques, dont le vase (DUG) au milieu. Pergamon Museum. Tablette administrative de la période d'Uruk III (v. 3200 av. J.-C.), en signes pictographiques. Musée du Louvre.
Tablette administrative de la période d'Uruk III (v. 3200 av. J.-C.), en signes pictographiques. Musée du Louvre..jpg.webp) Tablette de comptabilité d'Uruk, Uruk III (c. 3200-3000 av. J.-C.), en logogrammes et signes numériques « proto-cunéiformes », Pergamon Museum[28].
Tablette de comptabilité d'Uruk, Uruk III (c. 3200-3000 av. J.-C.), en logogrammes et signes numériques « proto-cunéiformes », Pergamon Museum[28]. Liste de noms de lieux, écriture « proto-cunéiforme », Djemdet-Nasr, v. 3000-2900 av. J.-C. British Museum.
Liste de noms de lieux, écriture « proto-cunéiforme », Djemdet-Nasr, v. 3000-2900 av. J.-C. British Museum.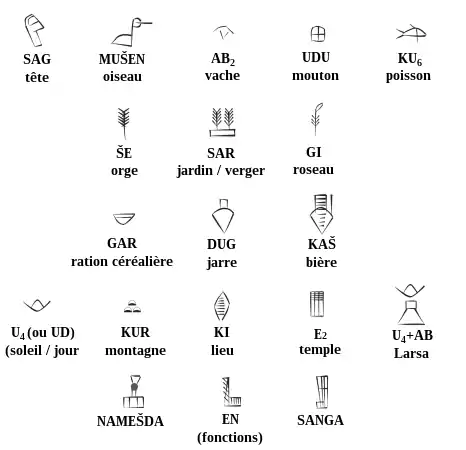 Exemples de signes logographiques proto-cunéiformes (à partir de dessins de R. Englund).
Exemples de signes logographiques proto-cunéiformes (à partir de dessins de R. Englund).
L'origine de la forme de ces signes apparaissant à la fin du IVe millénaire av. J.-C. n'est pas toujours explicable. Certains sont apparemment des inventions libres ou incompréhensibles pour nous, notamment quand il s'agit de choses non matérielles, abstraites, mais aussi pour des choses qui auraient sans doute pu être figurées plus facilement (comme le signe du « mouton » qui est une croix dans un cercle). Il est néanmoins manifeste qu'une bonne partie si ce n'est la majorité sont des pictogrammes à l'origine, donc des dessins de ce qu'ils signifient[29] : représentations de choses visualisables, que l'on ait cherché à les représenter en entier (une main, une écuelle), en partie (tête d'animal pour figurer tout l'animal), de façon simplifiée (trois collines pour « montagne ») ou symbolique (une étoile pour le « ciel »). Des sens dérivés étaient ensuite trouvés à partir d'un signe existant : la « bouche » (KA[note 2]) était une tête (SAG) dont le bas de visage était surchargé de traits (hachurage, gunû en akkadien), puis par dérivation de son sens initial le même signe pouvait également désigner la « parole » (INIM), la « dent » (ZÚ), les verbes « parler » (DUG4) et « crier » (GÙ). Cela a donné naissance dans le cunéiforme à un système où les signes sont souvent polysémiques (ils ont plusieurs sens)[30]. La combinaison de plusieurs signes pouvait également en créer un nouveau : « tête » (SAG) + « écuelle » (GUR ; qui équivaut à « ration ») = « versement/dépense (de ration) » (GU7). Parmi les autres principes graphiques employés par la suite dans le système cunéiforme pour l'élaboration de nouveaux signes à partir de signes préexistants on trouvait la simplification (nutilû) qui enlève des traits, le redoublement (minabi), ou encore la ligature qui réunissait deux signes en un seul[31].
À partir des données apparaissant dans la documentation, les modalités et les causes de l'apparition de l'écriture en Mésopotamie sont débattues, d'autant plus que les textes les plus anciens sont souvent difficiles à comprendre. Comme vu plus haut les reconstructions les plus courantes estiment que l'écriture dériverait de systèmes de comptabilité qui préexistent (des formes de « pré-écriture »), et se présenterait d'abord comme un système purement logographique composé de signes représentant des choses et des valeurs numériques, avant de se complexifier et de s'étoffer progressivement. Le but des inventeurs de l'écriture est donc vu comme fondamentalement pragmatiste : il s'agit de disposer d'un instrument permettant de visualiser les actes administratifs. Cela est relié au phénomène de « révolution urbaine », à savoir l'émergence des premiers États et des institutions encadrant la société et l'économie mésopotamienne (palais et temples), faisant de l'écriture un instrument de contrôle et de pouvoir aux mains des élites. Mais les listes lexicales pourraient aussi refléter une approche savante de l'écriture, par l'effort de classification des éléments du réel dont elles témoignent[32].
La notation des sons et l'adaptation aux langages
Dans les premiers siècles du IIIe millénaire av. J.-C., durant l'époque des dynasties archaïques, l'écriture connaît un ensemble d'évolutions qui aboutissent à la constitution de l'écriture cunéiforme : des signes phonétiques se développent, et le système évolue de façon à être en mesure à rendre une langue parlée ; la graphie des signes devient composée uniquement de traits en forme de clous caractéristiques du cunéiforme, et abandonne progressivement ses aspects figuratifs initiaux pour devenir entièrement abstraite.
C'est que durant le début de la période des dynasties archaïques, en particulier dans des textes mis au jour à Ur (v. 2750-2700 av. J.-C.), que l'on relève de façon assurée la présence de signes phonétiques, clairement employés pour désigner un son et nom pas la chose ou l'idée à laquelle ils renvoient à l'origine[33]. Ils se font par la suite de plus en plus présents au cours du temps. Il est alors possible de déterminer que les scribes évoluent en milieu essentiellement sumérien, même si des termes en akkadien ne tardent pas à apparaître (voir plus bas). Cependant, l'écriture du sumérien fait pendant longtemps un usage restreint des signes phonétiques, ne rapportant pas les éléments grammaticaux, qui étaient des préfixes et des suffixes accolés à des racines verbales et nominales invariables (le sumérien étant une langue dite « agglutinante » dans laquelle les mots sont constitués de différents éléments invariables accolés suivant un ordre précis). Les racines du sumérien étaient surtout notées par des logogrammes qui constituent alors l'essentiel des textes écrits[34].
Le sumérien disposant de nombreux termes homophones (qui se prononcent de la même manière), l'écriture logographique est privilégiée pour les mots et verbes de base que l'on peut différencier par un signe différent afin d'éviter une confusion. Mais les scribes sumériens n'ont pas fait le choix de multiplier à l'infini les signes logographiques, et ont exploité la valeur phonétique des signes déjà existants. Cette évolution est facilitée par le fait que les mots sumériens sont généralement monosyllabiques, permettant d'employer les logogrammes pour leur valeur phonétique et constituer ainsi un corpus de signes syllabiques (on parle de syllabogrammes), notant les voyelles et les consonnes (V, VC, CV et CVC). Ainsi le signe ayant pour valeur logographique KA peut être utilisé pour écrire de façon phonétique des termes comprenant la syllabe [ka]. Cela permet une réduction du corpus de signes au cours du IIIe millénaire av. J.-C. en éliminant certains logogrammes remplacés par des signes à valeur uniquement phonétique[35]. Les bases du succès du système cunéiforme sont posées, car cela facilite son adaptation à d'autres langages et la diversification de son utilisation[36]. Les suffixes et préfixes grammaticaux du sumérien ne sont cependant notés couramment qu'à la fin du IIIe millénaire av. J.-C., quand cette langue tend à ne plus être parlée, sans doute parce qu'il faut la rendre plus aisée à comprendre pour des gens qui ne la maîtrisent pas au quotidien et qui avaient l'habitude d'utiliser une écriture avant tout phonétique pour transcrire leur propre langue[37].
L'évolution déterminante pour la mise en place du système cunéiforme résulte de la nécessité de l'adapter aux langues sémitiques parlées par les peuples voisins des Sumériens. Cela concerne en premier lieu l'akkadien parlé par les Sémites qu'ils côtoient en Basse Mésopotamie, mais aussi les langues des peuples sémitiques vivant en Haute Mésopotamie et en Syrie, à Ebla en particulier (pour l'idiome local, l'éblaïte)[38]. Quand ils commencent à noter des mots de leur langue par écrit vers 2500 av. J.-C., les scribes sémitiques vont puiser dans le stock de signes disponibles. Ils accentuent alors l'aspect phonétique de l'écriture, car ils reprennent avant tout le sens phonétique des signes employés pour écrire le sumérien. Mais ils conservent aussi les logogrammes qu’ils prononçaient dans leur langue, probablement par souci d'économie (un signe logographique valant pour un terme nécessitant plusieurs signes syllabiques dans leur langue). Ainsi, le signe DUG, signifiant « vase », prononcé [dug] en sumérien, peut conserver sa valeur logographique dans un texte en akkadien, et est alors prononcé karpatu(m) dans cette langue ; mais il pouvait aussi perdre son sens et conserver uniquement sa valeur phonétique issue du sumérien, [dug][39]. Pour éviter les confusions entre les nombreux homophones hérités du sumérien, les scribes de l'akkadien ont souvent tendance à restreindre le nombre de signes phonétiques (sauf pour les textes littéraires, religieux ou royaux aux registres de langue et d'écriture plus soutenus). En revanche au Ier millénaire le nombre de signes utilisés augmente, de même que l'utilisation de plusieurs valeurs pour un même signe[40].
En tant que langue flexionnelle disposant de moins d'homophones que le sumérien, l'akkadien se plie mieux à une écriture plus phonétique. Cela nécessite des adaptations comme l'emploi plus courant de signes précisant la valeur des logogrammes (déterminatifs et compléments phonétiques). Plusieurs problèmes se posent cependant du fait que le système phonétique de l'akkadien (et des langues sémitiques en général) correspond mal à celui du sumérien. Les consonnes laryngales et emphatiques sont inconnues de ce dernier, et il faut donc utiliser les signes présentant des sons voisins : DUG peut donc transcrire le son [dug] comme vu plus haut, mais aussi [duk] ou [duq] du fait de la proximité phonétique entre k, q et g[39]. De la même manière les consonnes t/ṭ/d et b/p partagent souvent les mêmes signes. Par la suite, on fait de même entre l, r et n. Cela se fit aussi pour les voyelles, entre e et i. Un autre problème vient du fait que les consonnes redoublées (géminées) n'apparaissent pas toujours dans les signes syllabiques, tandis que les voyelles longues sont rarement marquées, ce qui complique la compréhension de certaines séquences de signes. Le système cunéiforme est donc paradoxalement mal adapté pour transcrire la langue qui l'a le plus utilisé et pour les langues sémitiques en général : pas assez de consonnes différenciées, alors que la présence de plusieurs voyelles n'est pas forcément utile (les langues sémitiques fonctionnant avant tout autour de racines consonantiques)[41]. Il suffit pour cela de comparer ce système à ceux mis au point sur d'autres langues sémitiques ou afro-asiatiques (égyptien hiéroglyphique et alphabet phénicien) qui n'utilisent pas de voyelles, mais notent toutes les consonnes du répertoire phonétique de leur langue[42].
Les évolutions graphiques

L'écriture archaïque connaît une évolution graphique importante : elle se « cunéiformise »[43]. À partir de l'époque d'Uruk III (v. 3200 av. J.-C.), les traits auparavant linéaires que les scribes incisaient sur les tablettes d'argiles se segmentent et deviennent peu à peu des signes en forme de « coin » (ou « clous »), suivant la forme de leurs calames à extrémité triangulaire taillée à plat ou en biseau. Cela s'accentue au cours du IIIe millénaire av. J.-C., notamment avec l'emploi de calames plus épais. Les anciennes lignes sont remplacées par des traits terminés par des clous suivant trois ou quatre formes courantes : verticale, horizontale, diagonale, ainsi qu'un chevron où la tête de clou seule est incisée. La taille des clous peut varier : il existe de grands clous verticaux qui occupent la hauteur d'une case ou ligne, de petits qui n'en font que la moitié ou le tiers, et ainsi pour les différents types de clous. Les signes pictographiques (représentant une tête, une montagne, etc.) perdent donc leur aspect initial figuratif et leur forme après s'être schématisée devient un assemblage presque abstrait de traits droits en forme de clous allongés. Cela permet une écriture plus facile et plus rapide, le tracé de lignes dans l'argile fraîche étant complexe et propice aux ratures, tandis que l'incision de traits élimine ces défauts[44]. Progressivement, cette graphie née pour des raisons pratiques dans l'écriture sur argile (donc pour des textes d'archives que l'on ne souhaitait pas conserver longtemps) est adaptée à d'autres supports plus durs pour les inscriptions royales sur pierre. Pour ces dernières elle est longtemps restée linéaire : les signes sont alors similaires à ceux des tablettes, mais non terminés par les clous. L'ajout de ces derniers a tendance à compliquer le travail du graveur, la gravure par poinçon sur matière dure étant même plus simple si on ne reproduit pas les clous. Cette évolution est achevée dans les derniers siècles du IIIe millénaire av. J.-C. (inscriptions de Gudea de Lagash et des rois d'Ur III). Le passage à une graphie cunéiforme sur des supports autres que l'argile illustre en fin de compte la primauté de l'argile comme support écrit, par le fait qu'il sert de modèle pour les inscriptions sur des supports plus « nobles » servant pour des inscriptions commémoratives destinées à traverser le temps[45].
Une autre évolution graphique majeure est le changement du sens de lecture des signes : il est vertical au départ, de haut en bas, et par la suite il devient horizontal, de gauche à droite. Les signes suivent donc une rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela s'accompagne de la disparition des cases rectangulaires lues de haut en bas dans lesquels les signes sont inscrits à l'origine, remplacée par des lignes lues de gauche à droite. La datation exacte de ces changements est débattue : elle pourrait débuter dès la période des tablettes de Fara, vers 2600-2500 av. J.-C., mais elle n'est généralisée avec certitude que vers le milieu du IIe millénaire av. J.-C. L'époque d'Akkad (v. 2340-2150 av. J.-C.), qui connaît une importante réforme de l'écriture, semble être une étape importante puisque c'est alors que se développent les tablettes écrites en lignes. Les évolutions graphiques ne se font pas de façon uniforme selon le type de texte, et il y a manifestement eu cohabitation entre les deux types de lecture pendant plusieurs siècles. Les inscriptions royales conservent ainsi longtemps un aspect archaïsant (elles préservent notamment les cases) et ne deviennent assurément de lecture horizontale que sous les rois kassites et médio-assyriens, donc après 1400. Le fait que les premiers textes cunéiformes traduits soient d'époque tardive et donc tous de lecture horizontale fait que par convention tous les textes cunéiformes sont publiés pour une lecture horizontale, mais cela ne signifie pas qu'ils aient été lus de façon verticale dans l'Antiquité[46].
 Tablette (contrat de vente) en écriture cunéiforme archaïque, écrite en cases, lecture verticale. Shuruppak, v. 2600 av. J.-C. Musée du Louvre.
Tablette (contrat de vente) en écriture cunéiforme archaïque, écrite en cases, lecture verticale. Shuruppak, v. 2600 av. J.-C. Musée du Louvre..jpg.webp) Tablette administrative d'Adab, relative à du bétail, écriture en lignes, postérieure à la rotation de l'écriture ? Règne de Shar-kali-sharri, v. 2150 av. J.-C. Musée de l'Institut oriental de Chicago.
Tablette administrative d'Adab, relative à du bétail, écriture en lignes, postérieure à la rotation de l'écriture ? Règne de Shar-kali-sharri, v. 2150 av. J.-C. Musée de l'Institut oriental de Chicago. Stèle du Code de Hammurabi : cunéiforme archaïsant, écriture en cases et lecture verticale. Daté d'environ 1750 av. J.-C. Musée du Louvre.
Stèle du Code de Hammurabi : cunéiforme archaïsant, écriture en cases et lecture verticale. Daté d'environ 1750 av. J.-C. Musée du Louvre. Kudurru, stèle de donation du roi Meli-Shipak (1186 à 1172 av. J.-C.) : écriture en lignes, lecture horizontale. British Museum.
Kudurru, stèle de donation du roi Meli-Shipak (1186 à 1172 av. J.-C.) : écriture en lignes, lecture horizontale. British Museum.

Le passage à une graphie cunéiforme suppose un effort d'adaptation et de systématisation de l'écriture aux nouvelles pratiques. La plupart des signes gardent une base qui, similaire au cours du temps, fait qu'on peut facilement les identifier à partir de leurs traits de base. Les plus simples, qui ne peuvent pas trop être modifiés, restent souvent identiques. Mais certains connaissent de grandes modifications, même si leurs traits de base restent généralement stables. À partir des graphies du IIIe millénaire av. J.-C., les signes connaissent des évolutions suivant les lieux et les époques, ce qui fait qu'à la simple vue de la graphie un chercheur expérimenté pourra reconnaître la période de rédaction d'un texte[47]. Si on s'intéresse aux évolutions générales qui ont lieu en Mésopotamie, on remarque une simplification croissante de nombreux signes, par suppression de traits. Les scribes assyriens ont tendance au Ier millénaire av. J.-C. à réduire le nombre de traits obliques pour les remplacer par des traits verticaux ou horizontaux. À l'inverse, ceux de Babylonie gardent les traits obliques, et leurs signes restent plus proches de ce qu'ils étaient aux périodes précédentes. Dès la fin du IIe millénaire av. J.-C., la graphie assyrienne est plus normalisée que celle de Babylonie, et cela s'accentue à la période néo-assyrienne (911-609 av. J.-C.)[48]. Les premiers éditeurs modernes de textes cunéiformes de cette époque ont d'ailleurs fondu des caractères d'imprimerie en cunéiforme néo-assyriens pour les livres qu'ils imprimaient. Mais cela résulte d'une interprétation contemporaine, car les scribes antiques n'ont jamais cherché à avoir une graphie strictement normalisée, et de ce fait il existe toujours des variations (souvent infimes) dans l'écriture d'un scribe à l'autre, même pour une période identique[49].
Diversification des usages

Les plus anciens textes connus aux périodes d'Uruk récent et de Djemdet Nasr (c. 3300-2900 av. J.-C.) sont des documents de comptabilité et de gestion. Mais dès ces débuts, les scribes mésopotamiens réalisent aussi des listes lexicales, textes lexicographiques ayant pour but de servir d'inventaires de signes, utiles notamment pour les apprentis scribes, et aussi d'enregistrer et de classer les éléments du réel. Les possibilités diverses offertes par l'écriture sont découvertes progressivement. Durant la première période des dynasties archaïques (DA I, c. 2900-2750 av. J.-C.) apparaissent les premiers actes juridiques privés, à savoir des actes de vente de terres sur pierre, puis sur argile à la période suivante (DA II, c. 2750-2500 av. J.-C.). Par la suite (DA III, c. 2500-2350 av. J.-C.) on procède à la rédaction de tablettes enregistrant la vente de maisons, d'esclaves, des prêts. Les catégories de textes destinés aux prêtres qui forment la catégorie des « lettrés » se diversifient au même moment : textes de rituels religieux, notamment divinatoires, et d'autres qui peuvent être qualifiés de « littéraires » (sagesses et hymnes). Un autre changement majeur de cette période est le développement des textes commémoratifs : inscriptions de fondation, textes historiographiques développés (Stèle des vautours d'En-metena de Lagash). Durant les périodes d'Akkad et d'Ur III (fin du IIIe millénaire av. J.-C.) l'usage juridique de l'écriture se diversifie encore avec la rédaction de comptes-rendus de procès et du premier « code » de lois (Code d'Ur-Nammu). La narration progresse avec la rédaction d'hymnes, d'épopées et de mythes développés[50].
La plupart de ces types de textes mis au point en Mésopotamie se diffusent par la suite avec l'extension du cunéiforme, étant souvent transposés dans de nouvelles langues. L'ensemble des évolutions qu'a connues le système cunéiforme au cours du IIIe millénaire av. J.-C. (adaptation à l'akkadien, graphies plus rapides, diversification des types de textes) contribue à la diffusion rapide de cette écriture. Parallèlement se poursuivent certaines des expérimentations déjà engagées, notamment l'accentuation de la phonétisation qui permet de la rendre plus accessible pour un usage courant, et le développement de disciplines spécialisées ayant chacune une façon spécifique d'utiliser cette écriture pour des types de textes bien définis permettant des usages plus techniques. L'écriture connaît une utilisation de plus en plus large dans la société, en particulier au début du IIe millénaire av. J.-C. quand elle se répand considérablement dans la sphère privée[51].
Le cunéiforme à la conquête du Proche-Orient ancien

Diffusée rapidement hors de Mésopotamie méridionale[52], adaptée à l'akkadien et aussi à l'éblaïte autour du milieu du IIIe millénaire av. J.-C., puis de plus en plus répandue dans la société (notamment au tournant du IIe millénaire av. J.-C.), l'écriture cunéiforme connaît un grand succès dans tout le Moyen-Orient où elle est adoptée pour transcrire les langues de plusieurs royaumes, après la disparition de la langue pour laquelle elle a sans doute été mise au point, le sumérien, à la fin du IIIe millénaire av. J.-C. ou au début du IIe millénaire av. J.-C.[53]. On constate que généralement les langues adaptées sont celles parlées par les élites dirigeantes des grands royaumes, mais beaucoup de langues qui auraient pu être adaptées ne l'ont pas été, soit parce qu'elles n'étaient pas parlées par un groupe numériquement ou politiquement important (kassite) ou bien parce que des langues voisines étaient déjà employées (amorrite et « cananéen », connus surtout par des contaminations de textes en akkadien) ; certaines langues d'Anatolie n'ont été adaptées que pour quelques textes de rituels religieux qui n'en offrent qu'un maigre aperçu (hatti, palaïte). La plupart des langues adaptées au cunéiforme ont procédé à une sélection similaire à celle réalisée pour l'akkadien cunéiforme, qui a servi de modèle. Les signes phonétiques sont majoritaires, et là encore ils transcrivent souvent mal la phonologie des langues qui sont elles aussi sans lien avec le sumérien. Pour éviter la confusion des signes homophones, le répertoire est limité à 100-150 signes phonétiques en général, auxquels il faut ajouter des logogrammes sumériens qui ont été conservés[54]. L'adaptation du cunéiforme s'accompagne de l'importation de textes mésopotamiens servant à l'apprentissage des scribes (listes lexicales, textes mythologiques et épiques servant de modèles), qui devaient avoir des rudiments de sumérien, mais aussi d'akkadien pour maîtriser ce système ; des scribes mésopotamiens ont d'ailleurs sans doute travaillé dans la plupart des pays adoptant l'usage du cunéiforme, jusqu'en Égypte même[55]. La diffusion de cette écriture accompagnait donc le rayonnement culturel mésopotamien (surtout babylonien) qui reste une caractéristique majeure de la « culture cunéiforme ». L'apogée de l'extension du cunéiforme se situe dans la seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C., quand il est attesté, en plus de la Syrie et la Mésopotamie, en Anatolie, en Palestine, en Égypte, en Iran, et même à Bahreïn (où un gouverneur babylonien est installé)[56], ainsi qu'en Grèce continentale (Thèbes, Tyrinthe) par quelques objets importés (le cunéiforme n'étant apparemment pas écrit sur place)[57] - [58].

Vers 2250 av. J.-C., l'écriture cunéiforme est adaptée à l'élamite, langue du royaume d'Élam, situé dans l'Iran du sud-ouest. La région de Suse est depuis longtemps influencée par la Mésopotamie et a emprunté son système d'écriture (une large part de sa population étant de toute manière akkadienne), puis l'a adapté à l'élamite, d'abord pour quelques textes diplomatiques et royaux, avant d'en diversifier l'usage, même s'il reste cantonné surtout à Suse et à des sites alentour (Haft-Tappeh et Chogha Zanbil) et se diffuse peu vers l'Élam intérieur (Anshan). L'élamite cunéiforme a été repris par les rois perses achéménides pour des textes royaux et des documents administratifs[59].

Les Hourrites, peuple parlant une langue sans doute originaire du Caucase sud, ont été une composante essentielle de la Haute Mésopotamie, de la Syrie et de l'Anatolie orientale entre la fin du IIIe millénaire av. J.-C. et la fin du IIe millénaire. Un de leurs rois réalise une inscription dans cette langue dès le XXIe siècle av. J.-C., mais les attestations écrites du hourrite sont surtout nombreuses pour les années 1500-1200, quand d'autres de leurs rois fondent le puissant royaume du Mittani, et surtout que la culture hourrite exerce une forte influence dans le royaume hittite, qui reste le principal pourvoyeur de textes dans cette langue, et à Ugarit, où le hourrite est même parfois transcrit dans l'alphabet cunéiforme local[60].
Deux tablettes de provenance inconnue datées de la période paléo-babylonienne (v. 2000-1600 av. J.-C.) contenant des passages en langue amorrite (ou dans une autre langue ouest-sémitique) ont été publiées en 2022. Jusqu'alors cette langue était surtout connue par des noms de personnes et de lieux ainsi que des mots épars figurant dans des tablettes rédigées en akkadien[61].
Vers 1625 av. J.-C. au plus tard, le cunéiforme est adopté par les rois hittites vivant en Anatolie centrale, à partir des royaumes syriens qu'ils dévastent (Alalakh, Alep), y prenant sans doute des scribes qualifiés. Le cunéiforme avait déjà été pratiqué en Anatolie durant la période des marchands assyriens au XIXe siècle av. J.-C., mais cette expérience n'avait apparemment pas donné lieu à l'adaptation de cette écriture aux langues locales[62]. Le royaume hittite voit en revanche l'adaptation de cette écriture à plusieurs langues. La plus écrite est le hittite, langue indo-européenne dont la phonologie est elle aussi assez éloignée de celle du sumérien et de l'akkadien. Les scribes hittites ont mis au point un système relativement complexe comprenant de nombreux signes, et rajoutant aux catégories courantes (syllabogrammes, logogrammes sumériens et autres compléments phonétiques et déterminatifs) la catégorie des « akkadogrammes », termes akkadiens inclus dans des textes en hittite avec la fonction de logogramme[63]. Les scribes du royaume hittite adaptent également le cunéiforme à d'autres langues indo-européennes voisines du hittite, le louvite[64] et (plus marginalement) le palaïte[65], ainsi qu'au hatti, isolat linguistique parlé par les prédécesseurs des Hittites en Anatolie centrale.
Les langues sémitiques parlées dans la Syrie et le Levant du IIe millénaire av. J.-C., l'amorrite et les langues « cananéennes », n'ont pas été adaptées telles quelles à l'écriture cunéiforme. Elles peuvent cependant être connues parce que des termes qui en sont issus se retrouvent dans des textes en akkadien écrits phonétiquement, car il s'agissait de la langue vernaculaire des régions où ils ont été écrits (royaume de Mari, royaumes levantins vassaux de l'Égypte à l'époque d'Amarna, Ugarit) et qu'ils ont donc eu une influence sur l'akkadien qui y fut écrit. On parle parfois d'akkadien périphérique pour désigner ces formes d'akkadien écrit « contaminées » par des langues locales, ou de formes hybrides d'akkadien. Le cas le plus représentatif est celui de l'« akkado-cananéen » des lettres des roitelets de Palestine et du sud de la Syrie (vassaux de l'Égypte) dans la correspondance d'Amarna, où l'influence de leurs langues « cananéennes » se fait le plus sentir[66]. Ce même phénomène se retrouve en pays hourrite, dans les archives de Nuzi[67].
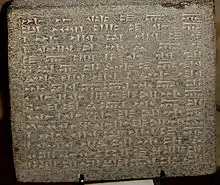
L'écriture cunéiforme connaît durant la seconde moitié du IIe millénaire un développement original dans le royaume d'Ugarit en Syrie, où elle est adaptée pour transcrire la langue locale (l'ugaritique) non pas suivant le système syllabo-logographique courant, mais suivant un système alphabétique[68]. Il ne s'agit sans doute pas du premier alphabet (ou plutôt des premiers alphabets puisqu'on a pu identifier trois variantes d'alphabet cunéiforme à Ugarit, voir plus bas), car l'origine de ce système d'écriture est à rechercher dans un alphabet linéaire réalisé quelque part en Palestine ou en Syrie sous l'influence des écritures égyptiennes dont il reprend les principes phonétiques (écriture des consonnes seules)[69]. L'alphabet cunéiforme n'a pas de postérité, car les alphabets développés par les Phéniciens puis les Araméens sont de type linéaire. Il représente donc une expérience originale combinant les habitudes héritées du cunéiforme (support, graphie des signes) aux simplifications de l'alphabet (la phonétisation complète).
Durant la première moitié du Ier millénaire av. J.-C., le cunéiforme connaît un important recul puisqu'il disparaît de l'usage courant dans la majeure partie de l'Anatolie, en Syrie et au Levant qui adoptent complètement l'alphabet. Il se diffuse cependant encore à quelques nouvelles régions. C'est le cas du royaume d'Urartu, situé entre l'Anatolie orientale et le sud du Caucase, qui l'adapte à sa langue (l'urartéen, apparenté au hourrite) au VIIIe siècle av. J.-C., après avoir dans un premier temps employé l'assyrien. Il y est surtout utilisé pour des inscriptions royales, les textes administratifs n'étant apparemment qu'un développement tardif[70].
À la fin du VIe siècle av. J.-C., la chancellerie du roi perse achéménide Darius Ier utilise le cunéiforme akkadien et élamite pour des inscriptions royales et des textes administratifs, contribuant ainsi à une nouvelle diffusion du cunéiforme, cette fois-ci vers l'est, puisqu'on en trouve à Persépolis, mais aussi jusqu'au Vieux Kandahar en Afghanistan[71]. Ce roi innove en faisant procéder à l'élaboration d'une écriture cunéiforme pour transcrire le « vieux-perse », langue de type iranien qui repose sans doute en partie sur la langue des Perses de cette période et celle des Mèdes. Ce système diffère du cunéiforme standard, car il est limité à une trentaine de signes phonétiques, auxquels s'ajoute une poignée de logogrammes. À ce jour on le connaît surtout par des inscriptions royales, et par seulement une tablette administrative : sa création avait sans doute un but commémoratif[72].
Recul et disparition

À partir de la première moitié du Ier millénaire av. J.-C., les écritures alphabétiques linéaires sur des supports souvent périssables (papyrus, parchemin), dérivées de l'alphabet phénicien, tendent à devenir prépondérantes dans tout le Proche-Orient. Celle qui connaît le plus de succès est l'araméen, du fait de l'importance numérique et de la dispersion géographique de ce peuple. Cette langue tend à supplanter l'akkadien comme lingua franca du Proche-Orient, et le cunéiforme disparaît au début du Ier millénaire av. J.-C. des sites extérieurs à la Mésopotamie, sauf lorsque des souverains de ce dernier pays font graver des inscriptions. En Mésopotamie même, l'écriture alphabétique prend de plus en plus de poids dans les empires néo-assyrien et néo-babylonien, et les reliefs et fresques d'Assyrie présentent souvent un scribe écrivant sur papyrus ou parchemin à côté d'un scribe écrivant sur tablette, signe de la cohabitation des deux systèmes. Les Achéménides choisissent l'araméen comme langue officielle, achevant le processus entamé par leurs prédécesseurs. La tradition cunéiforme subsiste cependant dans la Babylonie du Ier millénaire av. J.-C., mais l'amenuisement au fil du temps des corpus trouvés dans cette région indique que l'écriture sur support périssable a pris le dessus. Les entrepreneurs privés ont encore des archives cunéiformes jusqu'à l'époque parthe, mais c'est surtout dans les temples (notamment à Uruk et Babylone) que le cunéiforme est encore employé, étroitement lié à l'antique tradition mésopotamienne encore vivace dans ces lieux[73].
En réaction à l'usage des alphabets sémitiques, le cunéiforme connaît des évolutions à cette période. Premièrement, on remarque que les voyelles de certains signes syllabiques ne sont plus prises en compte, seules les consonnes l'étant, ce qui est manifestement une influence des alphabets sémitiques consonantiques[74]. Une autre évolution est que, paradoxalement, la diminution de l'usage du cunéiforme face à l'alphabet, qui est préféré pour sa plus grande rapidité et sa meilleure adaptation aux langues sémitiques, alors qu'au même moment (en réaction ?) s'observe la complexification du cunéiforme, qui voit la multiplication du nombre de valeurs des signes, l'augmentation du nombre de signes utilisés et le développement d'un savoir ésotérique sur l'interprétation des signes[75].
Quand a été inscrit le « dernier coin » sur une tablette cunéiforme ? On connaît un texte astrologique cunéiforme datant de 75 apr. J.-C[76], retrouvé dans l'Esagil, temple de Marduk à Babylone, lieu sacré de l'ancienne Mésopotamie s'il en est. Une tablette qui serait plus récente encore, de 79/80 ap. J.-C., là encore astronomique, provient d'Uruk[77]. Mais des textes plus récents ont probablement été réalisés, qui ont disparu ou attendent encore d'être découverts. Au plus tard, l'écriture cunéiforme a dû s'éteindre vers les débuts de la domination sassanide en Babylonie, soit le milieu du IIIe siècle de notre ère[78].
Principes des écritures cunéiformes
La longue et complexe évolution du cunéiforme à base syllabique a donc abouti à une écriture comprenant des signes à la fois phonétiques et logographiques (ou idéographiques), pouvant avoir diverses valeurs (polysémie). Les signes peuvent avoir d'autres valeurs : compléments phonétiques, déterminatifs, signes numériques. Il convient de résumer les grands traits de cette écriture et de s'interroger sur sa supposée complexité, et de voir également les formes « dérivées » du cunéiforme : les alphabets cunéiformes, attestés surtout à Ugarit, et le syllabaire perse.
Les phonogrammes

Les phonogrammes sont des signes représentant un son, plus précisément une syllabe (on parle aussi de « syllabogrammes »)[80]. Les signes phonétiques les plus simples valent pour une seule voyelle (V), c'est-à-dire dans les cas de [a], [e], [i], [u] (auxquels il faut peut-être ajouter [o] dans certains syllabaires[81]). La plupart des signes associent consonnes (C) et voyelles (V) : les syllabes ouvertes, de type CV ([ki], [mu], [na], etc.) ; les syllabes fermées, de type VC (voyelle-consonne, comme [um], [ap], [ut], etc.) ; et CVC ([tam], [pur], [mis], etc.), selon un principe adapté à la langue sumérienne, fondamentalement monosyllabique. On trouve aussi des signes ayant des valeurs plus complexes, les signes bisyllabiques ([tara], [reme], etc.)[82]. Il n'y a en revanche pas de signe pour transcrire des syllabes dans lesquelles deux consonnes se suivent (type CCV comme [tra] ou VCC comme [art]), problème que l'on peut contourner aisément pour une syllabe en position intermédiaire dans un mot (écrire ši-ip-ru pour šipru en akkadien, « message »), mais pas en syllabe initiale, ce type de configuration n'existant ni en sumérien, ni en akkadien. Les scribes hittites ont répondu à ce problème en accolant deux syllabes ouvertes dont toutes les voyelles ne se prononcent pas : écrire ma-li-it-tu ou mi-li-it-tu pour transcrire mlitu (« doux »)[83].

Comme cela a déjà été évoqué, les phonogrammes présentent plusieurs difficultés. De nombreux signes ont plusieurs valeurs phonétiques (polyphonie), alors que certains sons sont écrits par plusieurs signes différents (homophonie). La polyphonie vient du fait qu'un signe avait plusieurs significations, avec en plus des signes dérivés, mais aussi qu'aux valeurs phonétiques du sumérien se sont ajoutées celles de l'akkadien. Elle peut porter sur des signes différents, par exemple quand un même signe note le son ut et le son tam, mais elle porte aussi sur des sons proches, notamment sur la proximité phonétique des consonnes k/g (ak/ag), b/p (ab/ap), t/d (ut/ud), et pour les voyelles entre i/e (ib/eb, qui est aussi le même signe que ip/ep). L'homophonie vient du fait que l'écriture sumérienne avait de nombreux homonymes, qui étaient à la base marqués par des signes idéographiques différents. Cela complexifie la lecture de l'écriture cunéiforme, d'autant plus que ces signes peuvent aussi avoir en même temps des valeurs phonétiques et logographiques[41].
La reconstitution de la phonologie de l'akkadien a pu se faire par comparaison au système phonétique des autres langues sémitiques, qui est très stable. C'est à partir de ce système phonétique que la valeur des phonogrammes a été établie par les chercheurs modernes. La phonologie des autres langues transcrites par le cunéiforme a donc dû être reconstituée à partir de celles de l'akkadien, alors qu'il ne s'agit pas de langues qui lui sont apparentées et qu'elles ont donc présenté de grandes différences. De nombreuses incertitudes pèsent donc sur la prononciation exacte des termes dans des langues sans parenté connue comme le sumérien, le hourrite, l'élamite, l'urartéen, ou même les langues indo-européennes d'Anatolie[84]. Le syllabaire permet au moins de connaître à peu près la vocalisation des termes de ces langues (à la différence de l'égyptien ancien), mais ne lève pas de nombreuses incertitudes qui font qu'on ne sait pas toujours comment se prononçaient exactement les termes qu'on lit, même dans des textes transcrits phonétiquement.
Les logogrammes
Les logogrammes (« signes-mot ») sont des signes représentant un mot, catégorie qui englobe les idéogrammes (« signes-idées ») représentent une idée ou un concept, terme plus couramment employé dans les études cunéiformes[85]. Les idéogrammes cunéiformes peuvent représenter un verbe, un substantif, un adjectif, un adverbe ou une préposition. Certains sont composés de deux signes, voire plus. Ces signes ne renvoient que secondairement à un son, celui du mot dont ils sont porteurs du sens. Les idéogrammes ont à l'origine été développés dans l'écriture en sumérien et renvoyaient phonétiquement à des mots de cette langue, et quand ils ont été transposés dans une autre langue (contexte dans lequel on les appelle parfois « sumérogrammes »), ils ont conservé leur sens mais ont reçu une nouvelle valeur phonétique, dans la nouvelle langue : le logogramme ayant le sens de « fils », était ainsi lu phonétiquement dumu dans un texte en sumérien et māru(m) en akkadien[86]. Étant donné qu'il faut généralement un signe par mot, cela a pour effet de raccourcir le nombre de signes écrits pour une proposition, mais cela augmente considérablement le corpus de signes que peuvent employer les scribes. C'est le caractère idéographique de la majorité de ses signes qui explique que le système cunéiforme en comprenne un si grand nombre, en dépit du fait qu'un bon nombre d'idéogrammes aient aussi une ou plusieurs valeurs phonétiques et parfois même d'autres valeurs idéographiques. Il faut également noter que le hittite cunéiforme comporte un type spécifique de logogrammes, les « akkadogrammes », qui sont des mots écrits phonétiquement en akkadien, par exemple la négation UL, qui sera lu natta en hittite, ou le titre BE-EL MAD-GAL9-TI, « Seigneur de la tour de guet » (un gouverneur provincial), en hittite auriyas isha-[87].

Les déterminatifs
Les déterminatifs sont des signes qui servent à préciser le sens du mot qu'ils précèdent (déterminatifs antéposés) ou qu'ils suivent (déterminatifs postposés), voire dans lequel ils sont placés[88]. Ils indiquent la classe ou la nature du mot qu'ils déterminent (sa catégorie sémantique). Ce sont des signes silencieux, qui ne se prononcent pas, et n'existent donc que dans la sphère de l'écrit. Il s'agit le plus souvent de logogrammes. L'utilisation d'un déterminatif n'est pas systématique, et il arrive que le scribe s'en passe. Il existe cependant certains mots (écrits phonétiquement ou logographiquement) pour lesquels le déterminatif est toujours utilisé, comme les noms de certaines villes (déterminatif antéposé URU ou déterminatif postposé KI), ou les noms de divinités (DINGIR, souvent noté D). Par exemple, le signe IM seul peut avoir une valeur de logogramme désignant le vent, ou désigner les dieux de l'orage quand il est précédé du déterminatif des divinités, ou encore servir lui-même de déterminatif pour les points cardinaux[89]. Certains déterminatifs sont inclus dans le signe. Une autre catégorie de déterminatifs est de type grammatical, par exemple MEŠ, qui indique que le sumérogramme qu'il précède est un pluriel.
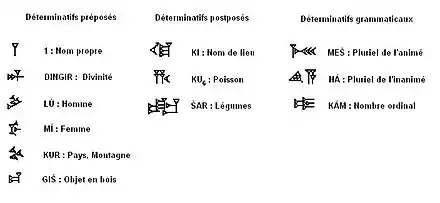
Les compléments phonétiques
Cette catégorie de signes, qui est en fait un type spécial de phonogrammes, sert à simplifier la lecture des logogrammes en leur accolant juste après un signe phonétique indiquant la terminaison du mot à lire : un complément phonétique[90]. Cela sert surtout dans le cas où un signe a plusieurs valeurs logographiques, ou bien quand on hésite entre une lecture logographique ou phonétique de ce signe. Par exemple, dans le cas du signe ayant pour valeur logographique DINGIR (« dieu », aussi déterminatif de la divinité) et valeur phonétique an, quand il est suivi d'un complément phonétique débutant par -r-, la première valeur sera choisie, et s'il est suivi d'un complément débutant par -n-, la seconde valeur sera choisie.
Les signes numériques
La cinquième et dernière catégorie de signes cunéiformes est constituée par les signes numériques. À l'époque des premiers textes écrits, les nombres sont notés par des encoches et des ronds imprimés par des calames à extrémité arrondie, qui sont ensuite remplacés par des signes cunéiformes à partir de 2500 av. J.-C., processus achevé à la fin du IIIe millénaire av. J.-C. (période d'Ur III). La même époque voit la mise en place un système de numération positionnelle de base soixante (ou sexagésimale), avec une base 10 (décimale) auxiliaire. L'unité est représentée par un clou vertical, qui peut être répété pour noter les chiffres jusqu'à 9, tandis que 10 est noté par un clou oblique (chevron). La répétition de ces deux seuls signes, les clous obliques (au maximum cinq) et les verticaux (au maximum neuf), permettent de noter 59 « chiffres ». Ainsi, une combinaison de quatre chevrons (quatre dizaines) et trois clous permet de noter le nombre quarante-trois : ![]()
![]() .
.
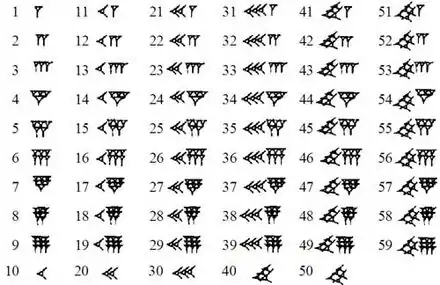
Le système utilisé est en base 60, ce qui signifie qu'un décalage d'un cran vers la gauche correspond à une multiplication par 60. Un nouveau décalage vers la gauche correspond à une nouvelle multiplication par soixante, etc. Ainsi, alors qu'un chevron suivi d'un clou signifie onze ![]()
![]() , un clou suivi d'un chevron désigne le nombre 70
, un clou suivi d'un chevron désigne le nombre 70 ![]()
![]() (1×60 plus 10, voir plus bas la section Jeux d'écriture pour la symbolique des nombres 11 et 70). Il n'y a pas de signe séparateur entre chaque groupe, et l'absence d'unité dans une de ces bases n'est pas notée avant le IVe siècle av. J.-C. qui voit l'invention du zéro positionnel[91]. Ainsi, l'ordre de grandeur du nombre n'est pas noté, celui-ci est défini à un facteur exposant de 60 près :
(1×60 plus 10, voir plus bas la section Jeux d'écriture pour la symbolique des nombres 11 et 70). Il n'y a pas de signe séparateur entre chaque groupe, et l'absence d'unité dans une de ces bases n'est pas notée avant le IVe siècle av. J.-C. qui voit l'invention du zéro positionnel[91]. Ainsi, l'ordre de grandeur du nombre n'est pas noté, celui-ci est défini à un facteur exposant de 60 près : ![]() peut aussi bien désigner le nombre 30, que 1800 (30×60) ou encore 1/2 (30/60). D'autres signes pouvaient noter une soustraction, des fractions ou des valeurs hautes (100, 1 000). Cette numération standard est celle des textes mathématiques, qui sert pour les calculs. Elle n'est pas utilisée dans les unités de poids et mesures qui utilisent des systèmes numériques alternatifs[92].
peut aussi bien désigner le nombre 30, que 1800 (30×60) ou encore 1/2 (30/60). D'autres signes pouvaient noter une soustraction, des fractions ou des valeurs hautes (100, 1 000). Cette numération standard est celle des textes mathématiques, qui sert pour les calculs. Elle n'est pas utilisée dans les unités de poids et mesures qui utilisent des systèmes numériques alternatifs[92].
Disposition des textes

L'écriture cunéiforme s'écrivait au départ dans des cases (ou cartouches) rectangulaires ou carrées dans lesquelles les signes se lisaient de haut en bas ; ces cases étaient disposées en rangées se lisant de droite à gauche, lesquelles étaient elles-mêmes lues de haut en bas sur la face de la tablette. Lorsque se produit la rotation de l'écriture, à partir du milieu du IIIe millénaire av. J.-C., l'écriture horizontale en lignes prend peu à peu le pas. Les lignes se lisent de gauche à droite. Les mots et les phrases ne sont généralement pas séparés, même s'il existe des séparateurs dans quelques rares textes (un clou vertical ou plusieurs clous obliques). Il est rare qu'un mot se poursuive sur plusieurs lignes, les lignes ayant souvent un sens complet. Pour le cas du support le plus courant, la tablette d'argile, le document est en général de forme rectangulaire et se lit avec le côté le plus long à la verticale (façon « portrait »), mais il existe d'autres formes de tablettes et de lectures. Quand la face de la tablette ne suffisait pas à contenir tout le texte, on écrivait sur son revers, auquel cas le passage de l'un à l'autre se faisait suivant une rotation verticale et non horizontale comme sur nos livres (l'écriture au revers étant donc à l'envers de celle de la face)[93]. Sur certaines des tablettes écrites en lignes, des traits horizontaux servaient de guide d'écriture et de lecture comme les lignes des cahiers, mais la référence semble être la ligne du dessus[94] ; d'autres pouvaient comporter des traits séparateurs délimitant des colonnes, des grandes cases ou des paragraphes ; parfois c'est un double trait horizontal ou même un vide qui sert à découper le texte. Cela dépend des habitudes et des époques comme des types de textes[95].
Un système complexe ?
La coexistence de valeurs phonétiques et idéographiques pour un même signe rend le système cunéiforme potentiellement compliqué[96]. C’est le produit de son histoire complexe, partant de son élaboration pour le sumérien et de son adaptation à d'autres langues phonétiquement et morphologiquement très différentes de celle-ci, en premier lieu l'akkadien. Pour donner une idée de cette complexité, on peut reprendre un exemple donné par J.-M. Durand, celui du groupe de deux signes dont la valeur fondamentale respective est IZ et KU, dans un texte en akkadien. On peut choisir de les lire comme des logogrammes sumériens, auquel cas deux lectures sont possibles (autour de deux valeurs logographiques possibles de KU) : GIŠ TUKUL, « arme », qui sera lu kakku(m) en akkadien ; et GIŠ TAŠKARIN, « buis », qui sera lu taskarinnu(m) en akkadien. Si on les lit comme des signes uniquement phonétiques, alors quatre cas sont possibles autour de deux valeurs phonétiques de IZ ([es] et [iz] ; ce signe peut aussi se prononcer [eṣ] et [iṣ]) et de KU ([qu] et [ku]) : eskū « ils ont été décidés », esqū « ils ont été gravés », izku « il a été purifié », izkū « ils ont été purifiés ». Le choix de lecture se fait donc en fonction du contexte du texte déchiffré[74].
De plus, des confusions entre logogrammes semblent avoir eu lieu à l'époque quand le contexte ne permettait pas de trancher clairement : dans une lettre en akkadien provenant de Nippur datée de l'époque kassite (XIVe siècle av. J.-C.), un fonctionnaire se plaint au gouverneur qu'on lui ait envoyé de la paille alors qu'il demandait des marmites. La confusion vient apparemment du fait que la lettre de demande envoyée auparavant (non retrouvée) employait le logogramme signifiant « marmite » (ÚTUL, lu diqāru en akkadien), qui dans la graphie de l'époque est très similaire à celui désignant la « paille » (IN(.NA) / tibnu), entraînant une mauvaise compréhension de la demande de la part de la personne chargée de l'envoi des biens. Confusion que le fonctionnaire tenterait d'éviter dans la lettre retrouvée en privilégiant une écriture phonétique en akkadien de « marmites » (di-qa-ra-ti pour diqārāti, pluriel de diqāru au cas oblique)[97].
Cependant, il existe des limites à cette complexité de l'écriture qui visaient à la simplifier pour un usage courant : les déterminatifs et compléments phonétiques pour clarifier la lecture, et aussi les habitudes des scribes des régions d'où provient le document étudié, qui avaient sélectionné un répertoire précis et souvent volontairement limité de signes phonétiques et idéographiques, en éliminant souvent les possibilités d'usage multiple pour un même signe (ce qui était permis par l'étendue du stock de signes potentiellement disponibles). En restreignant au maximum l'usage de signes logographiques, on pouvait ainsi limiter le nombre de signes employés couramment à une centaine pour un usage sur des textes de la vie courante (contrats, documents de gestion, lettres)[98].
Mais en pratique les logogrammes sont restés employés jusqu'à la fin de l'usage du cunéiforme, sans doute en partie pour des raisons culturelles. Du reste, l'exemple des écritures en Chine et au Japon montrent qu'un système ayant une bonne part de logogrammes n'est pas voué à devenir strictement phonétique ou disparaître. En Mésopotamie, l'usage de signes en sumérien conserve un certain prestige après la disparition de la langue, alors qu'ils ne simplifient pas forcément l'écriture : dans les textes en akkadien, la notation logographique en sumérien pour « cheval », ANŠE.KUR.RA, est fréquemment employée, alors qu'il est à première vue plus simple de l'écrire phonétiquement, si-su. Cela est surtout visible dans le milieu lettré, où l'emploi des sumérogrammes augmente dans les dernières périodes d'utilisation du cunéiforme (seconde moitié du Ier millénaire av. J.-C.), le répertoire de signes employés étant alors plus important qu'il ne l'était un millénaire auparavant[99].
Dans le contexte du Proche-Orient, l'évolution historique vers des écritures de plus en plus phonétiques semble cependant avoir rendu le système cunéiforme obsolète pour un usage courant, une fois que le système alphabétique a été mis au point et perfectionné[42].
Les alphabets cunéiformes

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une évolution du système cunéiforme, mais plutôt de celle de l'écriture hiéroglyphique (dont les alphabets sémitiques sont une simplification, puisqu'ils ne gardent que ses principes phonétiques), il y eut dès l'élaboration des premiers alphabets chez les peuples ouest-sémitiques des formes utilisant la graphie cunéiforme. La plus ancienne forme alphabétique est cependant linéaire selon toute vraisemblance, en tout cas c'est la plus anciennement attestée avec l'alphabet « proto-sinaïtique » (développé vers le XVIIe siècle av. J.-C.)[69].
L'alphabet ougaritique a été traduit dès l'entre-deux-guerres et est attesté par une documentation très abondante. C'est la mieux connue des toutes premières formes d'alphabet, mais on connaît en fait trois systèmes d'alphabet cunéiforme de la seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C. D'abord l'alphabet « long », qui est en fait l'alphabet ugaritique à proprement parler. Il est composé de trente signes et sert à noter la langue ougaritique dans divers types de textes attestés. Deux autres alphabets cunéiformes sont moins connus : un alphabet court de vingt-deux signes attesté par des tablettes d'Ougarit, un alphabet de type sud-arabique connu par des tablettes d'Ougarit et de Bet Shemesh en Israël[69].
Ces alphabets de type sémitique ne notent que les consonnes et semi-consonnes. À l'imitation de l'écriture cunéiforme syllabique, ils se lisent de gauche à droite et non de droite à gauche comme c'est le cas pour les autres alphabets sémitiques. L'alphabet long remonte au moins au XIVe siècle av. J.-C., et les dernières traces sont du début du XIIe siècle av. J.-C. Il reprend les principes de tous les alphabets ouest-sémitiques : écriture uniquement des consonnes et des semi-consonnes, et donc exclusion des voyelles. Il comprend vingt-sept signes (soit plus que les autres alphabets sémitiques qui en ont vingt-deux) ainsi que trois signes finaux. Des abécédaires montrent que ces signes avaient un ordre fixé. L'alphabet court présente quant à lui vingt-deux signes, comme l'alphabet phénicien ; il a peut-être une origine levantine extérieure à Ugarit. Il pourrait avoir été la matrice de l'alphabet long, qui en serait une variante locale d'Ougarit à laquelle les scribes de ce royaume auraient ajouté une poignée de signes[68].
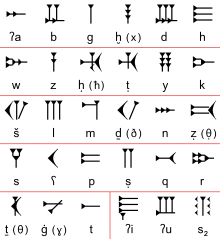
Le vieux perse cunéiforme
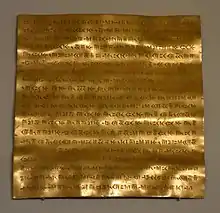
Le syllabaire vieux-perse fut manifestement élaboré sous le règne de Darius Ier, peut-être pour la rédaction de l'inscription de Behistun. Si ce fut la première écriture cunéiforme déchiffrée, c'est aussi la moins attestée puisqu'elle est restée cantonnée à la Perse achéménide. Elle est quasi exclusivement attestée par des inscriptions royales, sans doute pour donner une version « nationale » aux inscriptions que les rois achéménides faisaient inscrire en cunéiforme babylonien et élamite. Ce système est original, pouvant être défini comme un syllabaire ou bien un semi-alphabet. Il comporte 36 signes phonétiques, à savoir 3 voyelles pures (a, i et u), 22 signes pouvant avoir la valeur d'une consonne pure ou transcrire cette même consonne vocalisée en [a], 4 signes de consonnes vocalisées en [i] et 7 de consonnes vocalisées en [u]. À ces signes phonétiques s'ajoutent 8 logogrammes (pour « Roi », « Ahura Mazda », etc.) et un système numérique. Graphiquement, il se singularise par l'absence de clous croisés (sans doute parce que c'était plus pratique pour les inscriptions sur pierre auxquelles il était destiné)[72].
Pratiques du cunéiforme
Les documents cunéiformes : provenance et nature
Dès la fin du IIIe millénaire av. J.-C., l'écriture cunéiforme sert à noter une grande variété de textes sur différents supports[100].
La grosse majorité des textes est de type administratif, servant pour des opérations de comptabilité au jour le jour (notamment des entrées et sorties de produits) produisant une masse considérable de petites tablettes conservées sur un temps très court, mais aussi des bilans et des textes de prospective plus complexes, par exemple des documents cadastraux servant à estimer la récolte attendue des champs[101]. Il s'agit d'une documentation provenant essentiellement des institutions, notamment les palais et temples mésopotamiens.
- Exemples de textes de gestion.
 Tablette de distribution de ration, période d'Uruk récent (v. 3300-3100 av. J.-C.), provenance inconnue. British Museum.
Tablette de distribution de ration, période d'Uruk récent (v. 3300-3100 av. J.-C.), provenance inconnue. British Museum. « Badge » en argile d'identification d'un officier du royaume de Lagash, v. Musée du Louvre.
« Badge » en argile d'identification d'un officier du royaume de Lagash, v. Musée du Louvre. Tablette enregistrant les dépendants d'une institution. Tell Brak, période d'Akkad, v. 2250 av. J.-C. British Museum.
Tablette enregistrant les dépendants d'une institution. Tell Brak, période d'Akkad, v. 2250 av. J.-C. British Museum. Petite tablette administrative enregistrant un déplacement de bétail pour le compte d'un temple, Girsu, c. 2060 av. J.-C., Musée des beaux-arts de Lyon.
Petite tablette administrative enregistrant un déplacement de bétail pour le compte d'un temple, Girsu, c. 2060 av. J.-C., Musée des beaux-arts de Lyon. Tablette de type cadastral portant le plan d'un terrain en provenance d'Umma, troisième dynastie d'Ur XXIe siècle av. J.-C. Musée du Louvre.
Tablette de type cadastral portant le plan d'un terrain en provenance d'Umma, troisième dynastie d'Ur XXIe siècle av. J.-C. Musée du Louvre. Tablette administrative de la période paléo-babylonienne (v. 2000-1600 av. J.-C.). Musée de l'Oriental Institute de Chicago.
Tablette administrative de la période paléo-babylonienne (v. 2000-1600 av. J.-C.). Musée de l'Oriental Institute de Chicago. Compte des recettes et dépenses d'un convoi de marchandises, Kültepe, période paléo-assyrienne (XIXe siècle av. J.-C.). Metropolitan Museum of Art.
Compte des recettes et dépenses d'un convoi de marchandises, Kültepe, période paléo-assyrienne (XIXe siècle av. J.-C.). Metropolitan Museum of Art. Tablette provenant des archives administratives de l'Ebabbar, temple du dieu Shamash à Sippar, enregistrant des paiements en argent, durant le règne de Nabuchodonosor II (605–562 av. J.-C.). Metropolitan Museum of Art.
Tablette provenant des archives administratives de l'Ebabbar, temple du dieu Shamash à Sippar, enregistrant des paiements en argent, durant le règne de Nabuchodonosor II (605–562 av. J.-C.). Metropolitan Museum of Art. Tablette administrative en langue élamite provenant de l'archive des fortifications de Persépolis, v. 400 av. J.-C. Musée de Persépolis.
Tablette administrative en langue élamite provenant de l'archive des fortifications de Persépolis, v. 400 av. J.-C. Musée de Persépolis.
Un autre type de documentation de pratique très courante est constituée par les textes juridiques : contrats de vente, de location, de prêt, de mariage, d'adoption, etc. La preuve écrite était particulièrement importante en cas de litige, et c'est pour cela qu'on avait souvent recours à des pratiques d'authentification (généralement l'application d'un sceau) et parfois à des tablettes scellées : la tablette juridique était placée dans une enveloppe d'argile reproduisant son contenu, et en cas de soupçon d'altération de son contenu, on la brisait pour vérifier l'original[102]. Des comptes-rendus de procès sont également connus, ainsi que certains actes juridiques concernant des rois, notamment des traités de paix et des donations de terres.
- Exemples de textes juridiques.
 Plaque en pierre rapportant une vente de terre, avec un document complémentaire (« monuments Blau »), début du IIIe millénaire av. J.-C. British Museum.
Plaque en pierre rapportant une vente de terre, avec un document complémentaire (« monuments Blau »), début du IIIe millénaire av. J.-C. British Museum. Acte de vente d'une maison à Girsu inscrit sur un cône d'argile, Dynasties archaïques III B, v. 2400 av. J.-C. Musée du Louvre.
Acte de vente d'une maison à Girsu inscrit sur un cône d'argile, Dynasties archaïques III B, v. 2400 av. J.-C. Musée du Louvre. Reçu pour un prêt en argent, Kültepe, période paléo-assyrienne (XIXe siècle av. J.-C.). Metropolitan Museum of Art.
Reçu pour un prêt en argent, Kültepe, période paléo-assyrienne (XIXe siècle av. J.-C.). Metropolitan Museum of Art. Une tablette légale scellée, dans son enveloppe, provenant d'Alalakh, émise par le roi Niqmepa d'Alep. V. 1720 av. J.-C., British Museum.
Une tablette légale scellée, dans son enveloppe, provenant d'Alalakh, émise par le roi Niqmepa d'Alep. V. 1720 av. J.-C., British Museum.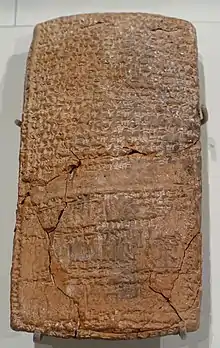 Tablette juridique de Nuzi, première moitié du XIVe siècle av. J.-C. : compte-rendu de procès. Musée de l'Oriental Institute de Chicago.
Tablette juridique de Nuzi, première moitié du XIVe siècle av. J.-C. : compte-rendu de procès. Musée de l'Oriental Institute de Chicago..jpg.webp) Tablette juridique hittite, provenant de Hattusa, XIIIe siècle av. J.-C. Musée de l'Oriental Institute de Chicago.
Tablette juridique hittite, provenant de Hattusa, XIIIe siècle av. J.-C. Musée de l'Oriental Institute de Chicago. Contrat au nom du roi Niqmepa d'Ugarit (v. 1315-1260 av. J.-C.), scellé avec la copie du sceau dynastique. Musée du Louvre.
Contrat au nom du roi Niqmepa d'Ugarit (v. 1315-1260 av. J.-C.), scellé avec la copie du sceau dynastique. Musée du Louvre. Vente de terres, pour payer un rançon. Babylonie, XIe siècle av. J.-C. British Museum.
Vente de terres, pour payer un rançon. Babylonie, XIe siècle av. J.-C. British Museum. Tablette relative à un litige juridique sur de l'orge, provenant d'Uruk et datée du règne de Nabonide (544 av. J.-C.). Musée de l'Oriental Institute de Chicago.
Tablette relative à un litige juridique sur de l'orge, provenant d'Uruk et datée du règne de Nabonide (544 av. J.-C.). Musée de l'Oriental Institute de Chicago.
La correspondance est aussi un genre courant, assez divers, comprenant des lettres diplomatiques échangées entre des rois, des lettres concernant l'administration de provinces tenues par des gouverneurs, ou encore de la correspondance entre marchands[103].
- Exemples de textes épistolaires.
 Lettre d'un marchand à un responsable de convoi, Kültepe, période paléo-assyrienne (XIXe siècle av. J.-C.). Metropolitan Museum of Art.
Lettre d'un marchand à un responsable de convoi, Kültepe, période paléo-assyrienne (XIXe siècle av. J.-C.). Metropolitan Museum of Art.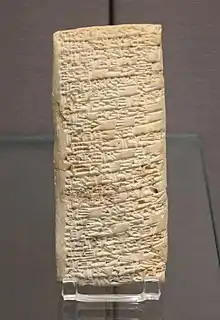 Lettre de plainte entre marchands, Ur, v. 1750 av. J.-C. British Museum.
Lettre de plainte entre marchands, Ur, v. 1750 av. J.-C. British Museum. Lettre adressée par le roi d'Alashiya (Chypre ?) au roi d'Égypte, retrouvée à el Amarna (EA 35), XIVe siècle av. J.-C. British Museum.
Lettre adressée par le roi d'Alashiya (Chypre ?) au roi d'Égypte, retrouvée à el Amarna (EA 35), XIVe siècle av. J.-C. British Museum.
L'apprentissage du cunéiforme est documenté par une masse assez importante de documents scolaires[104], qui sont par ailleurs la source principale pour la connaissance des textes littéraires, qui étaient copiés au cours du cursus[105].
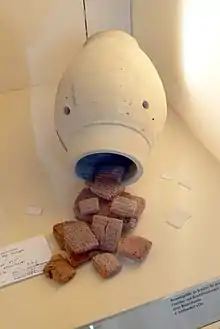
La plupart de ces tablettes sont connues par des fonds d'archives qui n'avaient pour but d'être conservés que sur un court laps de temps, les documents juridiques privés ayant sans doute pour finalité d'être archivés plus longtemps (jusqu'à échéance du contrat noté). S'ils ont été dégagés dans leur contexte primaire, c'est la plupart du temps parce que le site où ils se trouvaient a été détruit, notamment par le feu qui a permis la cuisson des tablettes d'argile et leur conservation plus longue. D'autres fois ils sont connus dans des contextes secondaires, parce qu'ils ont été mis au rebut dans un dépôt ou bien été utilisés pour renforcer des murs (qui étaient eux aussi en argile). Les lieux d'entreposage des documents archivés sont connus par quelques trouvailles archéologiques : des paniers ou des jarres à tablettes dont il reste des étiquettes enregistrant leur contenu et des étagères en bois ou en argile à Ebla et Sippar ; elles faisaient l'objet d'un classement qui a parfois pu être reconstitué[106] - [107].
Les textes issus de la production des « lettrés » qui ont attiré le plus l'intérêt des chercheurs et du public cultivé constituent une part limitée de la masse documentaire connue. Il s'agit en majorité de textes techniques servant pour des prêtres spécialisés (devins, exorcistes, lamentateurs notamment) dans l'exercice de leur fonction : divination, exorcisme, chants liturgiques et autres rituels religieux (notamment des déroulements de fêtes), médecine, mathématiques, mais aussi droit, chimie, etc[108] et les listes lexicales caractéristiques du milieu scolaire et intellectuel mésopotamien. Ils étaient conservés dans des fonds d'archives situés dans les résidences de ces prêtres spécialisés, ou bien dans des véritables bibliothèques de temple et de palais, surtout connues pour la Mésopotamie du Ier millénaire av. J.-C. (Ninive, Sippar), mais dont il y avait manifestement des équivalents dans des pays plus éloignés (notamment en pays hittite à Hattusa ou Sapinuwa, ou encore à Emar et Ugarit)[109].
- Exemples de textes rituels et savants.
 Tablette rapportant des oracles sur le vol et l'apparence des oiseaux, Ur, période paléo-babylonienne (v. 1900-1700 av. J.-C.). British Museum.
Tablette rapportant des oracles sur le vol et l'apparence des oiseaux, Ur, période paléo-babylonienne (v. 1900-1700 av. J.-C.). British Museum. Maquettes de foies d'animaux servant à l'exercice de la divination, XIXe et XVIIIe siècles av. J.-C., Mari, Musée du Louvre.
Maquettes de foies d'animaux servant à l'exercice de la divination, XIXe et XVIIIe siècles av. J.-C., Mari, Musée du Louvre. Tablette partiellement illustrée compilant des problèmes géométriques concernant des calculs de volumes, avec leur solution. Larsa, période paléo-babylonienne (v. 1900-1700 av. J.-C.). British Museum.
Tablette partiellement illustrée compilant des problèmes géométriques concernant des calculs de volumes, avec leur solution. Larsa, période paléo-babylonienne (v. 1900-1700 av. J.-C.). British Museum. Fragment de tablette rituelle hittite contenant la description d'un festival pour la déesse Teteshkhapi. Hattusa, XIVe siècle av. J.-C. Musée de l'Institut oriental de Chicago.
Fragment de tablette rituelle hittite contenant la description d'un festival pour la déesse Teteshkhapi. Hattusa, XIVe siècle av. J.-C. Musée de l'Institut oriental de Chicago. Tablette du « Manuel du devin », ouvrage divinatoire. Bibliothèque d'Assurbanipal de Ninive, VIIe siècle av. J.-C. British Museum.
Tablette du « Manuel du devin », ouvrage divinatoire. Bibliothèque d'Assurbanipal de Ninive, VIIe siècle av. J.-C. British Museum. Une tablette d'astronomie retrouvée dans la Bibliothèque d'Assurbanipal de Ninive (VIIe siècle av. J.-C.) : représentation de constellations. British Museum.
Une tablette d'astronomie retrouvée dans la Bibliothèque d'Assurbanipal de Ninive (VIIe siècle av. J.-C.) : représentation de constellations. British Museum. Amulette inscrite avec une incantation visant à repousser la démone Lamashtu, période néo-assyrienne (911-609 av. J.-C.), Museum zu Allerheiligen de Schaffhouse.
Amulette inscrite avec une incantation visant à repousser la démone Lamashtu, période néo-assyrienne (911-609 av. J.-C.), Museum zu Allerheiligen de Schaffhouse. Tablette d'exercice métrologique représentant une ziggurat. VIe – Ve sièclee av. J.-C., British Museum.
Tablette d'exercice métrologique représentant une ziggurat. VIe – Ve sièclee av. J.-C., British Museum. Seizième tablette de la liste lexicale HA.RA = hubullu sur les pierres et objets en pierre. Uruk, fin du Ier millénaire av. J.-C. Musée du Louvre.
Seizième tablette de la liste lexicale HA.RA = hubullu sur les pierres et objets en pierre. Uruk, fin du Ier millénaire av. J.-C. Musée du Louvre.
Quant aux œuvres dites « littéraires », genre plutôt défini du point de vue du moderne que de l'ancien, elles sont moins courantes : épopées, mythologie, historiographie, littérature sapientiale, hymnes, lamentations et poèmes, etc. ; certains ont une fonction rituelle (hymnes et poèmes, mythes qui en pays hittite sont souvent récités lors de fêtes), les autres ayant une fonction qui nous échappe[110] - [111].
- Exemples de textes « littéraires ».
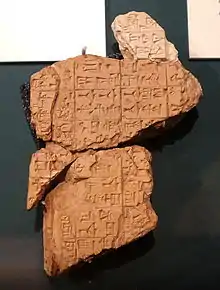 Fragment des Instructions de Shuruppak, texte sapiential, mis au jour à Adab (Bismaya),v. 2600-2500 av. J.-C.). Musée de l'Oriental Institute de Chicago.
Fragment des Instructions de Shuruppak, texte sapiential, mis au jour à Adab (Bismaya),v. 2600-2500 av. J.-C.). Musée de l'Oriental Institute de Chicago. Tablette d'époque paléo-babylonienne de la Lamentation sur la destruction d'Ur, Musée du Louvre.
Tablette d'époque paléo-babylonienne de la Lamentation sur la destruction d'Ur, Musée du Louvre. Tablette d'époque paléo-babylonienne (début du IIe millénaire av. J.-C.) relatant la légende de la naissance de Sargon. Musée du Louvre.
Tablette d'époque paléo-babylonienne (début du IIe millénaire av. J.-C.) relatant la légende de la naissance de Sargon. Musée du Louvre. Poème mythologique du cycle de Ba'al, Ba'al et la Mort. Ugarit, XIVe siècle av. J.-C. Musée du Louvre.
Poème mythologique du cycle de Ba'al, Ba'al et la Mort. Ugarit, XIVe siècle av. J.-C. Musée du Louvre. Copie de la version akkadienne du mythe de la Descente d'Ishtar aux Enfers, issue de la « Bibliothèque d'Assurbanipal » à Ninive, VIIe siècle av. J.-C. British Museum.
Copie de la version akkadienne du mythe de la Descente d'Ishtar aux Enfers, issue de la « Bibliothèque d'Assurbanipal » à Ninive, VIIe siècle av. J.-C. British Museum. Chronique synchrone (ou Histoire synchronique), texte historiographique. Ninive, VIIe siècle av. J.-C. British Museum.
Chronique synchrone (ou Histoire synchronique), texte historiographique. Ninive, VIIe siècle av. J.-C. British Museum. Tablette V de l’Épopée de Gilgamesh, époque néo-babylonienne (VIe siècle av. J.-C.). Musée de Sulaymaniyah.
Tablette V de l’Épopée de Gilgamesh, époque néo-babylonienne (VIe siècle av. J.-C.). Musée de Sulaymaniyah.
Un genre de texte important pour la reconstitution de l'histoire mésopotamienne est celui des textes commémoratifs, réalisés à l'instigation des souverains pour permettre à leur nom de subsister ou adresser un message aux dieux, et aussi à l'instigation de personnages de l'élite qui font des offrandes à des divinités. On avait donc rapidement saisi cette propriété de l'écrit qui est de permettre à des messages de traverser le temps, et ainsi d'asseoir le pouvoir symbolique des élites. En Mésopotamie, ce genre de texte est constitué par un nombre considérable de dédicaces inscrites sur des objets et surtout des inscriptions de fondation rappelant la construction d'un édifice par un souverain. Les inscriptions royales connaissent progressivement un développement qui en fait de véritables textes historiographiques (pouvant donc aussi rentrer dans la catégorie « littéraire »), relatant des événements (surtout militaires) du point de vue de leur commanditaire, dont on trouve les origines dans la Stèle des Vautours d'E-anatum de Lagash (c. 2450 av. J.-C.) et qui culmine dans le genre des annales royales assyriennes[112]. Des textes que l'on classe dans la catégorie juridique prennent aussi la forme d'inscriptions commémoratives : traités de paix hittites copiés sur des tablettes de métal, donations de terres inscrites sur des stèles (notamment les kudurrus babyloniens), ou le Code de Hammurabi, qui est en fait une longue inscription à la gloire du sens de la justice de ce roi. Les hymnes royaux entrent aussi dans cette catégorie. Pour passer à la postérité, ces textes sont inscrits de préférence sur des matériaux très résistants, le métal ou la pierre, mais ils nous sont souvent connus par des documents en argile, qu'il s'agisse d'un original ou d'une copie d'une inscription sur matériau plus « noble ».
- Exemples de textes commémorant des actes pieux.
 Vase en pierre inscrit voué par Aka-Enlil, chef des marchands. Nippur, temple d'Inanna, v. 2500 av. J.-C. Metropolitan Museum of Art.
Vase en pierre inscrit voué par Aka-Enlil, chef des marchands. Nippur, temple d'Inanna, v. 2500 av. J.-C. Metropolitan Museum of Art. Cylindres d'argile portant une inscription commémorant la restauration du temple du dieu Ningirsu, par le roi Gudea de Lagash. XXIIe siècle av. J.-C., musée du Louvre.
Cylindres d'argile portant une inscription commémorant la restauration du temple du dieu Ningirsu, par le roi Gudea de Lagash. XXIIe siècle av. J.-C., musée du Louvre. Perle en cornaline de forme allongée portant une inscription du roi Shulgi d'Ur (v. 2084-2047 av. J.-C.) la vouant à la déesse Ninlil. British Museum.
Perle en cornaline de forme allongée portant une inscription du roi Shulgi d'Ur (v. 2084-2047 av. J.-C.) la vouant à la déesse Ninlil. British Museum.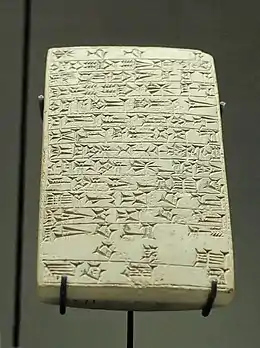 Tablette commémorant la fondation du temple de la déesse Nanaya, bâti par les rois Kudur-Mabuk et Rîm-Sîn de Larsa, fin du XIXe siècle av. J.-C. Musée du Louvre.
Tablette commémorant la fondation du temple de la déesse Nanaya, bâti par les rois Kudur-Mabuk et Rîm-Sîn de Larsa, fin du XIXe siècle av. J.-C. Musée du Louvre.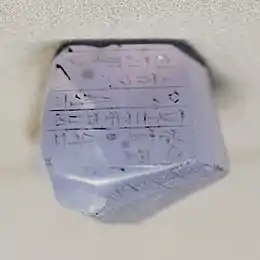 Bloc votif en calcédoine portant une inscription au nom du roi kassite Nazi-Maruttash (1307-1282 av. J.-C.). Musée du Louvre.
Bloc votif en calcédoine portant une inscription au nom du roi kassite Nazi-Maruttash (1307-1282 av. J.-C.). Musée du Louvre. Brique portant une inscription royale en élamite relative à la décoration en briques émaillées d'un temple de Suse entreprise par le roi élamite Shilhak-Inshushinak vers 1140 av. J.-C. Musée du Louvre.
Brique portant une inscription royale en élamite relative à la décoration en briques émaillées d'un temple de Suse entreprise par le roi élamite Shilhak-Inshushinak vers 1140 av. J.-C. Musée du Louvre. Bas-relief avec inscription sur stèle commémorant la réalisation et la consécration d'un statue du dieu-soleil Shamash commanditée par le roi babylonien Nabû-apla-iddina (888-855 av. J.-C.), à Sippar. British Museum.
Bas-relief avec inscription sur stèle commémorant la réalisation et la consécration d'un statue du dieu-soleil Shamash commanditée par le roi babylonien Nabû-apla-iddina (888-855 av. J.-C.), à Sippar. British Museum.
- Exemples d'autres textes commémoratifs officiels.
 Cône d'argile commémorant une victoire militaire du roi E-anatum de Lagash. V. 2340 av. J.-C., musée du Louvre.
Cône d'argile commémorant une victoire militaire du roi E-anatum de Lagash. V. 2340 av. J.-C., musée du Louvre. Inscription royale du roi Hammurabi de Babylone (v. 1792-1750 av. J.-C.), rédigée sur un cône d'argile, commémorant la reconstruction de la muraille de Sippar de Shamash. Musée du Louvre.
Inscription royale du roi Hammurabi de Babylone (v. 1792-1750 av. J.-C.), rédigée sur un cône d'argile, commémorant la reconstruction de la muraille de Sippar de Shamash. Musée du Louvre. Tablette en bronze sur laquelle est inscrit le traité de paix entre le roi hittite Tudhaliya IV et Kurunta de Tarhuntassa, XIIIe siècle av. J.-C., seul exemplaire de traité inscrit sur une tablette en métal qui nous soit parvenu, trouvé à Hattusa. Musée archéologique d'Ankara.
Tablette en bronze sur laquelle est inscrit le traité de paix entre le roi hittite Tudhaliya IV et Kurunta de Tarhuntassa, XIIIe siècle av. J.-C., seul exemplaire de traité inscrit sur une tablette en métal qui nous soit parvenu, trouvé à Hattusa. Musée archéologique d'Ankara. Tablette des Annales de Tukulti-Ninurta II (890-884 av. J.-C.) relatant une campagne menée contre l'Urartu. Musée du Louvre.
Tablette des Annales de Tukulti-Ninurta II (890-884 av. J.-C.) relatant une campagne menée contre l'Urartu. Musée du Louvre.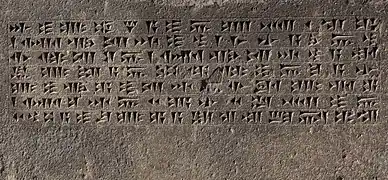

 Jarre inscrite au nom du roi perse achéménide Xerxès Ier (486–465 av. J.-C.), en cunéiformes akkadien, élamite et perse, et en hiéroglyphes égyptiens, trouvée dans le Mausolée d'Halicarnasse. Metropolitan Museum of Art.
Jarre inscrite au nom du roi perse achéménide Xerxès Ier (486–465 av. J.-C.), en cunéiformes akkadien, élamite et perse, et en hiéroglyphes égyptiens, trouvée dans le Mausolée d'Halicarnasse. Metropolitan Museum of Art.
Les scribes et l'apprentissage du cunéiforme

Les scribes, spécialistes de l'écriture, jouent un rôle-clé dans la société, même s'ils ne sont pas les détenteurs exclusifs du savoir de l'écriture. Ils ont reçu une formation plus ou moins poussée. Les apprentis scribes sont formés par des scribes plus expérimentés, qui sont assez souvent des membres de leur famille puisque ce métier se transmet de père en fils, conduisant souvent à la formation de dynasties de scribes. Les lieux d'apprentissage de l'écriture connus par les fouilles de sites mésopotamiens qui y ont dégagé des milliers de textes scolaires sont souvent des résidences privées. La formation de base consiste en l'apprentissage des signes et de textes simples, souvent à l'aide de listes lexicales, puis l'enseignement se complexifie par la suite avec la copie de textes de plus en plus compliqués. À partir d'un certain stade, le scribe peut se spécialiser dans un domaine précis, notamment l'étude de certains textes rituels, mais cela concerne manifestement un nombre limité de scribes, bien qu'on ne repère pas exactement une telle différenciation dans les formations des scribes avant le Ier millénaire av. J.-C.[113]
La fonction de scribe en elle-même n'induit pas de prestige particulier. Comme l'a laissé entrevoir l'étude des types de textes et de l'éducation, il s'agit en fait d’un milieu très hétérogène. À la base se trouvaient des scribes ayant reçu une instruction minimale, capables de rédiger les actes les plus simples de la vie courante, connaissant le nombre nécessaire de signes, sans plus. À un niveau supérieur, les palais et les temples emploient des scribes mieux formés pour les tâches les plus complexes de l’administration, et pour assurer la tâche de secrétaires des personnages les plus importants, si ceux-ci n'écrivent pas eux-mêmes. Les « lettrés » occupent quant à eux le haut de l'échelle des scribes, évoluant dans les temples les plus prestigieux et dans l’entourage du souverain. Ce sont souvent des membres du clergé (exorcistes, devins, etc.)[114].
Qui écrivait et lisait le cunéiforme ?
En définitive, quand on va au-delà du milieu des spécialistes qu'étaient les scribes et lettrés, il apparaît qu'une frange limitée de la population comprend ou écrit le cunéiforme, mais elle est plus étendue qu’on ne l’a longtemps pensé, comme l'ont récemment mis en avant les travaux de C. Wilcke[115] et D. Charpin[116]. Les souverains, administrateurs de grands organismes, ou des marchands ou gestionnaires d'un patrimoine foncier important devaient être initiés aux bases de l’écriture pour pouvoir exercer leur tâche, qui était facilitée par le recours à l'écrit, en leur évitant d'avoir à trop se reposer sur leurs scribes. Quelques femmes, essentiellement dans le milieu des palais et des temples, ont pu être lettrées voire scribes, même si ce métier est, en grande majorité, masculin[117]. Le système cunéiforme à dominante syllabique est certes plus complexe à apprendre et manier qu'un système alphabétique, mais pas autant qu’on le pense couramment[98]. On pouvait privilégier une écriture phonétique utilisant un nombre réduit de signes, avec quelques idéogrammes de base. Ainsi, les marchands paléo-assyriens s’en sortaient avec un minimum de 70 signes environ, et en général une centaine de signes devait suffire. De toute manière un système logographique et syllabique ne constitue pas un frein en soi à la diffusion de la pratique écrite, comme le prouve le taux d'alphabétisation du Japon actuel ; la question est bien plus sociale et culturelle que technique ou intellectuelle.
Styles et niveaux d'écriture

La formation des scribes dans un nombre limité d'établissements a facilement mené à la constitution de sortes d' « écoles » locales de scribes ayant les mêmes habitudes d'écriture. Celles-ci peuvent porter sur les signes employés : habitude d'utiliser un même corpus de signes, dans une même graphie, avec le ou les mêmes sens. Le système cunéiforme est donc adapté de façon relativement souple suivant les objectifs. Plus largement, c'est l'ensemble du formulaire des textes rédigés et leurs caractères diplomatiques internes comme externes qui sont déterminés par les habitudes des scribes, parfois influencées par le pouvoir politique qui entreprend de véritables réformes de l'écriture (comme sous l'Empire d'Akkad). On utilise un même type de tablette, on rédige les contrats de la même manière, en employant les mêmes expressions-clés quand il s’agit de textes stéréotypés[118]. Ce phénomène s'observe sur un même lieu, à une même période : les textes issus d'un même corpus documentaire se ressemblent beaucoup et, une fois initié aux habitudes des scribes, on comprend aisément le reste du corpus. Cela permet de regrouper des textes plus facilement (par exemple, s'ils sont issus de fouilles clandestines et vendus de façon dispersée), de les dater et les localiser. L'orthographe n'est cependant jamais strictement normalisée, et de ce fait il existe toujours des variations (souvent infimes) dans l'écriture d'un scribe à l'autre, même pour une période identique[47]. L'étude des habitudes des écoles de scribes permet aussi de repérer les foyers de diffusion de l'écriture cunéiforme : la ressemblance entre les premiers signes hittites et ceux de la Syrie de la période précédente permettent d'identifier celle-ci, notamment les cités du royaume d'Alep (le Yamkhad), comme l'origine du cunéiforme hittite. Cela résulte sans doute de la déportation de scribes syriens en Anatolie après les campagnes des premiers rois hittites contre Alep et ses vassales (dont Alalakh) à la fin du XVIIe siècle av. J.-C.[119]
Les pratiques et styles d'écriture varient également en fonction des types de documents et de leur fonction, délimitant ainsi plusieurs niveaux de maîtrise de la lecture et de l'écriture. N. Veldhuis en a ainsi distingué trois : un niveau « fonctionnel », nécessitant une connaissance simple du système d'écriture, permettant de lire les documents de la pratique (contrats, lettres, documents comptables) ; une connaissance « technique », spécialisée aux textes d'une discipline en particulier employant notamment de nombreux logogrammes spécifiques pour les termes techniques (une sorte de jargon disciplinaire connu des initiés), par exemple en mathématiques pour noter les opérateurs et les figures géométriques, ou en médecine pour les symptômes et remèdes ; enfin, le niveau supérieur est celui des lettrés, nécessitant une connaissance approfondie du système cunéiforme et de son développement historique en ayant une maîtrise de nombreux signes voire des jeux d'écriture[120].
L'écriture cunéiforme a ainsi la spécificité d'être un système d'écriture flexible pouvant se différencier selon l'utilisation que l'on veut en faire, ayant une capacité d'adaptation à différents contextes qui explique sans doute sa longévité. Les lettrés sont capables de rédiger des textes élaborés, utilisent souvent des signes et mots recherchés, dans une langue littéraire assez différente de celle que l'on retrouve dans les documents de la vie courante. Les inscriptions royales avaient régulièrement recours à un corpus de signes varié et archaïsant, gravés dans un style élégant, nécessitant de la part des scribes des connaissances paléographiques, travaillées par la copie d'inscriptions de jadis, et reflétant une volonté de s'ancrer dans un passé prestigieux : ainsi la stèle du Code de Hammurabi inscrite au XVIIIe siècle av. J.-C. emploie un style d'écriture cunéiforme des tablettes du XXIVe siècle av. J.-C.[121]. Les textes de la pratique sont quant à eux généralement écrits dans une langue plus simple et plus directe, les lettres ayant sans doute une proximité plus forte avec la langue parlée[122]. Les textes administratifs sont pour leur part souvent rédigés de façon simple, utilisant des idéogrammes servant de mots-clés (désignant les types de produits, quantités, le total), le souci de rapidité et d'efficacité incitant à éliminer les fioritures. Les scribes spécialisés dans leur rédaction auraient sans doute été bien en peine de lire des textes savants comprenant des signes et tournures variés et complexes.
Jeux d'écriture

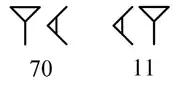
La différenciation entre plusieurs niveaux d'écriture a conduit les praticiens les plus raffinés à une approche ésotérique de l'écriture cunéiforme. Les signes pictographiques avaient perdu leur sens visuel originel depuis la cunéiformisation de l'écriture, interdisant des jeux visuels que l'on trouve dans les systèmes hiéroglyphiques, mais en revanche ils ont pu jouer sur la polysémie des signes et la possibilité de faire varier leur sens par le mouvement d'un clou. Cette tradition, développée sans doute assez tôt dans l'histoire mésopotamienne, s'est affirmée au Ier millénaire av. J.-C. dans une littérature de type ésotérique qui reste encore assez obscure, qui était peut-être une réaction à la diminution de l'usage courant du cunéiforme[124]. Les « commentaires » babyloniens de cette période représentent l'apogée de ces réflexions sur le sens pluriel des termes cunéiformes, donnant lieu à la réinterprétation des grands textes classiques de la littérature religieuse mésopotamienne. Par exemple, un manuel d'exorcisme qui décrit un mal touchant un patient dit qu'il est estropié, en sumérogramme BANZA ; le commentaire explique alors que ce terme peut être décomposé entre BAN « moitié » et ZA « homme » ; or « moitié » se transcrit aussi par le signe MAŠ, qui a pour autre valeur logographique le dieu Ninurta ; ce dernier est donc l'auteur du mal qui touche le patient, et doit être invoqué pour le guérir. Ce type de pratiques se retrouve plus tard dans la tradition ésotérique juive (Mishna, Kabbale)[125].
Les spéculations sur les signes cunéiformes portaient aussi sur les signes numériques qui avaient une charge symbolique dans la tradition mésopotamienne. À un niveau simple, on peut citer l'exemple de la malédiction qu'aurait jetée sur Babylone le dieu Marduk après sa destruction par le roi assyrien Sennachérib en Le dieu aurait prescrit de ne pas la restaurer pendant 70 (nombre rendu par un chevron suivi d'un clou vertical) années, mais on réduisit cette durée à 11 années en manipulant le signe par l'inversion de l'ordre de ses clous (11 s'écrivant par un clou vertical suivi d'un chevron), ce qui permit au roi Assarhaddon de reconstruire la cité. Un jeu plus complexe utilisait des signes numéraux pour rendre le nom de divinités : 10 désignait ainsi les divinités souveraines comme Enlil et Marduk, car le signe 10 (un chevron) signifiait aussi « Seigneur » dans une forme recherchée de sumérien (eme-sal). Ce jeu sur les chiffres a donné naissance à une véritable cryptographie attribuant notamment une valeur numérique aux noms de personnes, dont le sens n'est pas compris[126].
Épigraphie cunéiforme
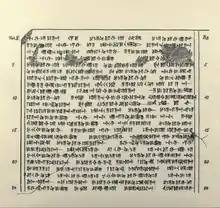
L'édition et la traduction de documents cunéiformes dans des langages actuels est le travail de base de la recherche en assyriologie, et dans les autres disciplines travaillant sur des textes cunéiformes, quelle que soit la langue traduite (sumérien, akkadien, élamite, hourrite, hittite pour les plus importantes). Ceci nécessite une technique précise, et il existe différentes conventions (plus ou moins rigides) régissant cette pratique.
Classement des signes
Les signes sont numérotés selon un ordre codifié, selon leur aspect graphique[127]. Le premier groupe est celui des signes commençant par un clou horizontal, le signe numéro 1 étant le simple trait horizontal (le son [aš]). Vient ensuite le groupe des signes commençant par un clou oblique, puis termine celui des signes commençant par un trait vertical. La numérotation des signes à l'intérieur d'un même groupe se fait selon le nombre de symboles par lesquels le signe commence, et toujours en plaçant les horizontaux en premier, suivis des obliques puis des verticaux. Ainsi, après les signes débutant par un trait horizontal viennent ceux constitués de deux traits horizontaux, puis de trois, etc. Le classement se fait ensuite par les signes suivant le premier rang, toujours selon le même principe. Il n'existe cependant pas de classement faisant consensus : les deux principaux sont ceux des deux manuels d'épigraphie cunéiforme les plus utilisés, effectués par René Labat[128] et Rykle Borger[129].
Homophonie
Quand un son peut être marqué par plusieurs signes, on emploie un système facilitant leur différenciation en les numérotant, mis au point par François Thureau-Dangin[130]. Par exemple, pour le son [du], qui a une vingtaine de valeurs, on écrit les différents signes valant pour ce son : du (du1), dú (du2), dù (du3), du4, du5, du6, etc. jusqu'à du23.
Différenciation des signes selon leur type
Quand les textes comportent des signes qui ont des fonctions différentes, phonogrammes ou logogrammes, il importe de les différencier pour rendre la transcription plus intelligible et ainsi restituer l'étape nécessaire de l'identification des types de signes pouvant constituer un texte (phonogrammes, logogrammes, déterminatifs, compléments phonétiques et signes numériques). Il n'y a pas de conventions figées sur ce point. Les phonogrammes sont généralement rendus par des minuscules. Ceux qui constituent un même mot sont reliés par des tirets (a-wi-lum = awīlum, « homme », « quelqu'un » en akkadien) ; parfois le mot en entier apparaît pour se rapprocher de la prononciation. Dans un texte en akkadien, il est courant de faire apparaître les logogrammes sumériens en les écrivant en capitales[131]. Cette pratique est souvent reprise pour la transcription des autres langues. Dans le cas du hittite qui comporte aussi des akkadogrammes (mots akkadiens ayant une fonction de logogrammes), ces derniers sont notés par des lettres capitales en italique[132]. Les logogrammes peuvent éventuellement être rendus par la suite dans la langue dominante du texte, c'est-à-dire de la façon dont ils étaient réellement lus. Quant aux déterminatifs, ils sont mis en exposant, devant ou derrière le mot auquel ils sont rattachés, selon qu'ils sont antéposés ou postposés.
Étapes de la traduction d'un texte
Par convention, et comme il est courant en épigraphie, la traduction d'un texte cunéiforme dans une publication scientifique se présente en plusieurs étapes[133] - [131]. Les noms des étapes peuvent varier selon les cas, et certaines comme l'édition du document original peuvent être éliminées. Ces étapes reprennent en gros les étapes nécessaires au déchiffrement d'un document écrit en cunéiforme, à savoir l'identification des signes, l'attribution de leur valeur, l'identification des mots, de la ou des langues parlées, la tentative de reconstitution des signes manquant sur les tablettes abîmées comportant des lacunes (c'est-à-dire la grande majorité), puis enfin la traduction. On note toujours le numéro des lignes du texte étudié, et on conserve l'ordre d'origine des mots, sauf pour la traduction finale :
- On reproduit le texte cunéiforme étudié, avec une représentation la plus fidèle possible, parfois une photographie du document, plus souvent un dessin, ou les deux. Cela permet aux lecteurs d'avoir accès à l'original afin de permettre notamment de vérifier la validité des étapes menant à la traduction. Cette étape suppose déjà un travail d'interprétation des signes, notamment si ceux-ci sont difficiles à lire sur la tablette ou incomplets car le document est fragmenté.
- Translittération et transcription : il s'agit de la phase qui assure le passage du cunéiforme à un alphabet moderne. Les signes antiques sont transcrits dans un alphabet contemporain, mais il ne s'agit pas de rechercher directement leur prononciation, car on préserve la différenciation des signes, qui sont notés suivant la valeur qu'ils ont dans le document (phonogrammes, logogrammes, déterminatifs, signes numériques). À la suite de Thureau-Dangin, on privilégie une écriture des signes phonétiques pour leur valeur dans la phrase, et non pour leur valeur de base (approche de Gelb). Les mots sont généralement mis en évidence par des tirets reliant les signes qui les composent, ce qui permet de les isoler des autres mots du texte. La transcription, pas toujours effectuée, vise à réaliser la restitution phonétique supposée du texte dans la langue dans laquelle il était prononcé : les mots sont transcrits complètement, les logogrammes étant remplacés par les mots équivalents dans la langue du texte, les déterminatifs disparaissent.
- La traduction : le texte est traduit dans une langue contemporaine, étape finale et nécessaire de l'édition de la tablette. Si la tablette est dans un état trop fragmentaire pour être compréhensible, cette étape peut être éliminée.
Deux exemples
Un premier exemple est une courte inscription de fondation, type de texte courant en Mésopotamie qui commémore la construction ou la restauration d'un édifice par un roi. Celle-ci est rédigée en sumérien et rapporte des travaux entrepris par le roi Ur-Nammu (2112-2094 av. J.-C.), fondateur de la Troisième dynastie d'Ur, dans l'Eanna, le grand temple de la déesse Inanna à Uruk, un des principaux sanctuaires mésopotamiens. La graphie des signes des inscriptions commémoratives de cette période est devenue cunéiforme, à l'imitation des signes sur tablettes d'argile qui sont devenus le modèle à suivre, alors qu'elle a longtemps hésité entre clous et traits simples. Les particules grammaticales sont notées. Le sens de lecture originel de ce texte (et du suivant) est sans doute vertical, mais il est ici présenté pour une lecture horizontale de gauche à droite comme cela est courant dans les publications assyriologiques et dans les musées ; pour retrouver le sens de lecture de son époque de rédaction, il faudrait faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
 |
1Dinanna 2nin-é-an-na 3nin-a-ni 4ur-Dnammu 5nita-kala-ga 6lugal-uri5ki-ma 7lugal-ki-en-gi-ki-uri-ke4 Revers de la tablette, hors photo : 8é-a-ni 9mu-na-dù 10ki-bé mu-na-gi4 Les signes cunéiformes sont remplacés par leur notation en alphabet latin suivant les conventions des assyriologues. Les signes ayant une valeur phonétique sont en minuscules et les déterminatifs sont en exposant (d précédant les noms de divinités et ki suivant les noms de lieux).
« Pour la déesse Inanna, Dame de l'Eanna, sa dame, Ur-Nammu, mâle puissant, roi d'Ur, roi des pays de Sumer et d'Akkad, a construit et restauré son temple pour elle[134]. » |
Le second exemple est une des « lois » (l'« article » 165) du fameux Code de Hammurabi, rédigé au XVIIIe siècle av. J.-C. et connu principalement par une stèle en basalte retrouvée à Suse. Le texte est en akkadien (dialecte paléo-babylonien) avec quelques logogrammes sumériens. Si la langue est simple, la forme des signes gravés dans la stèle se veut élégante, archaïsante, inspirée de l'écriture des textes sur tablettes du XXIVe siècle av. J.-C. ou des inscriptions des rois d'Ur III comme celle présentée ci-dessus. Comme pour le texte précédent le sens de lecture originel est vertical, et c'est d'ailleurs ainsi qu'il est sur la stèle, l'image ayant été pivotée de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 |
1šum-ma a-wi-lum 2a-na IBILA-šu 3ša i-in-šu mah-ru 4A.ŠÀ KIRI6 ù É 5iš-ru-uk 6ku-nu-kam iš-ṭur-šum 7wa-ar-ka a-bu-um 8a-na ši-im-tim 9it-ta-al-ku 10i-nu-ma ah-hu 11i-zu-uz-zu 12qí-iš-ti a-bu-um 13id-di-nu-šum 14i-le-qé-ma 15e-le-nu-um-ma 16i-na NÍG.GA É A.BA 17mi-it-ha-ar-iš 18i-zu-uz-zu Les signes cunéiformes sont remplacés par leur notation en alphabet latin suivant les conventions des assyriologues. Les signes ayant une valeur phonétique sont en minuscules et les idéogrammes sumériens sont en petites capitales (A.ŠÀ). Les signes composant un même mot sont reliés par des tirets (a-wi-lum).
šumma awīlum ana aplušu ša īnšu mahru eqlam kirâm u bītam išruk kunukkam išṭuršum warka abum ana šimtim ittalku inūma ahhu izuzzu qīšti abum iddinušum ileqqema elenumma ina makkūr bīt abim mithāris izuzzu On restitue ici la prononciation des mots en akkadien, les mots sont donc complets (a-wi-lum = awīlum) et les idéogrammes remplacés par leur prononciation supposée ; par exemple l'idéogramme sumérien A.ŠÀ, « champ », se dit eqlum en akkadien et est ici à l'accusatif eqlam. La transcription des mots suit les conventions adoptées par les assyriologues et généralement reprises des transcriptions des langues sémitiques en alphabet latin : le u se prononce [u], le š équivaut au son [ʃ], deux types de voyelles allongées surmontées par un accent circonflexe et un macron.
« Si quelqu’un a fait cadeau d’un champ, d’un verger ou d’une maison à un sien fils héritier qu’il voyait d’un bon œil et lui a rédigé (à ce sujet) un document scellé, après que le père sera allé au destin (sera mort), quand les frères feront le partage, il prendra le cadeau que le père lui a fait et là-dessus ils partageront à parts égales les biens du patrimoine paternel[135]. » |
Notes et références
Notes
Références
- M. Sauvage, « Roseau », dans Joannès (dir.) 2001, p. 735-736 ; Id., « Matériaux de construction », dans Joannès (dir.) 2001, p. 507-509 ; F. Joannès et B. Lyonnet, « Vases et récipient », dans Joannès (dir.) 2001, p. 901-905.
- Walker 1994, p. 47-49 ; X. Faivre, « Tablette », dans Joannès (dir.) 2001, p. 829-831 ; Charpin 2008, p. 98-101. Glassner 2000, p. 146-157 pour une discussion sur les origines de la tablette.
- Glassner 2000, p. 157-159 ; Walker 1994, p. 49-50 (où le terme « poinçon » est utilisé). En pays hittite on trouve la variante « roseau de la maison des tablettes », GI É.DUB.BA ou GI É ṬUPPI (Van den Hout 2011, p. 49-51).
- Glassner 2000, p. 35.
- Charpin 2008, p. 20.
- X. Faivre, « Tablette », dans Joannès (dir.) 2001, p. 830.
- Charpin 2008, p. 101-102 ; Van den Hout 2011, p. 53-56.
- X. Faivre, « lapicide », dans Joannès (dir.) 2001, p. 465-466.
- Charpin 2008, p. 237.
- L'histoire de cette découverte est racontée dans : Régis Pluchet, L'extraordinaire voyage d'un botaniste en Perse. André Michaux : 1782-1785, éditions Privat, 2014.
- Garelli 1990, p. 18-19 ; Bottéro et Stève 1993, p. 16-19. (en) Peter T. Daniels, « The Decipherment of Ancient Near Eastern Languages », dans Rebecca Hasselbach‐Andee (dir.), A Companion to Ancient Near Eastern languages, Hoboken, Wiley-Blackwell, , p. 10-11.
- (en) P. T. Daniels, « Methods of decipherments », dans P. T. Daniels et W. Bright (dir.), The Wolrd's Writing Systems, Oxford, 1996, p. 141-159.
- Bottéro 1997, p. 111-115 ; F. Joannès et G. Tolini, « L'alphabet vieux-perse », dans Lion et Michel (dir.) 2008, p. 66-71.
- (en) A. H. Sayce, The Archaeology of the Cuneiform Inscriptions, Cambridge, 1907, p. 13 n. 1.
- (en) J. Lendering, « The Behistun inscription: Discovery of the monuments », sur Livius (consulté le ).
- (en) K. J. Cathcart, « The Earliest Contributions to the Decipherment of Sumerian and Akkadian », sur Cuneiform Digital Library Journal 2011:1 (consulté le ).
- Garelli 1990, p. 8-9 ; F. Joannès et G. Tolini, « L'alphabet vieux-perse », dans Lion et Michel (dir.) 2008, p. 71-80.
- Garelli 1990, p. 9-11.
- Bottéro 1997, p. 118-122. Voir aussi B. Lion et C. Michel, « Jules Oppert et le syllabaire akkadien », dans Lion et Michel (dir.) 2008, p. 81-94 ; A. Tenu, « Les déchiffreurs britanniques du syllabaire akkadien », dans Lion et Michel (dir.) 2008, p. 95-110.
- Bottéro 1997, p. 122-124. Ph. Abrahami, « Un système d'idéogrammes : « sumérien ou rien » ? », dans Lion et Michel (dir.) 2008, p. 111-128.
- Bottéro 1997, p. 125-127. A. Mouton, « Cunéiformes et hiéroglyphes chez les Hittites », dans Lion et Michel (dir.) 2008, p. 142-146.
- (en) K. J. Cathcart, « The Decipherment of Ugaritic », dans Watson et Wyatt (dir.) 1999, p. 76-80 ; P. Bordreuil, « L'alphabet ougaritique », dans Lion et Michel (dir.) 2008, p. 129-138.
- Woods 2020, p. 32
- Cf. les critiques rassemblées par Glassner 2000, p. 87-112.
- (en) R. K. Englund, « Texts from the Late Uruk Period », dans J. Bauer, R. K. Englund et M. Krebernik (dir.), Mesopotamien, Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit, Fribourg et Göttingen, 1998, p. 42-55. Woods 2020, p. 28-31.
- Glassner 2000, p. 113-137 et 279-293 ; (en) C. Woods dans Woods (dir.) 2010, p. 43-45.
- (en) R. K. Englund, « The Smell of the Cage », Cuneiform Digital Library Journal, no 2009:4, (lire en ligne), en particulier note 18.
- « (en) Tablette W 5233,a/VAT 15245 : description sur CDLI. ».
- Bottéro 1997, p. 145-153 ; B. Lion et C. Michel, « Pictogramme », dans Joannès (dir.) 2001, p. 652 ; (en) C. Woods dans Woods (dir.) 2010, p. 49-50.
- Garelli 1990, p. 12.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 5-7 ; Bord et Mugnaioni 2002, p. 15.
- Bertrand Lafont, « Uruk et la révolution urbaine (3500-2900) », dans Bertrand Lafont, Aline Tenu, Philippe Clancier et Francis Joannès, Mésopotamie : De Gilgamesh à Artaban (3300-120 av. J.-C.), Paris, Belin, coll. « Mondes anciens », , p. 71-79.
- Woods 2020, p. 43-44.
- Walker 1994, p. 32-35.
- Bord et Mugnaioni 2002, p. 16-17.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 7-8 ; Bottéro 1997, p. 153-161 ; Durand 2001, p. 26-28 ; Bord et Mugnaioni 2002, p. 17.
- (en) P. Michalowski, « Sumerian », dans Woodard (dir.) 2008, p. 25-27.
- Durand 2001, p. 28-29 ; (en) J. Huehnergard et C. Woods, « Akkadian and Eblaite », dans Woodard (dir.) 2004, p. 218-230 ; (en) A. Seri, « Adaptation of Cuneiform to Write Akkadian », dans Woods (dir.) 2010, p. 86-93.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 140-141.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 11-16.
- Walker 1994, p. 38-40 ; Labat et Malbran-Labat 1988, p. 8-11 ; (en) J. Huehnergard et C. Woods, « Akkadian and Eblaite », dans Woodard (dir.) 2004, p. 227-229 ; R. Mugnaioni, « L'akkadien », dans E. Bonvini, J. Busuttil et A. Peyraube (dir.), Dictionnaire des langues, Paris, 2011, p. 293-294.
- Durand 2001, p. 29-31.
- (en) H. J. Nissen, « The Development of Cuneiform Script », dans H. J. Nissen, P. Damerow et R. K. Englund, Archaic Bookkeeping: Writing and Techniques of Economic Administration in the Ancient Near East, Chicago et Londres, 1993, p. 116-124.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 2-4 ; (en) C. Woods, « The Earliest Mesopotamian Writing », dans Woods (dir.) 2010, p. 36-38.
- B. André-Leickman dans André-Leickman et Ziegler (dir.) 1982, p. 75-81.
- Walker 1994, p. 35-37. (en) B. Studevent-Hickman, « The Ninety Degree Rotation of the Cuneiform Script », dans J. Cheng et M. H. Feldman (dir.), Ancient Near Eastern Art in Context, Studies in Honor of Irene J. Winter by Her Students, Leyde et Boston, 2007, p. 485-513.
- Charpin 2008, p. 21.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 4-5 ; Walker 1994, p. 40-43.
- P. Villard, « Néo-assyrien », dans Joannès (dir.) 2001, p. 563.
- (en) J. N. Postgate, Early Mesopotamia, Society and Economy at the Dawn of History, Londres et New York, 1992, p. 66-70 ; B. Lafont, « Sumer, II. La société sumérienne - 1. Institutions, économie et société », dans Supplément au Dictionnaire de la Bible fasc. 72, 1999, col. 139-149.
- (en) N. Veldhuis, « Levels of Literacy », dans Radner et Robson (dir.) 2011, p. 71-73.
- Peut-être dès 2600 av. J.-C. en Haute Mésopotamie, cf. (en) P. Quenet, « The Diffusion of the Cuneiform Writing System in Northern Mesopotamia: The Earliest Archaeological Evidence », dans Iraq 67/2, 2005, p. 31-40.
- Voir dernièrement (en) P. Michalovski, « The Lives of the Sumerian Language », dans Sanders (dir.) 2005, p. 173-177 pour une datation haute et (en) C. Woods, « Bilingual, Scribal Learning and the Death of Sumerian », dans Sanders (dir.) 2005, p. 91-120 pour une datation basse.
- Cf. les parties sur les écritures cunéiformes dans les différentes contributions des écritures notant les différentes langues du Proche-Orient ancien traitées dans Woodard (dir.) 2004 citées par la suite.
- Sur ce sujet abondamment traité, voir par exemple (en) G. Beckman, « Mesopotamians and Mesopotamian Learning at Hattuša », dans Journal of Cuneiform Studies 35, 1983, p. 97-114 ; (en) P. Artzi, « Studies in the library of the Amarna Archive », dans J. Klein et A. Skaist (dir.), Bar-Ilan Studies in Assyriology dedicated to P. Artzi, Bar-Ilan, 1990, p. 139-156 ; (en) Y. Cohen, « Kidin-Gula – The Foreign Teacher at the Emar Scribal School », dans Revue d'assyriologie 98, 2004, p. 81-100 ; (en) W. H. Van Soldt, « The Role of Babylon in Western Peripheral Education », dans E. Cancik-Kirschbaum, M. van Ess et J. Marzahn (dir.), Babylon, Wissenkultur in Orient und Okzident, Berlin, 2011, p. 197-211.
- Présentations synthétiques utiles de l'extension géographique du cunéiforme dans André-Leickman et Ziegler (dir.) 1982, p. 100-116 et Walker 1994, p. 71-80.
- (en) E. Porada, « The Cylinder Seals found at Thebes in Boeotia », dans Archiv fur Orientforschung 28, 1981-1982, p. 1-70 ; (en) C. Cohen, J. Maran et M. Vetters, « An Ivory Rod with a Cuneiform Inscription, Most Probably Ugaritic, From a Final Palatial Workshop in the Lower Citadel of Tiryns », dans Archäologischer Anzeiger 2010/2, 2011, p. 1-22.
- Une inscription cunéiforme de la même période aurait également été mise au jour à Malte dernièrement : (en) « Rare Cuneiform Script Found on Island of Malta », sur Biblical Archaeology Society, .
- (en) M. W. Stolper, « Elamite », dans Woodard (dir.) 2004, p. 62-69 et Stève 1992.
- (en) G. Wilhelm, « Hurrian », dans Woodard (dir.) 2004, p. 96-98.
- (en) A. George et M. Krebernik, « Two Remarkable Vocabularies: Amorite-Akkadian Bilinguals! », dans Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 116, 2022, p. 113-166. https://doi.org/10.3917/assy.116.0113
- (en) T. P. J. van den Hout, « The Rise and Fall of Cuneiform Script in Hittite Anatolia », dans Woods (dir.) 2010, p. 99-106. (en) Id., « The Ductus of the Alalah VII texts and the Origin of Hittite Cuneiform », dans E. Devecchi (dir.), Paleography and Scribal Practices in Syro-Palestine and Anatolia in the Late Bronze Age, Leyde, 2012, p. 147-170.
- (en) C. Watkins, « Hittite », dans Woodard (dir.) 2004, p. 552-555 et Rüster et Neu 1989. (en) M. Weeden, « Adapting to New Contexts: Cuneiform in Anatolia », dans Radner et Robson (dir.) 2011, p. 597-617. O. Popova, « L'introduction de l'écriture cunéiforme chez les Hittites au IIe millénaire av. J.-C. », dans D. Briquel et F. Briquel Chatonnet (dir.), Écriture et communication, Paris, 2015, p. 35-45 lire en ligne.
- (en) H. C. Melchert, « Luvian », dans Woodard (dir.) 2004, p. 576-577.
- (en) H. C. Melchert, « Palaic », dans Woodard (dir.) 2004, p. 585-586.
- (en) D. Pardee, « Canaanite », dans Woodard (dir.) 2004, p. 386-390 ; (en) S. Izre'el, Canaano-Akkadian, Munich, 2005.
- (de) G. Wilhelm, Untersuchungen zum Hurro-Akkadischen von Nuzi, Neukirchen-Vluyn, 1970.
- (en) D. Pardee, « Ugaritic », dans Woodard (dir.) 2004, p. 289-291 ; (en) M. Dietrich et O. Loretz, « The Ugaritic Script », dans Watson et Wyatt (dir.) 1999, p. 81-89.
- (en) J. Lam, « Invention and Development of the Alphabet », dans Woods (dir.) 2010, p. 189-195.
- (en) G. Wilhelm, « Urartian », dans Woodard (dir.) 2004, p. 119-121 et (en) P. Zimansky, « Writing, Writers, and Reading in the Kingdom of Van », dans Sanders (dir.) 2005, p. 257-276.
- (en) M. W. Stolper, « Elamite », dans Woodard (dir.) 2004, p. 63-64.
- (en) R. Schmidt, « Old Persian », dans Woodard (dir.) 2004, p. 718-723 ; F. Joannès et G. Tolini, « L'alphabet vieux-perse », dans Lion et Michel (dir.) 2008, p. 72-73.
- Sur le dernier état de la culture mésopotamienne antique, voir notamment (en) P.-A. Beaulieu, « Late Babylonian Intellectual Life », dans G. Leick (dir.), The Babylonian World, Londres et New York, 2007, p. 473-484 ; (en) P. Clancier, « Cuneiform Culture’s Last Guardians: the Old Urban Notability of Hellenistic Uruk », dans Radner et Robson (dir.) 2011, p. 752-773.
- Durand 2001, p. 29.
- J.-M. Durand, « Mésopotamie cunéiforme », dans J. Servier (dir.), Dictionnaire critique de l'ésotérisme, Paris, 1998, p. 833-834.
- (en) A. J. Sachs, « The Latest Datable Cuneiform Tablets », dans B. L. Eicher, Kramer Aniversary Volume: cuneiform studies in honor of Samuel Noah Kramer, Neukirschen, 1976, p. 379-398.
- (en) H. Hunger et T. de Jong, « Almanac W22340a From Uruk: The Latest Datable Cuneiform Tablet », dans Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie 104/2, 2014, p. 182–194.
- (en) M. J. Geller, « The Last Wedge », dans Zeitschrift für Assyriologie 87, 1997, p. 43-95 ; (en) D. Brown, « Increasingly redundant: the growing obsolence of the cuneiform script in Babylonia from 539 BC », dans J. Baines, J. Bennet et S. Houston (dir.), The Disappearance of Writing Systems, Perspectives on Literacy and Communication, Londres, 2008, p. 73-102 ; (en) J. Cooper, « Redundancy reconsidered: reflections on David Brown's thesis' », dans J. Baines, J. Bennet et S. Houston (dir.), op. cit., p. 103-108.
- Rüster et Neu 1989, p. 378.
- Woods 2020, p. 39-41
- (en) G. Wilhelm, « Hurrian », dans Woodard (dir.) 2004, p. 98-99 ; (en) Id., « Urartian », dans Woodard (dir.) 2004, p. 121-122.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 18-19.
- (en) C. Watkins, « Hittite », dans Woodard (dir.) 2004, p. 557.
- Cf. les passages sur la phonologie de ces différentes langues du Proche-Orient ancien traitées dans Woodard (dir.) 2004. Voir aussi (en) D. O. Edzard, Sumerian Grammar, Leyde et Boston, 2003, p. 7-22.
- Labat et Malbran-Labat 2002, p. 19-20 ; B. Lion et C. Michel, « Idéogramme », dans Joannès (dir.) 2001, p. 404-405. Woods 2020, p. 36-38
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 96-97.
- Rüster et Neu 1989, p. 362-369.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 20-22. Woods 2020, p. 42
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 184-185 ; Rüster et Neu 1989, p. 260-261.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 22-23.
- Walker 1994, p. 44-45 ; C. Michel, « Nombres », dans Joannès (dir.) 2001, p. 590-591 ; « C. Proust, « La numération sexagésimale positionnelle », CultureMATH (consulté le 12-12-2011). ».
- C. Michel et J. Ritter, « Poids et mesures », dans Joannès (dir.) 2001, p. 663-665 ; « C. Proust, « Systèmes métrologiques », CultureMATH (consulté le 12-12-2011). ».
- Charpin 2008, p. 108-111 pour une description des possibilités de « mise en page » des tablettes cunéiformes. Voir aussi Van den Hout 2011, p. 51-52 pour le cas de l'Anatolie hittite.
- Walker 1994, p. 50.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 24-26.
- Pour donner un ordre d'idée Labat et Malbran-Labat 1988 indique environ 600 signes différents ayant plus de 3 000 valeurs possibles, toutes périodes confondues, un tel degré de complexité n'ayant jamais été atteint dans les faits.
- Selon l'interprétation de l'éditeur du texte : (en) H. Radau, Letters to the Cassite Kings from the Temple Archives of Nippur (BE XVII), Philadelphie, , p. 142.
- Charpin 2008, p. 52-54.
- (en) J. Cooper, « Babylonian beginnings: the origin of the cuneiform writing system in comparative perspective », dans S. D. Houston (dir.), The First Writing: Script Invention as History and Process, Cambridge, 2004, p. 90-92.
- Ce qui suit s'appuie avant tout sur les données issues des fouilles de sites mésopotamiens, qui présentent la plus grande variété de textes connus. Pour Ugarit voir les différentes contributions de Watson et Wyatt (dir.) 1999 qui sont consacrées aux types de textes exhumés sur ce site ; pour l'Anatolie hittite voir Van den Hout 2011, p. 57-66 et la bibliographie citée, ainsi que p. 69-79 pour les méthodes d'archivage.
- B. Lafont, « Cadastre et arpentage », dans Joannès (dir.) 2001, p. 149-151.
- S. Lafont, « Contrats », dans Joannès (dir.) 2001, p. 201-202 ; Charpin 2008, p. 131-158.
- N. Ziegler, « Correspondance », dans Joannès (dir.) 2001, p. 202-205 ; Charpin 2008, p. 161-192.
- J. Ritter, « Textes scolaires », dans Joannès (dir.) 2001, p. 843-845.
- Charpin 2008, p. 201.
- Sur cette question de l'archivage, voir F. Joannès, « Archives », dans Joannès (dir.) 2001, p. 71-74 ; Charpin 2008, p. 117-127.
- Exemples de textes de la vie courante dans André-Leickman et Ziegler (dir.) 1982, p. 206-216.
- J. Ritter, « Textes techniques », dans Joannès (dir.) 2001, p. 845-847. André-Leickman et Ziegler (dir.) 1982, p. 235-257.
- F. Joannès, « Bibliothèques », dans Joannès (dir.) 2001, p. 125-128 ; Charpin 2008, p. 193-228.
- Charpin 2008, p. 201-225
- Par exemple sur les finalités des textes littéraires et plus particulièrement épiques et mythologiques dans le contexte mésopotamien : (en) A. R. George, « The Epic of Gilgamesh: Thoughts on genre and meaning », dans J. Azize et N. Weeks (dir.), Gilgamesh and the World of Assyria, Louvain, 2007, p. 41-42 ; (en) F. van Koppen, « The Scribe of the Flood Story and his Circle », dans Radner et Robson (dir.) 2011, p. 140-166.
- Walker 1994, p. 56-60 ; B. Lafont, « Inscriptions royales », dans Joannès (dir.) 2001, p. 410-412 ; C. Michel, « Documents de fondation », dans Joannès (dir.) 2001, p. 245 ; Charpin 2008, p. 229-256. Exemples dans André-Leickman et Ziegler (dir.) 1982, p. 196-205 et 224-235.
- Charpin 2008, p. 61-95. Pour la situation en dehors du monde mésopotamien, qui reste assez mal connue en dehors de la période du Bronze récent, mais semble peu différer du modèle original, voir par exemple : (en) M. Civil, « The Texts from Meskene-Emar », dans Aula Orientalis 7, 1989, p. 5-25 ; (en) A. Demsky, « The Education of canaanite scribes in the Mesopotamian Cuneiform Tradition », dans J. Klein et A. Skaist (dir.), Bar-Ilan Studies in Assyriology dedicated to P. Artzi, Bar-Ilan, 1990, p. 157-170 ; (en) W. H. Van Soldt, « Babylonian lexical, religious and literary texts and scribal education at Ugarit and its implications for the alphabetic literary texts », dans M. Dietrich et O. Loretz (dir.), Ugarit: ein ostmediterranes Kulturzentrum, Ergebnisse und Perspektiven der Forschung, I. Ugarit und seine altorientalische Umwelt, Münster, 1995, p. 171-212 (abrégé dans (en) W. H. Van Soldt, « The Syllabic Akkadian Texts », dans Watson et Wyatt (dir.) 1999, p. 40-41) ; (en) K. van der Toorn, « Cuneiform Documents from Syria-Palestine: Textes, Scribes, and Schools », dans Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 116, 2000, p. 97-113 ; (en) R. Hawley, « On the Alphabetic Scribal Curriculum at Ugarit », dans R. D. Biggs, J. Myers et M. T. Roth (dir.), Proceedings of the 51st Rencontre Assyriologique Internationale, Chicago, 2008, p. 57-67.
- F. Joannès, « Scribes », dans Joannès (dir.) 2001, p. 763-766. Voir aussi (en) T. Bryce, Life and Society in the Hittite World, Oxford, 2004, p. 56-71.
- (de) C. Wilcke, Wer las und schrieb in Babylonien und Assyrien, Überlegungen zur Literalität im Alten Zweistromland, Munich, 2000.
- Charpin 2008, p. 31-60.
- (en) B. Lion, « Literacy and Gender », dans Radner et Robson (dir.) 2011, p. 90-116.
- Charpin 2008, p. 97-117.
- (en) H. A. Hoffner Jr., « Syrian cultural influence in Hatti », dans M. W. Chavalas et J. L. Hayes (dir.), New Horizons in the study of Ancient Syria, Malibu, 1992, p. 89-106 ; (en) T. van den Hout, « The Rise and Fall of Cuneiform Script in Hittite Anatolia », dans Woods (dir.) 2010, p. 102-104.
- (en) N. Veldhuis, « Levels of Literacy », dans Radner et Robson (dir.) 2011, p. 70-81.
- Charpin 2008, p. 105-107 ; (en) N. Veldhuis dans Radner et Robson (dir.) 2011, p. 81-82.
- Charpin 2008, p. 190-192.
- Finkel et Taylor 2015, p. 21
- J.-M. Durand, « Mésopotamie cunéiforme », dans J. Servier (dir.), Dictionnaire critique de l'ésotérisme, Paris, 1998, p. 833-835.
- J.-M. Durand, « Commentaires (Mésopotamie cunéiforme) », dans J. Servier (dir.), Dictionnaire critique de l'ésotérisme, Paris, 1998, p. 325-327 ; F. Joannès, « Commentaires », dans Joannès (dir.) 2001, p. 193-194.
- Walker 1994, p. 45 ; F. Joannès, « Langage chiffré », dans Joannès (dir.) 2001, p. 463-465.
- Labat et Malbran-Labat 1988, p. 26-27.
- Labat et Malbran-Labat 1988.
- Borger 1981.
- F. Thureau-Dangin, Les homophones sumériens, Paris, 1929. Labat et Malbran-Labat 1988, p. 27-28.
- (en) J. Huehnergard et C. Woods, « Akkadian and Eblaite », dans Woodard (dir.) 2004, p. 224-225.
- (en) C. Watkins, « Hittite », dans Woodard (dir.) 2004, p. 554.
- B. André-Leickman dans André-Leickman et Ziegler (dir.) 1982, p. 94-96. Description détaillée de la façon dont se traduit un texte cunéiforme dans Charpin 2008, p. 18-28.
- À partir de (en) D. Frayne, The Royal inscriptions of Mesopotamia, Early periods, vol. 3/2, Ur III period (2112-2004 BC), Toronto, 1993, p. 71-72.
- M.-J. Seux, Lois de l'Ancien Orient, Paris, 1986, p. 51.
Bibliographie

Manuels d'épigraphie
- Lucien-Jean Bord et Remo Mugnaioni, L'écriture cunéiforme : Syllabaire sumérien, babylonien, assyrien, Paris, P. Geuthner,
- (de) Rykle Borger, Assyrisch-babylonische Zeichenliste, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, coll. « Alter Orient und Altes Testament »,
- René Labat et Florence Malbran-Labat, Manuel d'épigraphie akkadienne (Signes, Syllabaires, Idéogrammes), Paris, P. Geuthner, (réimpr. 2002), 6e éd.
- (de) Christel Rüster et Erich Neu, Hethitisches Zeichenlexikon : Inventar und Interpretation der Keilschriftzeichen aus den Boğazköy-Texten, Wiesbaden, O. Harrassowitz, coll. « Studien zu den Boğazköy-Texten »,
- Marie-Joseph Stève, Syllabaire élamite : Histoire et paléographie, Neuchâtel et Paris, Recherches et civilisations, coll. « Civilisations du Proche-Orient »,
Introductions et outils de travail
- (en) John Nicholas Postgate, Early Mesopotamia : Society and Economy at the Dawn of History, Londres et New York, Routledge,
- Jean Bottéro, Mésopotamie : L'Écriture, la Raison et les Dieux, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire »,
- Francis Joannès (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins »,
- (en) Wilfred G. E. Watson et Nicolas Wyatt (dir.), Handbook of Ugaritic studies, Leyde, Boston et Cologne, Brill, coll. « Handbuch der Orientalistik »,
- (en) Roger D. Woodard (dir.), The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages, Cambridge, Cambridge University Press,
Études sur l'écriture
- (de) Dietz-Otto Edzard, « Keilschrift », dans Dietz-Otto Edzard et al. (dir.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, vol. 5, Berlin et New York, Walter de Gruyter, 1976-1980, p. 544-568
- Béatrice André-Leickman (dir.) et Christiane Ziegler (dir.), Naissance de l'écriture : cunéiformes et hiéroglyphes, Paris, Réunion des Musées Nationaux, .
- Dominique Charpin, Lire et écrire à Babylone, Paris, Presses Universitaires de France, .
- Jean-Marie Durand, « L'écriture cunéiforme », dans Anne-Marie Christin (dir.), Histoire de l'écriture : De l'idéogramme au multimédia, Paris, Flammarion, , p. 21-32.
- Jean-Jacques Glassner, Écrire à Sumer : L'invention du cunéiforme, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L'Univers historique », .
- (en) Théo P. J. van den Hout, « The Written Legacy of the Hittites », dans Hermann Genz et Dirk Paul Mielke (dir.), Insights into Hittite History and Archaeology, Louvain, Paris et Walpole, Peeters, , p. 49-84.
- (en) Karen Radner et Eleanor Robson (dir.), The Oxford Handbook of Cuneiform Culture, Oxford, Oxford University Press, .
- (en) Seth L. Sanders (dir.), Margins of Writing, Origins of Cultures, Chicago, The Oriental Institute of Chicago, .
- Philippe Talon et Karel Van Lerberghe (dir.), En Syrie, aux origines de l'écriture, Turnhout, Brepols,
- Christopher B. F. Walker (trad. Christiane Zivie-Coche), « Le cunéiforme : Du cunéiforme à l'alphabet », dans Larissa Bonfante et al., Naissances des écritures, Paris, Éditions du Seuil, , p. 25-99.
- (en) Christopher Woods (dir.), Visible Language : Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond, Chicago, The Oriental Institute of Chicago, .
- (en) Niek Veldhuis, « Cuneiform: Changes and Developments », dans Stephen D. Houston (dir.), The Shape of Script. How and Why Writing Systems Change, Santa-Fe, School of Advanced Research Press, , p. 3-23
- (en) Jon Taylor, « Administrators and Scholars: The First Scribes », dans Harriet Crawford (dir.), The Sumerian World, Londres et New York, Routledge, , p. 290-304
- (en) Irving Finkel et Jonathan Taylor, Cuneiform, Londres, The British Museum Press, . Traduction Olivier Lebleu, éditions Fedora, 2020, 112 p.
- (en) Christopher Woods, « The Emergence of Cuneiform Writing », dans R. Hasselbach‐Andee (dir.), A Companion to Ancient Near Eastern languages, Hoboken, Wiley-Blackwell, , p. 27-46.
Histoire des déchiffrements et des études cunéiformes
- Paul Garelli, L'Assyriologie, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que-sais-je ? », (1re éd. 1964)
- Jean Bottéro et Marie-Joseph Stève, Il était une fois la Mésopotamie, Gallimard, coll. « Découvertes » (no 191),
- Brigitte Lion et Cécile Michel (dir.), Les écritures cunéiformes et leur déchiffrement, Paris, De Boccard,
- Dominique Charpin, L'assyriologie, Presses Universitaires de France, coll. « Que-sais-je ? » (no 4239),
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- « Cuneiform Digital Library initiative » (« Initiative de la bibliothèque numérique cunéiforme ») : projet répertoriant et rendant accessibles des numérisations de milliers de tablettes cunéiformes de différentes périodes issues de plusieurs collections publiques et privées.
- « Écriture cunéiforme et civilisation mésopotamienne », sur Maison Archéologie & Ethnologie : dossier thématique présentant l'écriture cunéiforme.