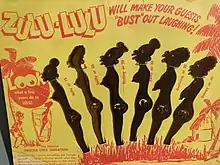Intersectionnalité
L’intersectionnalité (de l'anglais intersectionality) ou intersectionnalisme est une notion employée en sociologie et en réflexion politique, qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Ainsi, dans l'exemple d'une personne appartenant à une minorité ethnique et issue d'un milieu pauvre, celle-ci pourra être à la fois victime de racisme et de mépris de classe.
Le terme a été proposé par l'universitaire afroféministe américaine Kimberlé Williams Crenshaw en 1989[1] pour parler spécifiquement de l'intersection entre le sexisme et le racisme subis par les femmes afro-américaines, pour en évaluer les conséquences en matière de pouvoir, et expliquer pourquoi ces femmes n'étaient pas prises en compte dans les discours féministes de l'époque[2]. Le sens du terme a depuis été élargi, dans les années 2010, avec la montée du cybermilitantisme et englobe désormais toutes les formes de discriminations qui peuvent s'entrecroiser.
Cette notion est une importante contribution théorique des études sur le féminisme. Pour ses partisans, elle permet aux modèles de réflexion d'aborder la complexité du monde tout en maintenant l'élan politique qui porte la plupart des actrices et acteurs de ce milieu[3].
Démarche
L'intersectionnalité étudie les formes de domination, d'oppression et de discrimination, non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que les différenciations sociales comme le genre, la race, la classe, la couleur, la nation, la religion, la génération, la sexualité[4], le handicap, la santé mentale, ou l'orientation sexuelle ne sont pas cloisonnées, ou encore que les rapports de domination entre catégories sociales ne peuvent pas être entièrement expliqués s'ils sont étudiés séparément les uns des autres. L'intersectionnalité entreprend donc d'étudier les croisements et intersections entre ces différents phénomènes[5].
Elle analyse les rapports sociaux aux niveaux macrosociologiques (notamment la façon dont les systèmes de pouvoir expliquent le maintien des inégalités) et microsociologiques (notamment via l'analyse des systèmes d'inégalités dans les trajectoires individuelles). Cette dualité macro/micro caractérise la recherche intersectionnelle[3].
La question de savoir comment les différences sociales sont constituées demeure ouverte. Les notions de sexe, de race ou de classe, par exemple, ont-elles une autonomie les unes par rapport aux autres, ou bien se constituent-elles mutuellement ? Faut-il donner aux processus économiques, donc à la notion de classe, une prépondérance ? Pour répondre, les chercheurs proposent deux directions : l'approfondissement des notions de pouvoir et l'intégration dans le paradigme de l'intersectionnalité de notions sociologiques plus larges, comme celle de capital social[3].
Psychologie et psycho-sociologie
Les chercheurs en psychologie ont incorporé les effets et conséquences de liens ou "intersections" entre différentes causes (les liens entre les causes et sujets de différents combats politiques sociaux ou autre) depuis les années 1950. Ces "liens" ou "effets d'intersection" ("intersection effects" en anglais) étaient basés sur l'étude des biais, heuristiques, stéréotypes et jugements. Les psychologues ont étendu la recherche sur les biais psychologiques aux domaines de la psychologie cognitive et motivationnelle. Ce que l'on constate, c'est que chaque esprit humain a ses propres biais de jugement et de prise de décision qui tendent à préserver le biais du statu quo en évitant le changement et l'attention aux idées qui existent en dehors de son domaine personnel de perception. Les effets d'interaction psychologique couvrent une gamme de variables, bien que les effets « personne par situation » soient la catégorie la plus examinée. Par conséquent, les psychologues ne considèrent pas l'effet d'interaction des données démographiques telles que le sexe et la race comme étant plus remarquable ou moins remarquable que tout autre effet d'interaction. De plus, l'oppression peut être considérée comme une construction subjective lorsqu'elle est considérée comme une hiérarchie absolue. Même si une définition objective de l'oppression était atteinte, les effets « personne par situation » rendraient difficile de considérer certaines personnes ou catégories de personnes comme opprimées uniformément. Par exemple, les hommes noirs sont stéréotypés comme violents, ce qui peut être un inconvénient dans les interactions avec la police, mais aussi comme physiquement attrayants[6] - [7], ce qui peut être avantageux dans les situations romantiques[8] - [9].
Des études psychologiques ont montré que l'effet de la multiplication des identités «opprimées» n'est pas nécessairement additif, mais plutôt interactif de manière complexe. Par exemple, les hommes gays noirs peuvent être évalués plus positivement que les hommes hétérosexuels noirs, parce que les aspects « féminins » des stéréotypes gays tempèrent l'aspect hypermasculin et agressif des stéréotypes noirs[9] - [10].
Histoire de la notion
Awa Thiam est la première féministe à formuler en 1978 dans son essai La Parole aux négresses la question du positionnement des femmes noires francophones dans le mouvement féministe, produisant une première base théorique de l'intersectionnalité bien qu'elle n'applique pas à cette notion le terme d'intersectionnalité[11].
Awa Thiam explique que les femmes noires souffrent de plusieurs oppressions simultanément et les problèmes spécifiques qu'elles rencontrent ne sont pas traités au sein du mouvement féministe blanc et occidental[12].
Le terme intersectionality a été inventé par l'universitaire féministe afro-américaine Kimberlé Williams Crenshaw dans une enquête publiée en 1991 et portant sur les violences subies par les femmes de couleur dans les classes défavorisées aux États-Unis[13] - [14]. Celle-ci avait entamé sa réflexion sur les intersections entre discriminations dans un article de 1989 dont la réflexion se situait dans la lignée du courant du black feminism[15]. Ce terme a été repris depuis par de nombreuses autres études, bien que d'autres termes, comme « interconnectivité » ou « identités multiplicatives », aient également été utilisés pour qualifier la même démarche[16].
Cette théorie a remporté un grand succès dans le contexte des études de genre[14]. Elle aborde un problème difficile pour le féminisme : les différences entre femmes. Le vieil idéal d'un féminisme où toutes les femmes seraient ensemble est difficile à tenir[17] - [18], et cette théorie apporte une plate-forme qui peut être commune à tous les courants. Elle rend visibles les différences de race, genre et classe tout en déconstruisant ces catégories. Dans un cadre universitaire, elle donne à réfléchir à la fois aux généralistes et aux spécialistes, tout en établissant une passerelle entre les deux ; dans ce cadre, l'intersectionnalité forme un mot tendance, capable d'attirer l'attention s'il est présent dans le titre d'un article scientifique. Enfin, son incomplétude même rend cette théorie attirante, et donne à chacun la possibilité de la compléter ; elle ouvre à de nouvelles discussions et à de nouvelles découvertes. Cette théorie, qui met en lumière la complexité du monde, donne aux sociologues et aux féministes les moyens de l'aborder[2]. Par exemple, la notion aide à comprendre en quoi les femmes noires ou pauvres ne subissent pas les mêmes violences ou discriminations que les femmes issues des classes socio-professionnelles favorisées et blanches.
Complexité de l'intersectionnalité
Il existe trois méthodes différentes permettant l'étude de l'intersectionnalité[19].
- Tout d'abord, la complexité anticatégorique, qui repose sur la déconstruction des divisions catégoriques : elle est fondée sur le principe que les catégories sociales sont des constructions arbitraires de l'histoire et de la langue et qu'elles contribuent peu à la compréhension de la manière dont les personnes interagissent avec la société.
- Ensuite, la complexité intercatégorielle : elle fait de l'existence des inégalités dans la société la base de l'intersectionnalité.
- Enfin, la complexité intracatégorielle, qui peut être vue comme l'intermédiaire entre les complexités anti et intercatégorielles : cette approche reconnaît les défauts des catégories sociales existantes et remet en question la manière dont ces catégories créent des frontières et des distinctions, tout en reconnaissant leur importance dans la compréhension du monde social.
Critiques de la notion
Par sa créatrice Kimberlé Williams Crenshaw
En 2020, Kimberlé Williams Crenshaw elle-même, créatrice de l'expression, revient dans une interview sur la dénaturation de son concept : « Il y a eu une distorsion [de ce concept]. Il ne s'agit pas de politique identitaire sous stéroïdes. Ce n'est pas une machine à faire des mâles blancs les nouveaux parias »[20].
.jpg.webp)
Lors d’un discours d’ouverture prononcé au Center for Intersectional Justice (CIJ), à Berlin, Kimberlé Williams Crenshaw a noté la nécessité de revenir à la définition initiale de son concept sur l'intersectionnalité et de se remémorer, qu’à la base, ce sont deux femmes afro-américaines qui en sont à l'origine (Kimberlé Crenshaw et Emma DeGraffenreid)[21]. En effet, elle affirme dans un article du Washington Post qu’il avait été conceptualisé, avant tout, pour le besoin des femmes noires, mais que « ce terme a mis en lumière l'invisibilité de nombreuses personnes au sein de groupes qui les présentent comme leurs membres, mais échouent souvent à les représenter. Les effacements intersectionnels ne sont pas l'apanage des femmes noires. Les racisés au sein des mouvements LGBTQ+ ; […] les femmes au sein des mouvements d'immigration ; les femmes trans au sein des mouvements féministes ; et les personnes non valides qui combattent les dérives policières – tou·te·s font face à des vulnérabilités qui reflètent les intersections entre le racisme, le sexisme, le classisme, la transphobie, le validisme, etc. »[21]
Aux États-Unis
En 2005, Jasbir Puar propose plutôt le concept d'agencement[22], repris à Gilles Deleuze et Félix Guattari, pour penser la multiplicité des facteurs affectant les individus dans leur subjectivité.
Pour le sociologue Rick Fantasia, l'intersectionnalité minore « la perspective de classe, au prétexte que toutes les expressions d’identité et les motifs de division doivent être inclus dans le cadre explicatif de tous les phénomènes sociaux. Car, à la différence de ce qui se passe en Europe, la plupart des Américains ont une conception rudimentaire de la notion de classe. On leur rabâche que celle-ci n’est qu’une vue de l’esprit. Pour eux, d’autres formes de clivage constituent donc spontanément une source d’inégalités beaucoup plus évidente »[23].
En France
Éric Fassin, sociologue français spécialisé dans la culture des États-Unis, a étudié, sous l'angle de la notion de traduction, la façon dont l'intersectionnalité était entrée dans le féminisme français[24]. Cette notion y est apparue vers l'année 2000, dans le sens d'une analyse de la pluralité. Très tôt, on s'inquiète de ce que la question de l'entrecroisement des dominations risque de figer l'identité des groupes analysés. Elsa Dorlin, philosophe, préparait une étude sur le Black feminism, qui sera publiée en 2007, et craignait que se concentrer sur l'intersection des sexes et des races efface les abus des deux côtés. Reprenant le titre « Toutes les femmes sont blanches, tous les Noirs sont hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses », d'une anthologie sur le féminisme noir parue en 1982, elle montrait son accord avec l'approche intersectionnelle, mais elle souhaitait aussi l'enrichir[25]. Cet enrichissement pouvait être apporté par les mouvements de luttes contre les colonisations, particulièrement par les idées d'Edward Saïd, universitaire palestinien et américain, qu'elle propose en association pour surpasser les emprises de la domination[24].
À cette époque, divers travaux de féministes américaines sont traduits en français et publiés, nourrissant les débats, comme Trouble dans le genre, ou Doing difference de Candace West et Sarah Fenstermaker (Faire la différence, traduction Anne Revillard et Laure de Verdalle). Ce dernier ouvrage propose d'appréhender la diversité des oppressions non par leur intersection, mais en regardant comment le genre se réalise à travers elles, apportant ainsi une autre méthode que l'intersectionnalité pour décrire les exploitations. Le renouveau du féminisme en France de ces années là s'est aussi construit à partir du travail de Colette Guillaumin, sociologue française, à partir de la notion d'artifice du naturel, à la suite de travaux sur l'intrication des multiples ordres d'exploitation contre les migrants et les migrantes du Maghreb[24].
Le point de départ de la tradition féministe américaine et de son homologue française n'est pas le même : Éric Fassin affirme que la première est baignée dans des questions de race, alors que la seconde l'est dans le marxisme. Le féminisme aux États-Unis s'est construit en regard du mouvement noir, celui de la France a vécu en parallèle des mouvements ouvriers. Lorsque Kimberlé Crenshaw croise genre et race, Danièle Kergoat, sociologue française, croise genre et classe. Les féministes françaises n'ignorent pas les questions de race, les américaines n'ignorent pas la notion de classe, mais leur histoire n'est pas la même. À ces origines différentes s'ajoutent un contexte de réflexion qui n'a pas les mêmes objectifs : alors que les américaines réfléchissent surtout en termes de droit, les françaises réfléchissent surtout en termes de sociologie. Ainsi, comme toute autre, l'intersectionnalité est une connaissance située. Aux États-Unis, ce ne sont pas seulement les femmes noires qui font l'intersectionnalité, mais c'est aussi, et surtout, le féminisme. En France, ce n'est qu'en 2005 que les Indigènes de la République publient leur manifeste, que la Loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés sera discutée, que le Conseil représentatif des associations noires de France est créé, et que les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises vont tonner, tout cela donnant alors aux féministes françaises une consistance, une actualité et une réalité aux injustices perpétrées par la notion de race[24].
Les affaires du voile islamique en France, intervenues à cette époque, s'interprètent, pour diverses féministes, non comme un problème de laïcité et de religion, mais comme un problème de racisme. Christine Delphy, dans un article de 2006, y voit un point de convergence entre l'intersectionnalité américaine — qu'elle ne nomme pas — et le féminisme matérialiste français[26]. C'est une convergence qui vient aussi de sa propre histoire. Pour discuter des femmes dites voilées elle entre dans une logique d'intersection entre racisme, sexisme, société, famille. Elle affirme que « Le patriarcat n'est pas le seul système qui opprime les femmes des "quartiers et banlieues". Elles sont aussi opprimées par le racisme. Les oppressions ne s'ajoutent pas les unes aux autres de façon mécanique, successive dans le temps et dans l'espace ». Eric Fassin montre que, ainsi, l'enjeu de l'intersectionnalité, en France, est devenu concret, et non plus une notion importée[24].
La notion fait l'objet de critiques de la part d'universitaires et d'essayistes qui lui reprochent, en particulier, de brouiller la distinction entre analyse scientifique et engagement politique, et de ne servir qu'à promouvoir certaines identités particulières.
Le politologue Laurent Bouvet, cofondateur du Printemps républicain, estime ainsi que « ce concept est utilisé, aujourd’hui, en France, essentiellement pour rendre acceptables – tout particulièrement à gauche – les revendications identitaires et culturalistes de minorités en les assimilant à des luttes sociales menées au nom de l’égalité »[27].
D'après Caroline Fourest, alors que certains l'utilisent comme synonyme à la convergence des luttes, pour d'autres, « l'intersectionnalité relève d'une vision américanisée et ghettoïsée » qui aboutit à opposer le féminisme dit « noir » au féminisme dit « blanc » et donc jugé « bourgeois »[28].
Fatiha Agag-Boudjahlat juge que l'intersectionnalité, « concept utile quand il est étudié par des spécialistes », se manifeste également comme un courant de pensée politique qui « prétend faire reconnaître le cumul de discriminations (femme et noire par exemple) » mais n'en fonctionne pas moins « comme une intersection routière : il y a toujours une priorité et un « cédez le passage ». Avec l'intersectionnalité, ce sont toujours les femmes qui cèdent le passage aux intérêts du groupe ethnique et religieux auquel on les assigne. » En se conformant au « culturalisme, qui consiste à défendre des droits différents en fonction de la couleur et de la culture des femmes, en fait leur ethnie et leur religion », l'intersectionnalité phagocyte le féminisme et détourne celui-ci de son objectif d'émancipation individuelle et collective de toutes les femmes, selon l'essayiste[29].
Une controverse méthodologique sur l'identité sociale oppose l'historien Gérard Noiriel et le sociologue Stéphane Beaud, soutenus par l’Observatoire des inégalités, aux partisans de la théorie de l'intersectionnalité. Cette théorie qui veut associer l'analyse en termes de classes à d'autres aspects de l'identité sociale comme l'ethnicité ou le genre, considérés comme secondaires dans l'approche marxiste traditionnelle[30]. Selon Gérard Noiriel, l'intersectionnalité surdétermine (de façon insincère et subjectiviste) la question de l'identité ethnique, qu'il compare à un « bulldozer » écrasant tous les autres facteurs d'explication dont ceux économiques. Au contraire, pour le politologue Philippe Marlière, les sociologues Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz, l'apport de l'intersectionnalité consiste à multiplier les perspectives pour « éviter de catégoriser les groupes selon un seul axe identitaire »[30] - [31] - [32].
Stéphanie Roza, dans La Gauche contre les Lumières, analyse l'article séminal de Kimberlé Crenshaw et montre que la plupart des préjudices vécus par les femmes noires sujets d'études de l'article ne sont pas attachés à des discriminations de race ou de genre, auxquelles Kimberlé Crenshaw les attribue pourtant explicitement, mais sont directement liés à la pauvreté - et qu'un autre humain de même niveau de pauvreté s'en plaindrait avec les mêmes mots[33] - [34]. Elle considère la position de Crenshaw comme réductrice, car les inégalités entre les classes sociales ne seraient que des « conséquences des différences sexuelles et raciales[35] ».
Françoise Vergès, militante pour un féminisme « décolonial », soutient que l'intersectionnalité permet de remettre en question le féminisme homogène européen et blanc pour donner la parole aux « femmes racisées ». Elle croit que d'autres éléments identitaires doivent être intégrés au discours intersectionnel, comme l'histoire esclavagiste et coloniale de la France[36].
Pour Nathalie Heinich sociologue, directrice de recherche au CNRS (EHESS), l'intersectionnalité « est la conséquence directe du différentialisme[37] ».
Politique
Dans les milieux politiques radicaux ou démocrates, allant de l'ultragauche à la social-démocratie où le concept a été largement repris, des débats existent sur la pertinence de son utilisation puisque l'emploi de celui-ci suppose que lesdites oppressions (classe, genre, race) sont placées au même niveau, aboutissant souvent à une vision interclassiste où les personnes de mêmes genre ou race auraient plus en commun que des personnes d'une même classe sociale, terme qui se retrouve invisibilisé, s'opposant ainsi à une vision marxiste de la lutte des classes comme moteur de l'histoire[38]. Cela pose le problème de la fragmentation des luttes et des prolétaires qui, dans la vision intersectionnelle, ne pourraient plus vraiment s'unir contre l'exploitation et la misère de la vie quotidienne mais se retrouvent à se fragmenter en s'associant plus qu'à une multiplicité de groupes subissant des oppressions, parfois sur des bases essentialistes et communautaires, dans une vision postmoderne, posant le problème de la manière d'arriver à une émancipation globale et totale du genre humain[39].
Des auteurs conservateurs sont très critiques à l'égard de l'intersectionnalité. Ainsi le commentateur politique Andrew Sullivan soutient que la pratique de l'intersectionnalité « se manifeste presque comme une religion. Elle pose une orthodoxie classique à travers laquelle toute l'expérience humaine est expliquée - et à travers laquelle tout discours doit être filtré[40] ». De même, l'avocat et commentateur politique David French, écrivant dans la National Review, déclare que les partisans de l'intersectionnalité sont des « fanatiques d'une nouvelle foi religieuse » qui ont l'intention de combler un « trou en forme de religion dans le cœur humain »[41].
Au Québec
Alain Deneault, professeur de philosophie à l’université de Moncton, écrit en 2020 que l'intersectionnalité est « un mot en vogue dans les cercles militants[42] ». Vanessa Tanguay, doctorante en droit, a également présenté l'intersectionnalité comme une approche utile pour aborder le droit à l'égalité tel que garanti par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec[43] - [44].
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Intersectionality » (voir la liste des auteurs).
- « La gauche identitaire en guerre avec une partie de la recherche française », sur Slate, .
- Kathy Davis (trad. Françoise Bouillot), « L’intersectionnalité, un mot à la mode. Ce qui fait le succès d’une théorie féministe », Les cahiers du CEDREF. Centre d’enseignement, d’études et de recherches pour les études féministes, no 20, (ISSN 1146-6472, lire en ligne, consulté le ).
- Sirma Bilge, « Théorisations féministes de l'intersectionnalité », Diogène, vol. 225, no 1, , p. 70 (ISSN 0419-1633 et 2077-5253, DOI 10.3917/dio.225.0070, lire en ligne, consulté le ).
- Elsa Dorlin, « L’Atlantique féministe : L’intersectionnalité en débat », Papeles del CEIC, no 83, (ISSN 1695-6494, lire en ligne).
- « « Racisé », « privilège blanc », « intersectionnalité » : le lexique pour comprendre le débat autour des réunions non mixtes », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le ).
- (en) Michael B. Lewis, « A Facial Attractiveness Account of Gender Asymmetries in Interracial Marriage », PLoS ONE, vol. 7, no 2, (PMID 22347504, DOI 10.1371/journal.pone.0031703, lire en ligne, consulté le ).
- (en) Michael B. Lewis, « Who is the fairest of them all? Race, attractiveness and skin color sexual dimorphism », Personality and Individual Differences, vol. 50, no 2, , p. 159–162 (ISSN 0191-8869, DOI 10.1016/j.paid.2010.09.018, lire en ligne, consulté le )
- David S. Pedulla, « The Positive Consequences of Negative Stereotypes », Social Psychology Quarterly, (DOI 10.1177/0190272513506229, lire en ligne)
- (en) David S. Pedulla, « The Positive Consequences of Negative Stereotypes: Race, Sexual Orientation, and the Job Application Process », sur SAGE Journals (consulté le ).
- (en) Jessica D. Remedios, Alison L. Chasteen, Nicholas O. Rule et Jason E. Plaks, « Impressions at the intersection of ambiguous and obvious social categories: Does gay + Black = likable? », Journal of Experimental Social Psychology, vol. 47, , p. 1312–1315 (DOI 10.1016/j.jesp.2011.05.015, lire en ligne)
- « Une noire peut en cacher une autre - Ép. 3/4 - Je suis noire et je n’aime pas Beyoncé, une histoire des féminismes noirs francophones », sur France Culture (consulté le ).
- « "La Parole aux négresses" de Awa Thiam, livre fondateur du féminisme africain », sur TV5MONDE, (consulté le ).
- Kimberlé Williams Crenshaw et Oristelle Bonis, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l'identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, vol. 39, no 2, , p. 51 (ISSN 1298-6046 et 1968-3928, DOI 10.3917/cdge.039.0051, lire en ligne, consulté le ).
- « Race, islamophobie, intersectionnalité : ces mots qui restent tabous en France », sur France Culture, (consulté le ).
- (en) Kimberle Crenshaw, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, vol. 1989, , p. 139 (lire en ligne, consulté le ).
- L. Bereni, S. Chauvin, A. Jaunait et A. Revillard, Introduction aux gender studies: manuel des études sur le genre, Brussel De Boeck, , 246 p. (ISBN 978-2-8041-5341-0), p. 193.
- (en) Elizabeth SPELMAN et Maria LUGONES, « Have We Got a Theory for You! Feminist Theory, Cultural Imperialism and the Demand for'The Woman's Voice.' », Women's Studies International Forum, , p. 573-81
- Chandra Mohanty, « Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses », Feminist review, vol. 30, no 1, (DOI 10.1057/fr.1988.42)
- (en) Leslie McCall, « The Complexity of Intersectionality », Journal of Women in Culture and Society, Spring, vol. 30, no 3, , p. 1771–1800 (lire en ligne).
- (en) Katy Steinmetz, « She Coined the Term ‘Intersectionality’ Over 30 Years Ago. Here’s What It Means to Her Today », sur Time, .
- « Kimberlé Crenshaw, l'intersectionnalité et le féminisme français », sur roseaux.co, (consulté le ).
- Jasbir Puar, « Queer Times, Queer Assemblages », Social Text, vol. 23, nos 3–4, , p. 84–85 (lire en ligne)
- Rick Fantasia, « La gauche cannibale, un syndrome universitaire », Le monde diplomatique, (lire en ligne).
- Éric Fassin, « D’un langage l’autre : l’intersectionnalité comme traduction », Raisons politiques, (lire en ligne).
- Elsa Dorlin, « De l'usage épistémologique et politique des catégories de « sexe » et de « race » dans les études sur le genre », Cahiers du Genre, (lire en ligne).
- Christine Delphy, « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemme », Nouvelles Questions féministes, (lire en ligne).
- Laurent Bouvet, L'Insécurité culturelle, Paris, Fayard,
- « “Nuit Debout”, entre convergence et concurrence des luttes », sur carolinefourest.wordpress.com, .
- « Fatiha Boudjahlat : « Contre le racisme des bons sentiments qui livrent les femmes au patriarcat oriental » », sur Le Parisien, .
- Nicolas Gastineau, « “Race” contre classe ? Quand la convergence des luttes tourne au pugilat idéologique », sur Philosophie Magazine (consulté le ) : « L’intersectionnalité veut articuler la classe à d’autres référents de l’identité jusqu’alors jugés secondaires, comme le genre ou l’appartenance à une minorité ethnique ».
- Philippe Marlière, « Racisme partout, race nulle part », sur Club de Mediapart (consulté le ).
- « Cartographie du surplomb », sur mouvements.info (consulté le ).
- Serge Audier, « « La Gauche contre les Lumières ? », de Stéphanie Roza : l’universalisme répudié », sur Le Monde (consulté le ).
- Matthieu Febvre-Issaly, « La gauche contre les Lumières ? de Stéphanie Roza », sur Revue Esprit (consulté le ).
- « À l’intersectionnalité de la gauche | LAVA », (consulté le )
- Poinsot, M. et Vergès, F., « La pensée décoloniale est peu développée dans le monde politique français et académique », Hommes & Migrations, vol. 1327, no 4, , p. 170-176.
- Nathalie Heinich, « Le « féminisme décolonial » ou comment pervertir à la fois le féminisme et l’antiracisme », Le DDV, no 681, décembre 2020, (lire en ligne).
- « Féminisme décolonial et intersectionnalité », sur Chroniques critiques (consulté le ).
- « Une critique du post-anarchisme », sur badkids.noblogs.org (consulté le ).
- Andrew Sullivan, « Is Intersectionality a Religion? », sur Nymag.com, Intelligencer, (consulté le ).
- (en) « Intersectionality, the Dangerous Faith », sur Nationalreview.com, (consulté le ).
- Alain Deneault, « Cabale au Canada », le monde diplomatique, (lire en ligne).
- Vanessa Tanguay, Une exigence d'effectivité inhérente à la norme antidiscriminatoire québécoise : l'éclairage de l'intersectionnalité, (lire en ligne).
- (en) Vanessa Tanguay, « La Charte québécoise des droits et libertés permet-elle de mobiliser l’intersectionnalité comme cadre d’analyse de la discrimination? Quelques pistes de réflexion », Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société, vol. 36, no 1, , p. 47–67 (ISSN 0829-3201 et 1911-0227, DOI 10.1017/cls.2020.42, lire en ligne, consulté le ).
Voir aussi
Ouvrages
- L. Bereni, S. Chauvin, A. Jaunait et A. Revillard, Introduction aux gender studies. Manuel des études sur le genre, Bruxelles, De Boeck,
- Laurent Bouvet, L'Insécurité culturelle, Paris, Fayard, .
- (en) Patricia Hill Collins et Sirma Bilge, Intersectionality, Cambridge, Polity Press,
- Elsa Dorlin (dir.), Sexe, race et classe : pour une épistémologie de la domination, Paris, PUF,
- Elise Palomares et Armelle Testenoire (dir.), Prismes féministes. Qu'est-ce que l'intersectionnalité ?, L'Harmattan,
- (en) J. Siltanen et A. Doucet, Gender Relations in Canada: Intersectionality and Beyond, Toronto, Oxford University Press,
- Angela Y. Davis (trad. de l'anglais), Femmes, race et classe [« Women, Race, & Class »], (réimpr. 2020) (1re éd. 1981)
- Louis-Georges Tin, Les imposture de l'universalisme, Paris, Textuel, 2020
- (en) Ange-Marie Hancock, Intersectionality: An Intellectual History, Oxford University Press,
- Myriam Boussahba, Emmanuel Delanoë, Sandip Bakshi (dir.), Qu'est ce que l'intersectionnalité ? Dominations plurielles : sexe, classe et race, Payot, 2021, Paris, 448 p. (ISBN 9782228928694))
- Sojourner Truth, Et ne suis-je pas une femme ?, (trad.Françoise Bouillot), Payot, 2021, Paris, 128 p. (ISBN 9782228928632)
- Sarah Mazouz et Éléonore Lépinard, Pour l'intersectionnalité, Anamosa, , 69 p. (ISBN 978-2381910260, SUDOC 255626207)
Articles
- (en) Kimberlé Crenshaw, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, 1989, p. 139-67. Réimprimé dans The Politics of Law: A Progressive Critique p. 195-217 (2e éd., dirigé par David Kairys, Pantheon, 1990)
- (en) Kimberlé Crenshaw, « Cartographie des marges : Intersectionnalité, politiques de l'identité et violences contre les femmes de couleur », dans les Cahiers du genre, no 39, 2005 (publication originale : « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stanford Law Review, 1991, vol. 43, no 6, p. 1241–1299)
- (en) Inès Horchani, « Intersectionnalité et féminismes arabes avec Kimberlé Crenshaw », The Postcolonialist, vol. 2, no 2, décembre 2014/janvier 2015 (ISSN 2330-510X, lire en ligne)
- Elsa Dorlin, « De l'usage épistémologique et politique des catégories de « sexe » et de « race » dans les études sur le genre », Cahiers du Genre, vol. 39, no 2, , p. 83 (ISSN 1298-6046 et 1968-3928, DOI 10.3917/cdge.039.0083, lire en ligne, consulté le )
- Éric Fassin, « Questions sexuelles, questions raciales. Parallèles, tensions et articulations », dans Didier Fassin et Éric Fassin (dir.), De la question sociale à la question raciale ?, Paris, La Découverte, 2006, p. 230-248
- Sirma Bilge, « Théorisations féministes de l'intersectionnalité », Diogène, no 225, 1, 2009, p. 70-88
- Alexandre Jaunait et Sébastien Chauvin, « Représenter l’intersection. Les théories de l’intersectionnalité à l’épreuve des sciences sociales », Revue française de science politique, vol. 62, no 1, 2012, p. 5-20, [lire en ligne]
Reportage en ligne
- Géraldine Mosna-Savoye. Avec Sarah Mazouz (sociologue, chercheuse au CNRS)., « Qu’est-ce que l’intersectionnalité ? », sur France Culture : Sans oser le demander, (consulté le ).
Articles connexes
- Études décoloniales
- Afroféminisme
- Néo-féminisme
- Écoféminisme
- Triple oppression
- Kyriarchie
- Antiracisme
- Racisme
- Validisme
- Racisation
- Sihame Assbague
- Non-mixité
- Colonialité du genre
- Audre Lorde, poétesse précurseuse de l'intersectionnalité.
Liens externes
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Ressource relative à la santé :
- (en) Bibliographie sur l'intersectionnalité sur le site Intersectionality.org
- (en) Compte rendu du colloque international Race, Class, Gender as categories of difference and inequality: Which perspectives arise from the concept of „intersectionality“ for human and cultural sciences? (Paris, EHESS, ), sur le site du Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne