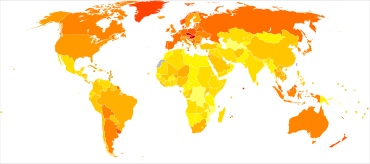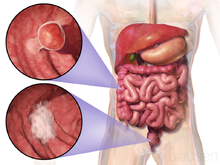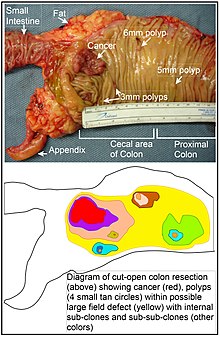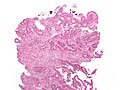| Médicament | Irinotécan |
|---|---|
| Spécialité | Oncologie |
Le cancer colorectal ou colo-rectal est une tumeur maligne de la muqueuse du côlon ou du rectum. Le cancer colorectal peut toucher tous les segments anatomiques du gros intestin comme le caecum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde et le rectum mais ne concerne pas le cancer du canal anal qui est une entité distincte[1].
En termes d'incidence, il s'agit de la deuxième tumeur maligne la plus courante chez la femme et la troisième chez l'homme, avec 1,8 million de nouveaux cas par an dans le monde[2]. Chaque année, environ 900 000 personnes[2] décèdent à la suite des complications d'un cancer colorectal.
Le type histologique est un adénocarcinome lieberkühnien dans la majorité des cas. Les symptômes de la maladie dépendent de l'emplacement de la tumeur et de son stade. Initialement, le cancer est asymptomatique. Un symptôme typique du cancer colorectal est un saignement, qui peut être invisible à l’œil nu lors de la défécation ou bien être observé mélangé avec les selles. Dans le cas d'un emplacement plus en amont, le sang se dégrade et le sang frais n'est pas visible, le saignement se manifeste alors par la présence de selles de couleur foncée et une anémie ferriprive. L'anémie se manifeste principalement par une faiblesse, une fatigue constante et une pâleur de la peau et des muqueuses. La douleur abdominale survenant dans le cancer colorectal est inhabituelle et dépend de l'emplacement de la tumeur. Il peut y avoir alternance de diarrhée et de constipation, ainsi qu'une perte de poids.
Un dépistage du cancer colorectal par détection du sang dans les selles est disponible dans de nombreux pays. En France, en Belgique, et au Québec il est gratuit et réalisé à partir de l'âge de 50 ans[3],[4],[5].
Sommaire
Épidémiologie
La prévalence totale du cancer colorectal en France métropolitaine est de 318 000 personnes, avec une légère prédominance masculine (51,3% d'hommes).[7]
C'est le second cancer, pour ce qui est de la fréquence, chez la femme (après le cancer du sein) et le troisième chez l'homme (après le cancer de la prostate et le cancer du poumon)[8].
En Afrique et en Asie, il y a beaucoup moins de cancers colorectaux qu'en Europe du Nord ou aux États-Unis (jusque 20 fois moins). De plus, les émigrants qui quittent un pays pauvre pour un pays où le risque est important, voient leur taux de cancer colorectal augmenter dans les 10-20 ans qui suivent leur migration. Ces faits suggèrent que le mode de vie, l'alimentation[9] et les efforts physiques, jouent un rôle important sur le risque de cancer. Ceci conduit à penser qu'une prévention efficace est possible (voir bas de page).
Age
Il s'agissait autrefois (jusque vers 2008) essentiellement d'un cancer de l'âge mûr (près de 85 % des cas survenant après 65 ans)[10]. Mais pour des raisons mal comprises, sa fréquence augmente chez les jeunes adultes, et d'autant plus rapidement qu'ils sont jeunes[10],[11]alors même que paradoxalement son incidence diminue chez les personnes âgées[11]. Le cancer du côlon touche environ 4 % des adultes au cours de leur vie aux États-Unis, selon le National Cancer Institute, mais il est en forte augmentation depuis 2008 environ chez les jeunes adultes américains, y compris au Canada où le registre national du cancer canadien a montré une incidence qui chez les femmes de moins de 50 ans a augmenté chaque année de près de 4,5 % entre 2010 et 2015. Chez les Canadiens (hommes) de moins de 50 ans l'augmentation moyenne a été de près de 3,5 %/an entre 2006 et 2015. Ce sont pour les deux sexes les taux les plus élevés jamais enregistrés parmi les cohortes de naissance les plus récentes (en 2017, près de 12 000 femmes et près de 15 000 hommes (tous âges confondus) ont reçu un diagnostic de cancer colorectal[11].
Aux États-Unis, il en va de même : en 2004, 10 % des diagnostics concernaient des personnes de moins de 50 ans, ce taux est passé à 12 % en 2015 ; en 2019 un cancer colorectal sur trois concerne des patients âgés de 18 à 50 ans explique une oncologue américaine. En Europe au Danemark, on dresse le même constat chez les moins de 50 ans. De même au Royaume-Uni lors de la décennie 2008-2018. Une autre étude montre pour 20 pays européens sur ces 10 ans une augmentation de près de 8 % par an des cas déclarés chez les 20 ans, de 5 % chez les 30 ans et de 1,6 % chez les quadragénaires[11]. Dans l'hémisphère sud en Nouvelle-Zélande on fait le même constat[11].
De plus, au moment du diagnostic, la part des stades 3 ou 4 est disproportionnée chez les jeunes adultes (sans doute car la maladie était autrefois rare chez eux, faisant que les patients et les médecins n’y pensent pas) ; il est donc urgent de sensibiliser à cette augmentation du risque, et de comprendre l'origine de cette augmentation régulière[11].
Les formes héréditaires (transmission mendélienne) sont rares (moins de 5 % des cas) même si un antécédent familial est retrouvé dans près d'un cinquième des cas[12]. Les formes familiales seraient de meilleur pronostic[13].
Mortalité
En France, le cancer colorectal a été diagnostiqué chez 44800 personnes en 2017 (24 000 hommes et 20 000 femmes) et a été responsable de 17 600 décès. Bien que son taux d'incidence et son taux de mortalité soient en diminution depuis le début des années 2000, il constitue encore la deuxième cause de décès par cancer en France.
La survie nette standardisée en France métropolitaine, sur la période 2005-2010 a été estimé à 63% à 5 ans (62% chez l'homme contre 64% chez la femme), et 52% à 10 ans (52% chez l'homme contre 54% chez la femme).
L'âge médian au décès est de 77 ans pour l'homme et 81 ans pour la femme.[7]
Diagnostic
Signes fonctionnels
Un cancer colorectal ne manifeste pas forcément de signes. C'est pourquoi, après cinquante ans, on recommande des tests de détection.
Il peut se manifester par :
- du sang dans les selles (sang fécal, apparent ou occulte : en ce cas, détectable par un test) ;
- une constipation soudaine ou qui s'aggrave, avec possible alternance diarrhées/constipations. À l'extrême, une occlusion intestinale peut survenir, ou une perforation de la tumeur avec péritonite. La présence de signes digestifs apparus dans les mois précédant l'accident aigu orientent vers l'origine cancéreuse de la complication aigüe ;
- une douleur abdominale
Les symptômes sont souvent moins spécifiques avec, par exemple :
- une anémie qui entraîne une fatigue persistante et un teint pâle (due aux hémorragies intestinales). Elle survient typiquement à cause d'une carence en fer (taux bas du fer sérique et de la ferritine du plasma sanguin). La recherche d'un saignement occulte, dans ce cas, conduit à un diagnostic de cancer du côlon dans environ 10 % des cas[14].
- un amaigrissement inexpliqué ;
- tardivement, les métastases hépatiques peuvent générer un foie anormalement gros lors de la palpation.
Examen clinique
Il est, en règle générale, décevant car le toucher rectal (doigt ganté introduit dans l'anus) ne permet que de chercher de possibles anomalies rectales. Rapide et peu coûteux, cet examen détecte les anomalies situées aux alentours du rectum (dépistage d’environ 2 tumeurs du rectum sur 3)[15].
Examens complémentaires
En complément de l'examen clinique, ils vont rechercher :
- d'éventuelles lésions à la fois rectales et/ou coliques. Ceci se fait habituellement grâce à la coloscopie. En présence d'une sténose, le médecin utilisera le lavement baryté (si la sténose n'implique pas une rétention de baryte, s'il existe un risque de rétention le médecin prescrira probablement une IRM du pelvis.
Si après détection d'une tumeur une exérèse locale ou un autre traitement local de la tumeur est envisagé, le toucher rectal est complété par une imagerie pelvienne (échographie endorectale faite au moyen d'une sonde sans endoscope, ou échoendoscopie). - d'éventuelles métastases viscérales. Cette recherche se fait via une radiographie pulmonaire (face et profil), généralement associée à une échographie du foie, et parfois à un examen de l'abdomen au scanner.
Si un cancer est effectivement détecté et que l'état du patient le permet, une coloscopie complète est prescrite avant l'intervention pour bien décrire et localiser les lésions tumorales coliques synchrones, bénignes ou malignes[16].
Coloscopie

La coloscopie est l'examen de référence : une sonde (long flexible enrobé de plastique) est insérée par l'anus puis glissée peu à peu dans l'intestin (sous anesthésie générale en général). Il permet d'observer la muqueuse de l'anus jusqu'à la jonction iléo-colique, au niveau du cæcum et de l'appendice iléo-cæcal, et de faire des prélèvements. Si un polype est découvert, il est enlevé entièrement et sera analysé au laboratoire par histologie ; son exérèse diminue beaucoup le risque de cancer (voir ci-dessous le paragraphe Prévention). La sigmoïdoscopie est un examen plus rapide, mais moins complet, fait au moyen d'une courte sonde semi-rigide qui permet l'exploration du rectum et du côlon sigmoïde, mais pas du reste du côlon.
Le tissu prélevé est inclus dans un bloc de paraffine pour en extraire des coupes fines de quelques micromètres. Après coloration, ces coupes sont examinées au microscope par un médecin spécialisé en anatomopathologie (ou histologie). Cet examen permet de classer le prélèvement suivant la forme de la tumeur et le type des cellules.
On trouve le plus souvent dans l'intestin des adénomes (= polypes adénomateux). Considéré comme bénin, le polype risque d'évoluer vers un cancer si on le laisse en place, s'il est gros (plus d'un centimètre de diamètre), et/ou s'il est villeux. Les petits polypes et les polypes tubulaires présentent moins de risques. On trouve aussi des polypes hyperplasiques considérés comme pratiquement sans risque. Enfin, on trouve dans les côlons des adénocarcinomes qui sont les véritables cancers, dont les cellules dysplasiques franchissent la lamina propria. Ce premier stade de l'invasion peut évoluer pour s'étendre à d'autres organes et conduire à l'apparition de métastases hépatiques le plus souvent, qui provoquent la mort plus fréquemment que la tumeur initiale.
La coloscopie assistée par intelligence artificielle permettrait d'augmenter de 20 % le taux de détection de polypes[17]. L'endoscope confocal[18] est un outil qui permettrait la détection des biofilms in vivo, tandis que le traitement par ultrasons permettrait la perturbation de ceux-ci[19].
Radiologie
Le coloscanner
Aujourd'hui, le diagnostic en imagerie repose sur l'utilisation de la tomodensitométrie ou scanner en s'aidant d'une technique de distension colique. Cette technique particulière justifie le terme spécifique de coloscanner. La distension peut se faire avec un lavement à l'eau ou avec une insufflation gazeuse.
- Dans le premier cas de lavement à l'eau, on parle de coloscanner à l'eau. Son indication est essentiellement le diagnostic d'un cancer colorectal et il est proposé en alternative à la coloscopie devant des symptômes évoquant un cancer colique, en particulier chez les sujets âgés ou fragiles pour lesquels il est préférable de se dispenser d'une anesthésie générale en première intention. Cette technique permet de faire le diagnostic du cancer et le bilan complet de recherche d'une métastase, en particulier hépatique ou pulmonaire.
- La deuxième technique dite de coloscanner avec coloscopie virtuelle obtenue par distension gazeuse, de préférence par du gaz carbonique, est maintenant une alternative performante à la coloscopie pour le diagnostic non seulement des cancers mais aussi pour celui des lésions précancéreuses, les adénomes. Cette méthode d'exploration en plein essor impose une préparation colique préalable sur 48 heures, assez similaire à celle de la coloscopie. Le scanner se fait en externe sans injection de produit de contraste et avec une irradiation très faible, jusqu'à 10 fois inférieure à celle d'un scanner abdominal habituel. Avec un contrôle précis, en temps réel, de la pression d'insufflation, les risques de perforation sont quasi inexistants et en tout cas très inférieurs à ceux de la coloscopie. Un radiologue formé à cette technique peut atteindre un taux de détection, des lésions significatives, supérieur à celui obtenu par une coloscopie[20] car certaines lésions, en particulier derrière les plis, peuvent être manquées en coloscopie. Le coloscanner ne permet pas la résection d'un polype mais il a été montré, sur des grandes séries de patients, que l'on pouvait, en commençant par le scanner, réduire de 90 % le nombre de coloscopies nécessaires[21]. À l'inverse, l'irradiation subie lors de l'examen n'est pas négligeable car elle équivaut à deux ans de radiation naturelle[22]. Pour l'instant, en France, la coloscopie reste l'examen proposé en première intention en cas de dépistage chez un patient à risque élevé. Le coloscanner est donc actuellement indiqué pour les patients qui n'ont pas pu avoir une coloscopie complète ou qui devraient en avoir une mais qui refusent sa réalisation. Le coloscanner est aussi préféré si le patient est considéré comme fragile, car le coloscanner ne nécessite pas d'anesthésie générale.
Le lavement baryté
La radiographie après lavement au sulfate de baryum (appelé couramment lavement baryté) : le baryum, très lourd, est opaque aux rayons X. Cette technique est nettement moins performante que le coloscanner et va progressivement disparaitre dans cette indication.
D'autres types d'examens sont peu utilisés, trop coûteux, trop nouveaux, ou pas assez spécifiques ou sensibles (vidéocapsule, PET, CEA…).
Anatomopathologie
Les adénocarcinomes représentent 95 % des cas, dont 17 % d'adénocarcinomes colloïdes ou mucineux.
Macroscopie
C'est une tumeur le plus souvent ulcérée à sa partie centrale, avec un bourgeonnement plus ou moins marqué en périphérie et une infiltration pariétale qui s'étend vers la séreuse ; elle est rarement végétante (cæcum). Elle occupe une partie ou la totalité de la circonférence colique.
Apparence de l'intérieur d'un côlon développant un carcinome colorectal invasif (tumeur de forme irrégulière formant ici un cratère rougeâtre).
Apparence d'une colectomie révélant deux polypes adénomateux (tumeurs ovales brunâtres) et un carcinome colorectal invasif (cratère rougeâtre).
Examen (PET/CT) de carcinome du côlon. Outre, la tumeur primaire, d'autres lésions sont visibles, dont un nodule pulmonaire.
Microscopie
L'adénocarcinome colique est une prolifération généralement bien différenciée (adénocarcinome lieberkühnien), faite de grandes cellules basophiles, cylindriques, disposées en structures glandulaires, papillaires ou polyadénoïdes. Il existe parfois une mucosécrétion très abondante, dissociant les formations épithéliales et le stroma (adénocarcinome mucineux, anciennement adénocarcinome colloïde muqueux). L'extension se fait vers la séreuse, avec souvent une pénétration des lymphatiques par le tissu tumoral.
Lésions précancéreuses - Adénome tubulaire (à gauche de l'image), un type de polype du côlon et un précurseur du cancer colorectal (la muqueuse colorectale normale est visible à droite).
Lésions précancéreuses - adénome villeux colorectal.
Relations entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes
Un certain nombre d'adénomes (10 à 15 %) apparaissant histologiquement dédifférenciés sont susceptibles de cancérisation, aboutissant à la constitution d'un adénocarcinome lieberkühnien. Ainsi, la grande majorité des adénocarcinomes coliques dérive d'un polype adénomateux[23]. Le polype prend naissance presque toujours avec la présence d'un biofilm[24],[25],[26],[27], dans lequel les polyamines auraient un rôle important[28],[29],[30],[31]. Ceci serait en particulier plus marqué pour le colon droit, mais moins évident pour le colon gauche[32]. La présence d'un biofilm bactérien permet en particulier aux cellules cancéreuses d'échapper au système immunitaire[33], ou parce qu'elles sont en zone de Lumière du côlon, non accessible non plus à celui-ci. L'imagerie par fluorescence combinatoire, utilisant la bioluminescence, permettrait de distinguer les biofilms à tendance carcinogène de ceux plus anodins[34], comme le propose aussi la technique d'Hybridation in situ en fluorescence[35].
L'évolution vers la malignité d'une tumeur bénigne dans la muqueuse colique concerne 3 ‰ des adénomes[15]. Il n'y a pas d'opposition absolue entre tumeurs bénignes et tumeurs malignes : il existe seulement des tumeurs présentant des niveaux d'évolution différents. Ces évolutions seraient provoquées en particulier par l'action conjuguée à travers un biofilm[36],[37] (en particulier colon droit[38]) des toxines émises par au moins deux bactéries oncogéniques (en) : Bacteroides fragilis (en) et une certaine variante d'Escherichia coli[39]. L'évolution d'un adénome en adénocarcinome prend en moyenne une dizaine d'années[40] et 30 % des adénomes dont la taille est supérieure à 1 cm se transformeront en cancer[41].
Causes et facteurs de risques
- L'âge : 9 personnes atteinte sur 10 ont plus de 50 ans.[42]
- L'hérédité ou des mutations : le risque d'avoir un cancer colorectal est plus élevé si un proche a (eu) un cancer colorectal.
Le risque est d'autant plus fort qu'il y a plus de gens atteints dans la famille, que ce(s) cas sont proche(s) (père, mère, frère, sœur), et que ce(s) cas sont jeunes.
On a identifié des familles à très haut risque, où les membres ont une mutation spécifique qui les prédispose à ce cancer. Ces familles ne représentent cependant que 5 % des cancers colorectaux :- la polypose adénomateuse familiale (PAF), où une multitude de polypes apparaissent chez tous les porteurs du gène APC muté. À l'âge adulte, l'un de ces polypes dégénère forcément en cancer, sauf si on enlève le côlon par une opération chirurgicale. Le gène APC est un gène suppresseur de tumeur situé sur le bras long du chromosome 5 et son altération est considérée comme initiatrice de la cancérogenèse colorectale (1 % environ des cancers colorectaux). Il agit en amont de la voie de signalisation Wnt. Il suffit d'une mutation d'une des deux copies de gène (puisqu'il s'agit d'une maladie autosomique dominante) pour induire des polyposes adénomateuses familiales (avec apparition dès l'adolescence de centaines à milliers de polypes dans le côlon[43]) ;
- le syndrome de Lynch, ou cancer héréditaire du côlon sans polypose (en anglais HNPCC). Il y a moins de polypes que dans la FAP, et un risque moindre de cancer, mais la surveillance est nécessaire par coloscopies régulières ;
- outre des mutations qui peuvent être induites au cours de la vie (exposition à de la radioactivité ou à des produits mutagènes présents dans la nourriture), une mutation du gène « Notch » peut fortement accélérer ou aggraver la cancérogenèse colorectale. Ce gène code une protéine qui agit comme un "interrupteur" qui, quand il est allumé, induit une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule, permettant une prolifération cellulaire (normale et nécessaire tant qu'elle est contrôlée, dans toute cellule, de tout organisme, et notamment lors du développement embryonnaire)[44]. Ce gène Notch, avec le gène Wnt, joue un rôle majeur dans la signalisation cellulaire intestinale, assurant le développement et l'organisation de l'intestin qui est un organe devant se renouveler en permanence (il est entièrement renouvelé en moins de cinq jours, sur une surface de villosités et de circonvolutions qui, si elles étaient « étendues à plat », serait comparable à la taille d'un court de tennis joué en double. Des cellules progénitrices situées dans les creux des villosités intestinales doivent sans cesse produire des cellules neuves, tout en étant régulées…
Or, l'activation simultanée (artificielle ou anormale) de ces deux voies de signalisation accroît de plus de vingt fois le risque quantitatif d'apparition d'adénomes (tumeurs bénignes) intestinaux chez la souris, par rapport à l'altération de la seule voie Wnt. Le gène Notch semble donc particulièrement en cause dans un phénomène probablement synergique et déclenché par l'activation couplée de ces deux voies, créant les conditions favorisant le processus tumoral. De plus, chez la souris, ces tumeurs se développent de façon inhabituellement rapide et importante dans le côlon, évoquant la physiopathologie du cancer du côlon chez l'humain ;
- la bactérie Fusobacterium nucleatum inhiberait l'action des cellules immunitaires, ce qui pourrait faciliter la cancérogenèse[45];
- les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI), notamment la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse : après une vingtaine d'années, le risque d'avoir un cancer est d'environ un sur trois si tout le côlon est atteint ;
- l'exposition, à travers la boisson ou les aliments, à des nitrates ou à des nitrites semble être un facteur de risque dans certaines populations[46], notamment chez des personnes prédisposées ou consommant peu de vitamine C ou mangeant beaucoup de viande rouge[47] ; chez un Européen consommateur moyen de viande, le risque de cancer du côlon double si le sujet a été en plus exposé durant plus de dix ans à une eau potable contenant plus de 25 mg/l de nitrate (NO3)[48] ;
- le mode de vie joue aussi un rôle important, comme indiqué ci-dessous dans le paragraphe « prévention ». En effet, nul ne peut changer son âge ou son hérédité, mais il est possible de cesser de fumer, de boire moins d'alcool, de manger moins de charcuterie[49] et plus de fruits et légumes, et de faire plus de sport. En France, on évalue à 6 000 à 8 000 le nombre de cancers colorectaux qui pourraient être évités chaque année en réduisant la consommation de produits carnés cancérogènes (charcuterie en premier lieu, viande rouge dans une moindre mesure)[50].
Prévention du cancer colorectal
La majorité des cancers du côlon et du rectum pourraient être évités par une surveillance accrue, un mode de vie et une alimentation appropriés (limitation des quantités de viande rouge et restriction ou suppression des charcuteries[51]) et, probablement aussi, la prise orale de produits de chimioprévention.
- Surveillance : la plupart des cancers colorectaux naissent dans des polypes (ou adénomes). Ces lésions peuvent être détectées et enlevées lors d'une coloscopie. Des études montrent que cette procédure pourrait diminuer de 80 % le risque de mort par cancer intestinal si on commençait les examens vers 45 ans, puis tous les 5 ou 10 ans[52]. Le coloscanner, qui est un scanner couplé à un lavement avec un composé radio-opaque, est un choix alternatif possible, avec une sensibilité très correcte et une spécificité un peu moins bonne[53].
- Mode de vie : la comparaison de l'incidence du cancer colorectal dans différentes régions du monde[54],[55] montre qu'il est beaucoup plus fréquent dans les pays développés. De très nombreuses études mettent en évidence une corrélation avec la sédentarité. Inversement, l'activité physique a un effet protecteur. Les fumeurs sont plus touchés par le cancer colorectal[56].
- Alimentation : les études épidémiologiques mettent en évidence une corrélation entre la survenue du cancer colorectal et l'excès de calories ingérées[57], un régime riche en viande rouge et/ou en graisses animales[58] et surtout en charcuteries[59],[60]. Une étude de 2021 met en évidence un phénomène d'alkylation de l'ADN causé notamment par la viande rouge[61],[62]. Inversement, un régime alimentaire riche en fruits et légumes[63],[64] et/ou en fibres[65] (éventuellement un régime végétarien)[66] font baisser le risque de cancer, probablement parce que les végétaux contiennent des micronutriments protecteurs. La bactérie probiotique Lactobacillus acidophilus a un effet protecteur. La consommation d'alcool est également un facteur de risque[67].
En changeant son style de vie, on pourrait diminuer le risque de cancer de 60 à 80 %[68]. Par ailleurs, une alimentation favorisant les fruits et légumes, minimisant ou supprimant les charcuteries[69], favorisant les poissons et les volailles, pourrait diminuer le risque de récidive et la mortalité du cancer[70]. Elle diminuerait l'incidence et la mortalité du cancer du côlon[71], en partie grâce à une moindre fréquence de survenue d'adénomes[72], terrain des futurs cancers. Comme l'explique le Dr Fabrice Pierre, spécialiste des mécanismes de la cancérogénèse : « À partir d’un certain âge, nous sommes tous susceptibles d’héberger des cellules précancéreuses. […] le fer héminique provoque une réaction de peroxydation des lipides insaturés et cette réaction crée des aldéhydes, molécules ayant deux types d’action. D’une part, ces aldéhydes tuent les cellules saines (effet cytotoxique), ce qui conduit à favoriser les cellules précancéreuses dans le côlon, à la manière d’une sélection darwinienne. D’autre part, les aldéhydes favorisent les mutations (effet génotoxique) qui font évoluer les cellules vers l’état cancéreux. »
En janvier 2014, le Conseil supérieur de la santé de Belgique a publié un avis scientifique complet sur le rôle de la surconsommation de viande rouge et la consommation de charcuterie[73] et la prévalence du cancer du côlon. Le Conseil y détaille les mécanismes physiopathologiques et recommande à la population belge de diminuer de moitié sa consommation de viande rouge pour réduire de 20 % son risque global de cancer colorectal et d'« éviter autant que possible les charcuteries à base de viande rouge »[74].
Pour ce qui concerne la viande rouge fraîche, cela signifie passer d’une consommation moyenne actuelle de 640 grammes par semaine à 300 grammes. Le Conseil souligne que pour les seniors, la viande est une source non négligeable et intéressante de protéines de qualité. La problématique est différente pour ce qui concerne les charcuteries, dont la cancérogénicité est plus élevée en raison des modes de fabrication des viandes transformées[75]: d'après le Conseil Supérieur de Santé belge, la consommation de charcuteries à base de viande rouge devrait quant à elle être exceptionnelle[51].
En résumé :
- ne pas s’exposer au tabac ;
- pour la consommation de boissons alcoolisées, se limiter à 2-3 unités de consommation par jour pour un homme et 1-2 unités de consommation pour une femme ;
- pratiquer une activité physique suffisante et régulière (au minimum 30 minutes de marche rapide par jour) ;
- avoir un régime riche en fibres et équilibré, en limitant la viande rouge (300 g par semaine) et en évitant autant que possible des charcuteries à base de viande rouge, qui peuvent donner naissance à des nitrosamines, à des nitrosamides et à du fer nitrosylé ;
- privilégier la consommation de volaille, d’œufs et de poisson, y compris du poisson gras, ainsi que par exemple remplacer une fois par semaine la viande rouge par des alternatives végétales ;
- lors de la cuisson et du rôtissage de la viande rouge, utiliser des épices et des herbes aromatiques, telles que du romarin et de l’ail, contenant naturellement des antioxydants, ne pas trop brunir la viande et en tout cas laisser les parties les plus brun foncé ou noires sur son assiette[51].
Il faut noter que les prescriptions ne sont pas une traduction stricte des conclusions de la recherche scientifique. Par exemple pour l'alcool, le risque augmente proportionnellement à la consommation d'alcool[76] et il n'y a pas de dose d'alcool sans risque[77].
- Chimioprévention : plus de 200 produits, notamment les micronutriments cités ci-dessus, ainsi que d'autres nutriments comme le calcium ou l'acide folique (une vitamine B), et des médicaments comme l'aspirine inhibent la cancérogenèse dans des modèles précliniques (chez l'animal). Dans certaines études, on inhibe complètement les tumeurs induites chimiquement dans le côlon des rats. D'autres études montrent l'inhibition importante des polypes intestinaux spontanés chez des souris mutées (souris Min). Les essais cliniques de chimioprévention chez des volontaires humains ont eu moins de succès, mais peu de produits ont été testés à ce jour. Des suppléments de calcium ou d'aspirine donnés chaque jour pendant trois à cinq ans après l'enlèvement d'un polype, ont diminué la réapparition des polypes chez les volontaires (de 15 à 20 %). La base de données de chimioprévention de l'INRA[78] donne les résultats de toutes les études publiées sur les agents de chimioprévention chez l'homme et chez les rongeurs. L'aspirine, par ailleurs, semble améliorer le pronostic des formes tumorales avec sur-expression de la cyclooxygénase de type 2 (COX-2)[79].
Les produits laitiers diminuent aussi le risque de cancer colorectal (selon un suivi de près de 480 000 hommes et femmes de la cohorte épidémiologique European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) durant onze ans, quel que soit le produit laitier (lait entier ou écrémé, yaourt, fromage) et sans lien avec sa teneur en matières grasses. Et l'effet protecteur du calcium serait limité au calcium d’origine laitière[80],[81].
Pronostic
La seule classification utilisée en préopératoire est la classification TNM dont la 7e version date de 2009.
Classification TNM
T (tumeur) :
- Tx : renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive
- T0 : pas de signes de tumeur primitive
- Tis : intraépithéliale ou envahissant la lamina propria
- T1 : sous-muqueuse
- T2 : musculeuse
- T3 : sous-séreuse ou tissus péricoliques et périrectaux (mésorectum) non péritonéalisés
- T4 : organe ou structure de voisinage et/ou perforation du péritoine viscéral :
- T4a : péritoine viscéral
- T4b : organes de voisinage
N (ganglion) :
- Nx : ganglions non évalués ou moins de 8 ganglions examinés
- N0 : pas de métastase ganglionnaire
- N1 : 1 à 3 ganglions métastatiques régionaux :
- N1a : un seul ganglion
- N1b : deux ou trois ganglions
- N1c : dépôts tumoraux satellites
- N2 : 4 ganglions métastatiques régionaux ou plus :
- N2a : quatre à six ganglions
- N2b : sept ganglions ou plus
M (métastase) :
- M0 : pas de métastase
- M1 : métastases à distance (dont ganglions sus-claviculaires) :
- M1a : métastase localisée à un autre organe, autre que régional
- M1b : métastases dans plusieurs organes ou péritonéales
Stadification
À partir des données de la classification TNM, les cancers du côlon sont classés en quatre stades. Les chances de guérison varient considérablement du stade I au stade IV. Pour chacun des stades est noté entre parenthèses le taux de survie cinq ans après le traitement (données 2004 [82] ; en 2016, ces chiffres ne semblaient pas avoir évolué significativement, sauf pour les cancers au stade IV[83]). La stratégie thérapeutique est également adaptée à chacun de ces stades.
- Stade I (93,2 %) : pT1-T2 N0 M0
- Stade II : pT3-T4 N0 M0
- Stade IIA (84,7 %) : pT3 N0 M0
- Stade IIB (72,2 %) : pT4 N0 M0
- Stade III : tous T N1-N2 M0
- Stade IIIA (83,4 %) : pT1T2N1M0
- Stade IIIB (64,1 %) : pT3T4N1M0
- Stade IIIC (44,3 %) : tous T N2M0
- Stade IV (8,1 %) : métastases à distance
Le pronostic est plus mauvais en cas d'occlusion ou de perforation, de cancer colloïde muqueux ou indifférencié. Il est meilleur en cas de phénotype RER+ (MSI). Il est également médiocre s'il existe une mutation sur le gène BRAF (gène) (V600 E), ce qui représente environ 10 % des cas[84].
Traitement
La prise en charge du cancer du côlon a fait l'objet de la publication de plusieurs recommandations. Celles de la Haute Autorité de santé et de l'Institut national du cancer, organismes français, datent de 2011[85]
Une détection à un stade précoce est favorable. Le taux de survie à 5 ans des patients diagnostiqués en 1999-2005 a été de 90,8 % pour le stade local. Il chutait à 11,3 % pour les patients diagnostiqués au stade métastasique[15]. Le premier traitement est la chirurgie, qui permet d'enlever la tumeur et les ganglions environnants (curage ganglionnaire). Les cancers très superficiels sont parfois totalement réséqués par voie endoscopique, sans chirurgie complémentaire nécessaire s'il n'y a pas franchissement de la muqueuse musculaire. On y associe des traitements adjuvants : chimiothérapie, si le curage contient des métastases ganglionnaires ou s'il existe des métastases hépatiques ou pulmonaires ; radiothérapie si l’exérèse chirurgicale n'a pu être totale, avec reliquat tumoral individualisé sur un organe vital.
Dans le cas du cancer du bas et du moyen rectum, la présence de ganglions visibles sur le scanner ou l'échoendoscopie (donc une stadification N+) est une indication de radiochimiothérapie préopératoire (dite néoadjuvante).
Par ailleurs, les cancers du haut rectum ont une prise en charge généralement identique à ceux du côlon.
Méthodes thérapeutiques
Endoscopie
Tout polype enlevé en endoscopie est étudié en anatomie pathologique. La présence de dysplasie (état précancéreux) ou de cancérisation très superficielle (pas d'envahissement de la musculaire muqueuse, c'est-à-dire stade Tis) fait que la résection endoscopique est curative. La présence de cancer sur une berge d'exérèse ou un envahissement en profondeur (stade T1 ou plus) entraîne une indication de chirurgie complémentaire systématique (sauf si l'état général du patient ne le permet pas).
Chirurgie
Le but de la chirurgie est d'enlever la tumeur et les ganglions qui sont autour par curage ganglionnaire. Les ganglions accompagnant les vaisseaux sanguins irriguant le côlon (situés dans le mésocôlon, lame graisseuse s'étendant entre l'aorte et le côlon), on se trouve donc à enlever un segment de côlon et non simplement la tumeur. L'exérèse, pour être suffisante, doit emporter au moins 5 cm de côlon de part et d'autre du cancer, et au moins 12 ganglions dans le curage.
Du fait de l'anatomie vasculaire du côlon, les interventions les plus couramment pratiquées sont :
- l'hémicolectomie droite, avec anastomose iléo-transverse, emportant tout le mésocôlon jusqu'au bord droit de l'artère mésentérique supérieure ;
- l'hémicolectomie gauche vraie, avec anastomose entre le côlon transverse et le haut rectum. Le curage ganglionnaire emporte l'artère mésentérique inférieure, liée à 1 cm de son origine sur l'aorte et ses branches. ;
- la sigmoïdectomie avec ligature vasculaire après émergence de l'artère colique supérieure gauche ;
- les résections du côlon transverse sont plus atypiques et dépendent de l'anatomie vasculaire mise en évidence en préopératoire.
Enlever la tumeur est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'éliminer le cancer. Cependant, si la tumeur a déjà envoyé des métastases loin du côlon, l'exérèse chirurgicale ne suffit pas à guérir le malade.
Ces interventions peuvent être faites par laparotomie (ouverture du ventre) ou par cœlioscopie (on travaille dans un ventre gonflé par du CO2 grâce à des instruments introduits par des orifices de 1 cm. Le cancer est sorti par une petite incision à la fin de l'intervention).
Des travaux ont montré que les techniques de récupération rapide après chirurgie permettent de réduire le nombre de complications de 50 % et d'accélérer le rétablissement du patient, ce qui permet un retour du patient à domicile non seulement plus rapide, mais aussi dans de meilleures conditions.
La présence d'une incontinence anale non curable, de complications du cancer à type d'occlusion ou de perforation, ou l'impossibilité de conserver le sphincter anal, conduisent à pratiquer une stomie (ou anus artificiel): le côlon est abouché à la peau de l'abdomen, et les selles sont récupérées dans une poche que le patient positionne lui-même tous les jours ou tous les 3 jours. Les appareillages actuellement disponibles assurent un confort (relatif) de qualité.
S'il y a découverte de métastases hépatiques pendant la chirurgie d'un cancer du côlon, la résection est envisagée : de façon synchrone (dans le même temps opératoire) si l'exérèse apparaît facile, de façon métachrone (plus tard) en cas de métastases multiples. De récentes études ont montré que la taille et le nombre de lésions avaient peu d'influence sur la survie après chirurgie. Certaines techniques comme l'échographie préopératoire, la chimiothérapie néoadjuvante (avant la chirurgie hépatique) ainsi que l'embolisation de la branche de la veine porte du segment atteint, la radiofréquence, permettent d'augmenter le nombre de patients opérables de leurs métastases et la précision du geste chirurgical.
Si le patient n'est pas opérable, des alternatives existent : chimiothérapie ou plus récemment l'application de traitements physiques sur les métastases (ablation par radiofréquence, traitements thermiques). Les métastases pulmonaires d'un cancer colorectal doivent elles aussi être opérées quand c'est possible. Dans le cas contraire, ici aussi chimiothérapie et traitements physiques sont possibles.