Détective
Le détective est un enquêteur de droit privé, c'est-à-dire une personne ayant un statut de droit privé, qui effectue, à titre professionnel, des recherches, des investigations et des filatures. Cette qualité d'enquêteur de droit privé (qui n'est pas une appellation ni un titre mais un statut juridique et social) est d'ailleurs partagée avec diverses autres professions qui n'ont aucun rapport avec les enquêteurs privés, notamment dans le cadre de procédures administratives, civiles, pénales, sociales.

| Autres appellations |
Enquêteur de droit privé, détective privé, agent privé de recherches et de renseignements, etc. |
|---|---|
| Secteur |
Juridique (recherche de preuves), renseignement, Métier du droit |
| Métiers voisins |
| Compétences requises |
agrément de l'État des dirigeants, respect de la légalité et de la déontologie, connaissance du droit de la preuve (notamment au civil) et des sources légales de l'information, sens de l'observation, patience, facultés de déduction, objectivité des constatations, bonne culture générale (pour s'introduire dans tous les milieux), discrétion, parfaite maitrise du français (et de l'orthographe) pour les rapports destinés aux juristes et aux magistrats |
|---|---|
| Diplômes requis | |
| Évolutions de carrière |
enquêteur salarié, collaborateur libéral (ou collaborateur indépendant), directeur de cabinet |
Il ne doit pas être confondu avec le terme anglophone de «detective», qui désigne un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes officielles[N 1]. Un fonctionnaire de police est dans tous les cas un enquêteur de droit public.
En France la profession est populairement désignée sous le vocable «détective» (sans l'adjectif « privé ») ou « enquêteur privé »[1], et dans les romans sous celle de «détective privé». Il n'y existe aucune appellation légale ou obligatoire ni titre protégé[2], mais on retrouve, dans diverses textes législatifs et règlementaires, plusieurs appellations génériques telles que agent privé de recherches, agent de recherches privées, agent privé de recherches et de renseignement, enquêteur privé, agence de recherches privées, activité d'enquêtes, agence privée de recherches.
L'appellation officielle française, réglementée par le CNAPS au ministère de l'intérieur, est "Agent de Recherches Privées".
En outre, l'enquêteur de droit privé — dont l'essence consiste à rechercher des preuves, notamment dans le cadre des procédures civiles et commerciales — est officiellement considéré, par les autorités publiques françaises, d'une part comme une profession de sécurité[3] et, d'autre part, comme «un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense»[4].
Cet article s'attache à faire connaître l'activité du «privé» qui est exercée sous diverses appellations, le terme de «détective» n'étant que celui mythifié par les romans noirs, les feuilletons télévisés et le cinéma policier.
Les détectives à travers le monde

La profession est, de par le monde, admise, ignorée, tolérée ou interdite suivant la législation du pays considéré, ainsi que son aptitude à respecter les Droits de la Défense, les libertés individuelles et la liberté du commerce et de l'industrie.
Dans les dictatures, la profession y est soit interdite, soit assimilée à une police auxiliaire.
Elle est strictement règlementée dans un certain nombre de pays européens comme la France[5] ou la Belgique[6], mais aussi l'Espagne[7], l'Autriche, la Russie[N 2].
Elle est également règlementée au Canada avec certaines législations provinciales comme le Québec[8] ou le Manitoba[9].
En Suisse, il n'existe pas de législation fédérale, mais des règlementations cantonales, du moins pour certains seulement[10], comme pour le canton de Genève[11] qui impose une autorisation du Conseil d'État[12] ou encore le canton du Jura qui exige une autorisation administrative[N 3].
Dans d'autres États, la règlementation a été abrogée ce qui parait paradoxal à une époque où l'exercice de cette activité peut s'avérer sensible tant pour les libertés individuelles (violation de la vie privée) que pour les intérêts fondamentaux de la Nation (risque d'espionnage) si la profession venait à être exercée par des individus peu scrupuleux.
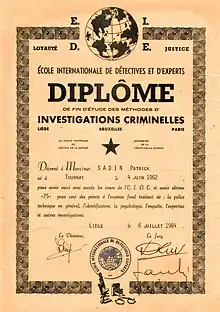
En Belgique, la profession est reconnue et règlementée depuis 1991 (cf supra). Le titre de « détective privé » est également protégé[13]. L'exercice de la profession nécessite une autorisation du Ministre de l'intérieur, après avis de la sûreté de l'État, et du Procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé ou, à défaut, du Ministre de la Justice[13].
L'autorisation est délivrée pour cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans[14].
Au Luxembourg, la profession de détective privé n'est pas règlementée. En revanche les sociétés de gardiennage sont tenues, elles, de disposer d'un agrément du Ministère de la Justice[15]. Il existe également une loi pour moraliser les prestations de services exercées sous forme commerciale[16] ce qui permet d'imposer une autorisation ministérielle à ceux qui exercent sous cette forme juridique. Certaines publicités mentionnent donc tantôt un « agrément du Ministère de la Justice » (qui, en fait, concerne le gardiennage, et la protection de personnes) d'autres une « autorisation ministérielle » (qui concerne, en fait, l'exercice de la profession de commerçant)[17].
Certains États interdisent purement et simplement la profession, comme le Mali[18]… mais elle est autorisée au Burkina Faso où elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Sécurité nationale et de l'Administration du Territoire[19].
Au Cameroun, la profession[N 4] n'est pas toujours règlementée[N 5] en 2009[N 6], malgré une vaine tentative de plusieurs détectives [N 7] qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour Suprême pour l'obliger à normaliser cette activité[N 8].
Aux États-Unis, la règlementation varie selon les États : certains n'imposent aucune autorisation (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota du Sud), d'autres exigent des conditions d'honorabilité contrôlées par le département de la Justice et le FBI, une expérience de 3 ans ou 6 000 heures dans l'investigation, une formation basée sur la Police scientifique, le droit pénal, la connaissance de la justice, la criminologie, ces conditions étant contrôlées par un examen : tel est le cas de la Californie ou la profession est contrôlée par le bureau de la sécurité et des services d'enquête de l'État.
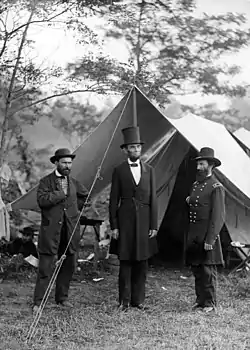
Au Texas, la formation des enquêteurs privés (private investigators) est dispensée, depuis , par l'Université du Nord Texas[N 9] à Dallas[20], d'une part et Houston[21] d'autre part, dans le cadre d'un programme qui sera assimilé à 4 ans d'expérience et qui permettra d'accéder directement à l'examen d'État[N 10].
Il existe également des certifications par des organismes techniques professionnels comme celle « d'enquêteur juridique » décernée par la NALI (National Association of Legal Investigators)[22] (Association nationale des enquêteurs juridiques).
L'enquêteur juridique est spécialisé dans les recherches à vocation juridique et judiciaire : il doit avoir de bonnes connaissances du droit et de la jurisprudence.
En Turquie, aucun texte[N 11] ne vient réglementer la profession de détective privé, mais aucun texte ne l'interdit non plus. L'association des détectives privés turcs souhaite, pour sa part, une législation reconnaissant la profession et coopère avec l'Université de Kocaeli[N 12] pour former des professionnels.
Il est envisagé de créer, dans cette université, une formation supérieure dans le cadre des professions de sécurité privée dont le cours porterait sur «l'expertise de surveillance et de recherches»[23].
En France, la profession dispose désormais d'un authentique statut la classant dans les professions libérales, l'assimilant à une profession de sécurité, la plaçant sous le contrôle des autorités administratives avec délivrance d'un agrément de l'État[24].
Il aura fallu, pour assainir, moraliser, revaloriser, contrôler et règlementer cette activité[N 13], pas moins d'une directive européenne[25] de 5 lois[26], 7 décrets[27] deux arrêtés ministériels[28], sans compter de nombreuses circulaires ministérielles[29].
La profession a une vocation essentiellement juridique et, si elle ne permet pas encore[N 14] aux justiciables économiquement faibles de bénéficier, à l'instar de l'Italie, de l'aide judiciaire, elle comble déjà un vide juridique du droit français en recherchant des preuves dans le cadre des procédures civiles et commerciales où il n'existe pas de juge d'instruction, et dans lesquelles les services de police et de gendarmerie n'ont pas qualité, compétence et droit d'intervenir.
Histoire
AlfredDeVigny.JPG.webp)
C'est au XIIe siècle qu'apparaît, pour la première fois, le terme enquesteur, commissaire du Roi chargé de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux.
Mais c'est le XIXe siècle qui apportera la naissance des agences privées, telles qu'elles existent encore aujourd'hui, avec l'ouverture, rue Neuve Saint Eustache à Paris, du bureau des renseignements universels, créé par un ancien bagnard, devenu chef de la police de sûreté, reconverti imprimeur (il inventa un papier infalsifiable) puis « agent de renseignements » : Eugène-François Vidocq[30].

Signalons que le poète Alfred de Vigny fut le client de l'agence VIDOCQ qu'il avait chargée de suivre sa maitresse, Marie Dorval, dont il était très amoureux[31].
La France est le berceau de cette profession avec la création de cette première grande agence multi-disciplinaire, comme elle a créé, en juin 2006, le premier diplôme d'État au monde[32] ayant une valeur internationale (grâce aux nouvelles normes européennes L.M.D) et des équivalences avec l'enseignement général[N 15].
Ce n'est qu'en 1850 qu'elle s'est exportée aux États-Unis avec la création de l'Agence Pinkerton, ancien tonnelier et révolutionnaire écossais qui assura la sécurité du président des États-Unis Abraham Lincoln.
Pinkerton remplit, pendant la guerre civile, les fonctions de chef de l'Union des services de renseignements et déjoua une tentative d'assassinat contre le Président Lincoln.
Longtemps « tolérée » en France — et seulement visée, pour l'ensemble du territoire national[33], par une loi datant de la guerre dont l'objet, à l'origine, était d'en interdire l'accès aux juifs[N 16] — elle a finalement été reconnue et réglementée en 2003 (voir ci-dessous).
L'ouvrage de l'universitaire Dominique Kalifa, Histoire des détectives privés en France, 1832-1942, Paris, Nouveau Monde, 2007, reconstitue avec précision la naissance et l'évolution du métier [34].
Étymologie
L'appellation populaire francophone de «détective» est, comme le rappelle la 9e (et dernière) édition du dictionnaire de l'Académie française[35] empruntée à l'anglais detective (to detect signifie découvrir).
- Dans les pays anglo-saxons, il s'agit d'un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes (les fameux détectives de Scotland Yard).
- Un détective peut aussi être une personne qui effectue des recherches et/ou des filatures (à titre privé et contre rémunération).
Mais cette appellation est de plus en plus contestée, même dans les pays anglo-saxons où l'on revient, par exemple aux États-Unis, à l'appellation de private investigator (enquêteur privé) ou «agent d'investigations» au Québec, pour se différencier du mythe[36].
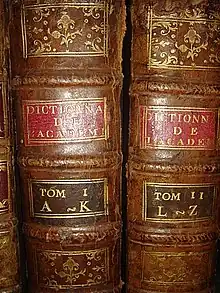
Le terme enquesteur existe au XIIe siècle en ancien français. Il s'agit de commissaires du Roi chargés de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux. Il perdit son «s» pour prendre son accent circonflexe et devenir enquêteur, quelques siècles plus tard.
Le terme «enquêteur de droit privé» en France permet, lui, de fixer aussi bien le statut du professionnel (personne de droit privé et non de droit public contrairement aux policiers ou gendarmes) ainsi que son domaine d'intervention : le droit privé.
D'ailleurs la législation française impose[37] de mentionner le caractère de « droit privé » dans la dénomination d'une personne morale et, par ailleurs cette appellation a été réclamée, aux pouvoirs publics, par la plupart des organismes professionnels[N 17].
Les procédures civile et commerciale, qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie, constituent en effet l'essence des enquêteurs privés car ils n'interviennent pas, ou que très ponctuellement, dans le cadre d'affaires pénales.
Les professionnels en exercice utilisent, en fait, plusieurs appellations : « détective », « détective privé », « enquêteur privé », « enquêteur de droit privé », « agent privé de recherches », « agent de recherches privées », « agent de renseignements divers », « enquêteur d'assurances », etc.
Les différents textes qui règlementent cette activité ne donnent aucun titre ni appellation légale à la profession. Ils se contentent de parler « d'agence de recherches privées »[38] ou «d'agence privée de recherches»[39] et de désigner les détectives tantôt sous l'appellation « Agents privés de Recherches »[40] tantôt sous celle de «Agent de recherches privées»[41] ou encore sous celle « d'Agent privé de Recherches et de Renseignements »[42], mais d'autres appellations existent aussi certains textes parlant d'enquêtes privées, d'agence de renseignements ou d'activités d'enquêtes etc.
En l'absence d'un titre légal (en France), il n'existe donc aucune protection contre l'usurpation de l'appellation, contrairement à d'autres pays, dont le Canada où la loi interdit aux personnes non titulaires d'une licence de se prétendre détective privé :
« Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre d'enquêteur privé ou d'agent de sécurité ou qu'il exploite une agence d'enquêteurs privés ou de gardiennage s'il ne détient pas une licence délivrée en vertu de la présente loi. »
La protection du titre « Enquêteur de droit privé » est réclamée, dans l'intérêt du public, par toutes les organisations professionnelles françaises[43].
Législation et règlementation en France

En France, la profession d'enquêteur de droit privé est règlementée depuis fort longtemps puisque les premières autorisations préfectorales, héritées du droit allemand, ont été instaurées en 1900 par le code local des professions[44] applicable en Alsace Moselle[N 18].
En 1942, une autre loi[45] a imposé des conditions d'honorabilité sur tout le territoire national aux enquêteurs privés[N 19].
En , la législation a fait l'objet d'une refonte totale[46]. La nouvelle règlementation sera, d'abord, applicable au territoire métropolitain, et les Départements d'Outre Mer.
Elle n'a été étendue sur l'ensemble des autres Territoires d'Outre Mer, y compris dans les Collectivités territoriales à statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie qui disposait d'une règlementation spécifique[N 20], que par une loi du [47].
Désormais, et dans l'ensemble du territoire français (métropole, DOM et TOM), l'activité d'enquêteur de droit privé s'avère donc strictement encadrée[48]. Elle relève du contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, mais également des Préfets qui peuvent ordonner des fermetures administratives, et reste placée sous la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie nationale.
Tout cabinet, personne morale, doit être titulaire d'une autorisation administrative, et tout directeur, personne physique, d'un agrément individuel (actuellement de l'État par le biais du préfet[N 21] et, à partir de l'année 2012, par le Conseil national des activités privées de sécurité.
« Il convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui souhaite recourir à une agence de recherches privées, de vérifier que l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et de sa qualification professionnelle[49]. »
Une formation — notamment juridique — a été rendue obligatoire par une loi du et tout enquêteur privé doit justifier de sa qualification professionnelle s’il dirige une agence ou de son aptitude professionnelle s’il est salarié.
Il n'existait pas d'« ordre » institutionnel (type ordre des médecins, chambre des notaires, ou barreaux d'avocats)[N 22], la loi ayant donné le pouvoir de contrôler la profession :
- aux préfets pour l'honorabilité et la qualification professionnelle
- à la commission nationale de déontologie de la sécurité pour l'éthique
Cependant, en 2011[47], sans instaurer un organisme « ordinal » géré par la profession, le législateur a souhaité créer un organisme hybride, mi-ordre, mi-autorité administrative, le Conseil national des activités privées de sécurité qui devient, dès 2012, un organisme public de contrôle et de régulation commun à toutes les activités privées de sécurité, avec des pouvoirs de contrôle, de déontologie et de sanctions disciplinaires, administré par un collège essentiellement composé de magistrats, de membres des tribunaux administratifs et de représentants de l'État (cf. infra : autorité de contrôle et de régulation).
La loi du , modifiée par la loi du , a renforcé les prérogatives de la profession en lui donnant une définition très précise qui l’autorise à recueillir des renseignements et à effectuer des filatures :
« profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts[50]. »
Cette définition concerne toute entreprise qui procèderait à des enquêtes quelle que soit l'appellation utilisée et, par exemple, le dirigeant d'une société de « conseils » qui se prétendait tantôt « consultant », tantôt entreprise « d'intelligence industrielle », a été condamné pour avoir « exercé sans autorisation une activité de recherches privées »[51].
1995 : le tournant de la législation française

Les dangers de la situation internationale[52], les risques d'attentats, l'impossibilité pour les services officiels d'œuvrer dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas de leur compétence, les besoins des justiciables et de la recherche de preuves dans ces domaines judiciaires, la prise en considération de plus en plus fréquente des rapports d'enquêtes privées en justice, mais aussi le nombre grandissant d'agences dans ce pays[53] ont amené les pouvoirs publics français[54] à réviser leur position vis-à-vis de la profession par le dépôt d'un projet de loi[55] qui sera adopté début 1995.
Une nouvelle profession de sécurité
C'est ainsi que la loi du [56] reconnait, aux agences de recherches privées, la qualité de « profession de sécurité ». Son annexe I, précise que : « (…) les agences privées de recherches (…) exercent des activités de sécurité privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. (…) ».
Dès lors toute une série de lois et de décrets viendront règlementer cette fonction libérale pour lui conférer un véritable statut, l'assainir, contrôler son éthique, la professionnaliser, lui délivrer un agrément de l'État, la placer sous la surveillance des Commissaires de Police et des Officiers de Gendarmerie, lui imposer une formation juridique et technique, empêcher les excès et son exercice à des fins illégales, pour que les plaideurs et les juristes puissent faire appel à ses services en toute sécurité.
: une activité régie par le Code de la sécurité intérieure
La loi du a été, à son tour, abrogée et ses dispositions insérées dans le « code de la sécurité intérieure » créé par une ordonnance du [57] dont le titre 2, du livre VI réglemente désormais les agences de recherches privées[58].
Autorité de contrôle et de régulation
Par décision du gouvernement[59], le parlement fut saisi, fin 2010, d'importantes modifications pour renforcer la législation des enquêteurs privés, du gardiennage, des transports de fonds et de la protection physique des personnes, dans le cadre du projet de loi LOPPSI 2[60] :
- création d'une autorité de contrôle et de régulation : le « Conseil national des activités privées de sécurité »[61] dotée d'une mission de police administrative qui délivrerait, à la place des préfets, les agréments et les autorisations et assurerait les contrôles des professionnels ;
- délivrance d'une carte professionnelle ;
- assurance responsabilité civile professionnelle rendue obligatoire ;
- visites domiciliaires des cabinets sur autorisation judiciaire ;
- création d'un code de déontologie ;
- création de sanctions disciplinaires ;
- maintien de la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie sur les agences en complément de l'autorité de contrôle.
Une loi du [62] a donc, officiellement, donné naissance à ce nouvel organisme public qui dépend directement de l'État[63] et non des associations ou des syndicats de détectives privés, même si un représentant de chaque profession contrôlée par cet organisme public siègera au sein du collège[64].
Le Conseil national des activités privées de sécurité est donc une personne morale, de droit public, qui a désormais pour objet de contrôler, en France, toutes les professions privées de sécurité[65], de délivrer les autorisations d'ouverture des établissements, de délivrer les cartes professionnelles, d'établir une déontologie (d'ordre public contrairement à celle des associations et des syndicats de la profession), de prendre des sanctions disciplinaires, et de dénoncer, si besoin, au procureur de la République, les infractions pénales dont il pourrait avoir connaissance[66].
Pour résumer, on relève donc que la création du C.N.A.P.S. — introduite dans un nouveau titre 2 bis de la loi concernant les professions de sécurité privée — entraîne, pour cette nouvelle autorité administrative, tant des pouvoirs de police administrative (art. 33-2 [2°] de la loi du modifiée) que de justice disciplinaire (art. 33-5 [3°] de la loi)[67].
Cette nouvelle autorité correspond, d'ailleurs, à une qui existe déjà au Québec avec l'instauration du Bureau de la sécurité privée qui est, également, chargé de contrôler les professions québécoises de sécurité privée[68].
Secret professionnel
Le respect de la déontologie est l'une des toutes premières conditions pour exercer la profession, inspirer confiance et permettre aux « mandants » (clients qui mandatent un détective privé) de confier leurs secrets privés, intimes, familiaux, financiers, commerciaux, industriels, médicaux à un enquêteur privé ou à un enquêteur d'assurances.

Les détectives et enquêteurs privés peuvent, en adhérant à des organismes professionnels, être contraints de respecter la déontologie de ce syndicat ou de cette association, mais la première obligation, dans tous les pays du monde — au moins morale sinon juridique — est de ne pas dévoiler les informations confiées par un client.
La divulgation de renseignements confidentiels pourrait, en effet, entrainer l'éclatement de la cellule familiale, la perte de marchés pour les entreprises, le pillage de marques, de la clientèle ou de secrets de fabrication, voire des conséquences directes sur l'emploi une société pouvant tout simplement être mise en liquidation.
Il ne fait d'ailleurs aucun doute que les détectives privés peuvent avoir accès à des informations confidentielles voire « sensibles » et le législateur français à même renforcé, par une loi du [70], les conditions d'agrément des enquêteurs privés en raison, justement, des données sensibles qu'ils pouvaient détenir[71].
Un certain nombre de pays imposent donc l'obligation du secret professionnel, que ce soit par une loi spécifique à la profession, ou simplement par des dispositions de droit commun.
En France l'enquêteur privé est tenu[N 24] au secret professionnel[72] sous les peines édictées par l'article 226-13 du code pénal[N 25] : ainsi cinq décisions de justice confortent cette interprétation du droit commun[73], confirmée par un avis[69] de la Commission nationale de déontologie de la sécurité qui est une autorité administrative ayant pour objet de contrôler les détectives privés en France ainsi que d'autres professions de sécurité (police, gendarmerie, gardiennage etc.).
Relevons que le Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité indique dans son article article R-631-9 intitulé « Confidentialité » que : « (…)les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations (…) dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. » Ainsi, les détective privés sont également tenus au respect du secret professionnel par leur code de déontologie. Le contrôle de cette déontologie étant assuré par le Défenseur des droits.
Mais le directeur d'une agence de recherches privées est également tenu au secret par l'article 34 de la loi Informatique et Libertés[74] pour empêcher que les informations faisant l'objet d'un traitement informatique (rapports, missions, courriels, etc.) ne soient déformées, endommagées ou divulguées à des tiers non autorisés[N 26], à peine de très fortes sanctions pénales[75], ce qui l'oblige, par exemple, à chiffrer les informations transmises à son client par Internet[76].
On retrouve l'obligation du secret dans d'autres pays, comme au Canada où, par exemple, la loi du Manitoba sur les détectives et enquêteurs privés prescrit : « Except as legally authorized or required, no person shall divulge to anyone any information acquired by him as a private investigator[N 27]. »
En Belgique les détectives privés sont également tenus au secret professionnel[N 28] par l'article 10 de la loi du organisant la profession de détective privé qui prescrit : « Sous réserve des dispositions de l'article 16 §2, le détective privé ne peut divulguer à d'autres personnes qu'à son client ou à celles dûment mandatées par lui les informations qu'il a recueillies durant l'accomplissement de sa mission ».
Comme en France, certaines dérogations sont prévues en faveur d'autorités administratives ou judiciaires avec des garanties puisque les agents doivent être spécialement habilités par un mandat spécial[N 29] :
La violation de cette obligation est réprimée par l'article 19[N 30] de la loi organisant la profession de détective privé qui renvoie aux sanctions visées à l'article 458[N 31] du Code pénal belge punissant la violation du secret professionnel.
Toutefois les pénalités sont plus sévères[77] lorsque la divulgation commise est relative à la vie des personnes. Dans ce cas les peines d'emprisonnement sont portées de 6 mois à 2 ans (contre 8 jours à 6 mois pour la simple violation du secret professionnel prévue à l'article 458 du code pénal belge).
Il convient, d'ailleurs, de rappeler que le secret professionnel, d'une façon générale, a pour objet de protéger les clients qui viennent se confier et non à paralyser l'action publique ou les procédures judiciaires.
Mais le secret professionnel est également imposé en Autriche[78], d'une façon générale au Canada[N 32], tout autant qu'en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie[N 33], en Hongrie, à Malte et aux Pays-Bas.
Belgique
En Belgique, la loi[79] relative à l'exercice de la profession de détective, impose un certain nombre d'obligations déontologiques. Il n'existe pas de code de déontologie d'ordre public, mais, comme dans les autres pays, des associations ou syndicats peuvent disposer de codes internes à leurs organisations. C'est par exemple le cas de l'Union Professionnelle nationale des détectives privés de Belgique[80].
Ainsi son article 3 dispose que pour exercer il ne faut pas avoir commis un « manquement grave à la déontologie professionnelle » et son article 7 décrit certaines obligations déontologiques[N 34].
D'autres article (8 et 9, 10, 12) précisent d'autres obligations comme la signature d'une convention, avec description précise de la mission confiée, la tenue d'un registre de missions, la remise d'un rapport, l'interdiction pendant 3 ans de travailler contre les intérêts de son propre client, l'obligation de détenir une carte professionnelle, l'interdiction de faire état d'une ancien fonction de police dans son activité, l'interdiction de divulguer à des tiers les informations relatives à sa mission à peine de sanctions pénales pour violation du secret professionnel[81].
Par arrêté royal du [82], les fonctionnaires habilités à surveiller l'application de la loi du (donc de ses obligations déontologiques) sont désignés par le Ministre Belge de l'Intérieur parmi les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie ainsi que des fonctionnaires de la Direction générale de la Police générale du Royaume.
France

En France, il n’existait pas, jusqu'en juillet 2012, de code de déontologie pour les détectives et enquêteurs privés : chaque agence, chaque association, chaque syndicat, chaque fédération, chaque groupement possède ou édictait sa propre déontologie qui, quel que soit l’organisme dont elle émane — est et demeure un document officieux, sans valeur contraignante, opposable aux seules personnes qui acceptent de s’y soumettre.
C'est ainsi que sont nés, dans les années 1980, imposés par des fédérations, des codes édictées la Fédération nationale es Agences de Recherches (FNAR), ou encore la Fédération nationale des Détectives (FND), ou le Conseil Supérieur des Agents de Recherches.
En 1980 un code de déontologie avait d’ailleurs été créé par un organisme professionnel[83], et la Commission des Lois du Sénat qui avait, à l’époque, appuyé ce document auprès du Gouvernement[84], reçut une réponse négative du Ministre de l’Intérieur qui ne souhaitait pas créer un texte réglementaire[N 35].
Il existe donc des codes éthiques préparés par les syndicats de la profession, comme l'Union Fédérale des Enquêteurs et Détectives Privés[85], l'Association professionnelle des agents de recherches[86], le syndicat des enquêteurs d'assurances[87], l'association française des enquêteurs diplômés[88], l'association française des détectives enquêteurs, le Conseil Supérieur Professionnel des Agents de Recherches Privées[89], le Syndicat National des Agents de Recherches[90], la Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs privés[91], l'Office National des Détectives privés de France[92], le Groupement Régional des Agents de recherches, l'Association Française des Détectives, la Commission Interprofessionnelle des Agents de Recherches, l'Observatoire des Détectives Français[93], la Société Française des Détectives, le Conseil Interdépartemental des Agents de Recherches et d'Enquêtes, le Conseil National des Détectives et Enquêteurs privés, la Chambre Syndicale Nationale Professionnelle des agences privées de recherches et des mandataires en obtention de preuves et bien d'autres encore.
Les codes de déontologie ne sont pas récents puisque, déjà au XIXe siècle, Eugène François Vidocq imposait le sien à ses collaborateurs qui prescrivait, notamment dans un article 14 : « La discrétion étant l'âme d'une bonne administration, il est défendu aux commis et employés de toute classe de se communiquer réciproquement les notes, soit de surveillance ou de recherches, ni de parler des affaires dont ils sont chargés (…) ».
Plus récemment, en 1960, l'une des premières associations françaises en imposait un : l'Association Nationale de la Police Privée.
Cependant l’absence de « code de déontologie » d’ordre public pour les détectives privés ne signifiait pas qu’il n’existait pas une éthique à respecter. Elle perdure d'ailleurs toujours et ne relève pas d’un « code » mais de très nombreuses obligations de droit commun, telles que, par exemple, le respect du secret professionnel, l’établissement de factures, le respect de la vie privée, l’obligation de refuser une mission en vue d’une procédure administrative ou judiciaire à l’étranger, le chiffrement des mails comportant des données nominatives, la collecte légale de renseignements, le respect de la législation corporative, etc.
Une Autorité administrative indépendante, notamment composée de Magistrats et de Parlementaires[N 36] fut chargée, pendant 11 ans[94], de veiller au respect de l’éthique[95] par les détectives et enquêteurs privés[N 37], le secret professionnel ne lui était pas opposable : la Commission nationale de déontologie de la sécurité[N 38].
Cette Autorité administrative indépendante disposait de larges pouvoirs de vérification, y compris dans les locaux professionnels, et toute entrave à ses investigations était passibles de sanctions pénales[96].
En cas d’infraction elle pouvait saisir le Procureur de la République et même publier son rapport au Journal Officiel si les suites données à ses recommandations ne lui donnaient pas satisfaction.
La Commission nationale de Déontologie de la Sécurité s'est ainsi prononcée[97], pour la première fois, le 21 septembre 2009 sur l'éthique des détectives et enquêteurs privés en relevant deux obligations à respecter, par les membres de cette profession :
- le secret professionnel (« l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé »)
- « l'obligation de coopération loyale » avec le client ainsi que « l'obligation de loyauté à laquelle tout enquêteur est tenu à l'égard de son mandant ».
Accessoirement elle releva, également, que l'exercice de la profession sans agrément de l'État constituait une faute déontologique et qu'un enquêteur qui méconnaissait cette règle élémentaire de la profession se rendait « coupable d'un comportement constitutif d'un manquement déontologique et, le cas échéant, d'un délit pénal[98] ».
Par ailleurs la législation française, en cas d’infraction, permettait au Préfet d’ordonner le retrait d’autorisation de l’agence ou d’agrément de son dirigeant et le Tribunal peut, pour sa part, prononcer une fermeture judiciaire temporaire ou définitive de l’agence ou une interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession.
Le vote de la loi LOPPSI2 du 14 mars 2011, maintient, au Préfet, la possibilité de retirer la carte professionnelle d'un détective privé pour des motifs d'ordre public, mais la préparation d'un code de déontologie fut confiée à un établissement public administratif (C.N.A.P.S.), le contrôle de la déontologie restant, pour sa part, sous l'égide d'une autorité administrative constitutionnelle : le défenseur des droits, dans le cadre du collège « déontologie de la sécurité ».
Ainsi, le « défenseur des droits » est chargé, par la Constitution, de veiller au respect de la déontologie par l'ensemble des professions de sécurité (publiques et privées) tandis que le C.N.A.P.S, simple établissement public de régulation, est chargé, lui, d'en sanctionner disciplinairement les manquements portés à sa connaissance (par le défenseur des droits ou par des clients).
L'absence d'un code de déontologie d'ordre public a été comblé par un décret du 10 juillet 2012, publié au J.O. du 11.
Ce texte a été prévu par une loi du 14 mars 2011[99] qui a — une fois de plus — modifié la législation française, sans même laisser le temps à la précédente de s'appliquer[100], créant une nouvelle autorité publique dont le rôle est de contrôler l'ensemble des professions de sécurité privée — auxquelles appartiennent les enquêteurs privés — mais également d'établir un code de déontologie[101] dont les manquements feront l'objet de sanctions disciplinaires[102]. Cet établissement public administratif entra en fonction le [103].
Le respect de la déontologie de droit commun — beaucoup plus large qu’un code d’éthique corporatif qui s'avère nécessairement succinct — est et restera une obligation pour les agences de recherches privées comme pour les détectives et enquêteurs privés qui les composent à peine de sanctions administratives, disciplinaires et/ou pénales[N 39].
Il n'est sans doute pas inutile de préciser qu'outre les contrôles opérés par le C.N.A.P.S. — nouvelle autorité de régulation dotée de pouvoirs de type « ordinal » — les détectives privés pourront, également, être contrôlés par le défenseur des droits, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et qu'ils restent placés sous la surveillance de commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie qui disposent, aussi, d'un droit de visite des cabinets d'enquêtes privées, ce qui porte à au moins 4 autorités publiques les possibilités de contrôles administratifs des agences de recherches privées !
La disparition de la C.N.D.S. ne devrait pas, en tous les cas, faire disparaître la « jurisprudence » administrative qui résulte de l'avis rendu par son assemblée plénière du 21 septembre 2009.
À signaler, parmi les devoirs déontologiques des agences françaises de détectives privés, l'obligation de souscrire un contrat d'assurance « Responsabilité Civile Professionnelle »[104].
La profession de détective privé est strictement réglementée, au Québec, d'abord par une loi sur les agences d'investigations datant de 1962 puis par la loi du 14 juin 2006 sur la sécurité privée.
La situation actuelle du Québec est un peu particulière puisque la loi de 2006 ne doit entrer que progressivement en vigueur et que, dans cette attente, celle de 1962 continue de s'appliquer.
Ce n'est d'ailleurs pas le seul pays qui se trouve entre deux règlementations puisque la France est dans le même cas (en septembre 2008) avec une législation de 1942 abrogée depuis le 18 mars 2003, et une nouvelle législation votée à cette même date mais qui n'est pas encore opérationnelle car il manque le principal décret sur les agréments et les autorisations préfectorales (prévu à l'article 22 de la loi française).
La nouvelle législation, qui n'est pas encore applicable, renvoie à des textes complémentaires (les « règlements ») qui ne sont pas encore promulgués.
Ainsi, par exemple, le secret professionnel prévu à l'article 9 de l'ancienne loi (toujours en vigueur) n'est pas mentionné dans la nouvelle loi qui s'adresse à plusieurs professions. Il sera donc très probablement repris dans les règlements à venir sur les « agents d'investigations », textes qui doivent compléter la loi sur la sécurité privée.
En effet, le « Bureau de la sécurité privée » peut, par règlement (article 107 §6°) fixer les normes de comportement que doivent respecter les différentes catégories d'agents régis par la loi sur les professions de sécurité.
Suisse

Il n'existe pas, non plus au sein de la Confédération suisse, de « code éthique » d'ordre public, mais des dispositions déontologiques qui sont imposées par le droit commun ou par les législations cantonales spécifiques aux détectives privés (pour rappel la profession n'est pas règlementée au niveau fédéral mais au niveau cantonal dans ce pays).
Ainsi, dans le canton de Genève, la législation interdit, dans les justificatifs d'activités des agents de renseignements du canton de Genève d'utiliser le mot « police » ou « policier »[105], et dans le « canton du Jura » elle interdit les mots « diplômés » ou encore « reconnu par l'État »[106], etc.
En Suisse également, les organismes de détectives proposent des codes de déontologie syndicaux comme l'Association professionnelle des Détectives Suisses.
Cartes professionnelles
Avant la création du CNAPS[107] "Conseil National des Activités Privées de Sécurités", en France, aucune carte professionnelle « officielle »[N 40] pour les enquêteurs de droit privé[N 41] : chaque agence, chaque syndicat pouvaient en créer une sous réserve qu'elle ne présente aucune ressemblance avec des cartes et documents officiels (notamment celles en vigueur dans les services de Police et de Gendarmerie) car cela tomberait alors sous le coup des lois pénales[N 42].
Cette situation a évolué avec la loi dite « LOPPSI II » du 14 mars 2011[108], le législateur a ainsi voté le principe d'une carte professionnelle[109] délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Sous l'empire de l'ancienne réglementation[110], les préfets délivraient un récépissé de déclaration que les agents privés présentaient en cas de contrôle par un service public.
Depuis la nouvelle législation[111] le récépissé de déclaration — devenu caduc et dénué de valeur juridique — a été remplacé par un agrément délivré, au nom de l'État, par l'Autorité administrative.
Cet agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral que les professionnels portent en général sur eux pour justifier de leur qualité en cas de contrôle par un service de Police et de Gendarmerie (ce que l'on peut comprendre si l'enquêteur est en surveillance à proximité d'un lieu sensible par exemple) ou au cours de leurs investigations.
Depuis 2012, l'agrément préfectoral est, lui aussi, remplacé par un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité, autorité indépendante de contrôle et de régulation dotée de pouvoirs de police administrative, mais également de pouvoirs ordinaux (discipline, déontologie, contrôles).
Les délégations du Conseil national des activités privées de sécurités, les CIAC[112] "Commission Interrégionales des Agréments et de Contrôle" assurent la délivrance des agréments pour les directeurs d'agences et des cartes professionnelles pour les salariés.
En Suisse, dans le canton de Genève, le Conseil d'État délivre une carte professionnelle avec photographie du détective privé qu'il peut présenter sur demande[113].
En Belgique[114] : dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé doit toujours être porteur de la carte d'identification mentionnée à l'article 2. Il doit remettre cette carte[113], pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent visé à l'alinéa 1er de l'article 17.
Au Canada[115], les détectives possèdent également une carte d'identité professionnelle qu'ils peuvent présenter à toute réquisition des autorités publiques, des clients ou des tiers.
Formations et diplômes
Dans un certain nombre de pays il est nécessaire de suivre des formations reconnues. Cependant, il existe aussi de nombreuses écoles ou instituts privés, des plus sérieuses aux moins crédibles, pour se former à la profession de détective privé.
La formation technique et juridique est une condition nécessaire pour garantir le sérieux des enquêtes privées et des professionnels qui exercent cette activité.
Belgique
En Belgique, l'obligation de formation est imposée par l'article 3 (3°) de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé qui exige de « satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelle arrêtées par le Roi ».
France

En , le Répertoire National des Certifications professionnelles, un établissement public d'enseignement supérieur créé un diplôme universitaire professionnel d'enquêteur privé puis un diplôme universitaire professionnel de directeur d'enquête privées () qui s'adresse aux directeurs d'agences de détectives privés, ce diplôme est remplacé en 2006 par un diplôme d'État.
En , la France créée un diplôme d'État reprenant, pour les détectives, l'appellation enquêtes privées (Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes, option « enquêtes privées »), délivrée par l'Université Panthéon-Assas, diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications professionnelles, en juillet 2007, sous la même appellation d'enquêtes privées.
Dix ans après la création — historique en France — du premier diplôme public par l'Université Panthéon Assas Paris 2, et un an après celle de son diplôme d’État — l'université de Nîmes proposera, à son tour, une licence professionnelle « agent de recherche privé ». Deux autres universités tenteront, elles aussi, de créer des diplômes équivalents pour finalement y renoncer.
Les écoles privées peuvent proposer depuis la promulgation du décret 2009-214 du 23 février 2009, un accès à la profession que ce soit en qualité de directeur d'agence ou d'enquêteur salarié, sous certaines réserves[N 43].
D'autres écoles privées peuvent dispenser un enseignement dans le cadre de la formation continue[N 44].
Par contre les titres qu'elles délivrent ne sont pas des diplômes mais, selon le cas, un certificat de qualification ou de suivi des cours, les diplômes étant une prérogative de l'enseignement public[N 45].
Il est totalement inutile de suivre une formation inscrite au R.N.C.P. que ce soit pour exercer en dehors du territoire français ou pour acquérir des connaissances personnelles ou encore pour exercer dans une entreprise, une assurance, un hôtel, un magasin, ou encore pour suivre des stages de perfectionnement dans le cadre de la formation continue.
Il existe donc diverses formations publiques et diverses écoles privées adaptées à chacun en fonction de ses besoins ponctuels : aucune école privée ne peut s'arroger, en France, un monopole de formation.
Ainsi, il sera, par exemple, suffisant à l'étranger, de s'adresser à une école par correspondance ou, en France, d'obtenir un diplôme d'Université[N 46] « enquêteur privé »[116] lorsqu'une formation qualifiante ne sera pas nécessaire.
De même ce Diplôme Universitaire Professionnel délivré Panthéon Assas Paris 2 permet d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de détective dans les Territoires d'Outre Mer non soumis à la loi du 12 juillet 1983, ainsi que dans les Collectivités territoriales à statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie.
Enfin, en France, le détective privé doit détenir trois agréments délivrés par le CNAPS : une autorisation d’établissement (AUT), l’agrément de dirigeant (AGD) et une carte professionnelle (CAR) qui doit être renouvelée tous les 5 ans. A savoir, depuis 2018 la carte professionnelle est renouvelée si l’enquêteur de droit privé « justifie d’un maintien et d’une actualisation des compétences en validant 35 heures de formation continue ».
Canada / Québec
Au Canada, il existait, comme en France ou en Belgique, des écoles privées qui s'étaient spécialisées dans la formation des enquêteurs privés.
Au Québec, la formation, obligatoire depuis juillet 2010, est contrôlée par le Bureau de la sécurité privée et prise en charge par les CEGEPs (Collège d'enseignement général et professionnel).
La législation impose, de toute façon, une « formation » généraliste :
- Un diplôme d'études secondaires est exigé.
- Un diplôme d'études collégiales en droit et en sécurité peut être requis.
- Une formation en cours d'emploi peut être offerte.
- De l'expérience comme policier peut être exigée des agents de sécurité d'entreprise.
- Un permis provincial est requis des enquêteurs privés.
En droit, toujours au Canada, la licence de détective privé est délivrée par la « Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité » nommée par le ministre, qui vérifie que la personne, ou celle devant diriger l'agence, possède l'expérience et la formation qui, selon la Commission, sont nécessaires à l'exploitation de cette l'agence. Il en est de même pour les agents de l'entreprise.
Suisse
En Suisse, il n'existe pas de formation de détective reconnue au niveau national[117].
Stages
Le stage en vue d'obtenir la qualification professionnelle pour exercer la profession est soumis — en France — à une autorisation préalable du préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord ou le refuser en fonction de l'enquête effectuée par les services de police et des vérifications effectuées auprès des autorités judiciaires.
Dans les faits, compte tenu de la surcharge des services administratifs, il conviendra de compter un délai de 2 à 6 voire 8 mois pour obtenir cette autorisation, d'où la nécessité, pour les étudiants, de rechercher longtemps à l'avance un maitre de stage (ou plusieurs).
Nota : la demande d'autorisation de prendre un stagiaire est faite par le maître de stage et non par l'étudiant auprès de l'autorité administrative[118]. Cette règlementation ne concerne évidemment que le territoire français et n'est pas applicable aux autres pays francophones.
En revanche, les stages effectuées par un étudiant dans le service d'enquêtes d'une banque, d'une compagnie d'assurances, ou d'une grande entreprise, n'est pas sujet à déclaration ni contrôle du Préfet[N 47]. Au surplus le décret sur la formation professionnelle ne concerne que les formations « qualifiantes »[119] et n'est donc pas applicable aux formations non qualifiantes[N 48].
Validité en justice des rapports d'enquêtes privées
Belgique

La jurisprudence est à peu près identique pour la Belgique et pour la France, le code civil belge[120] prévoyant la même faculté d'appréciation des magistrats et les mêmes réserves que le code civil français.
Ainsi un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles[121] stipule, par exemple, que : « Le rapport d'un détective privé produit dans le cadre d'une procédure en divorce pour cause déterminée ne peut être tenu pour dénué de toute valeur probatoire que lorsque les constatations qui s'y trouvent ne sont corroborées par aucun autre élément de la cause »[122].
On peut toutefois relever une appréciation moins favorable des rapports d'enquêtes privées en matière relevant du droit du travail[N 49] qu'en matière d'adultère, par exemple, où la loi reconnaît aux détectives belges un rôle actif dans ce cadre[123]. La preuve par rapport de détective privé est donc, en principe, admissible dans le cadre d'une procédure en divorce[124].
La Justice Belge considère également, en matière pénale, que le fait qu'une instruction soit en cours n'interdit pas à la partie civile de faire appel à un détective privé en ce qui concerne le dommage créé par l'infraction aux fins de communiquer les renseignements au juge d'instruction[125].
France
La loi du 18 mars 2003 confirme le caractère libéral de la profession, définit cette activité et valide le principe des surveillances et filatures.

La valeur des rapports d'enquêtes privées dépend, en fait, de plusieurs facteurs en fonction de l'affaire : en droit du travail, par exemple, des dispositions législatives interdisent aux employeurs de prendre en considération des contrôles effectués à l'insu des salariés[N 50]. Dans ces conditions, un rapport d'enquêteur privé (comme un constat d'huissier ou toute autre preuve recueillie à l'insu du salarié) serait rejeté comme étant illicite, mais des dispositifs juridiques permettent de contourner, légalement, ces dispositions pour justifier, même en droit du travail, la saisine d'un enquêteur privé[N 51].
Par contre, en droit civil, en droit commercial, en droit pénal la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens et dans ces domaines les témoignages et dépositions d'agents de recherches privées sont régulièrement produits et souvent pris en compte par les Tribunaux sous certaines conditions légales.
Ainsi, en droit civil, depuis un arrêt datant de 7 novembre 1962[126], la Cour de cassation reconnaissait déjà, en principe, la validité des rapports et témoignages d'enquêteurs privés sous les réserves exigées par la loi (légalité de la mission, légitimité de la preuve, identification de l'enquêteur, absence d'animosité, caractère détaillé, précis et circonstancié du rapport).
En effet, l'article 1382 du Code civil[N 52] français[N 53] donne, aux magistrats, un pouvoir souverain pour apprécier une offre de preuve, l'accepter ou la rejeter.
Sur ce point la jurisprudence est constante[127], mais trop volumineuse pour être rapportée sur un service qui n'a pas de vocation juridique mais simplement de présenter la profession[128].
Citons, simplement, un arrêt de Cour d'appel[129] qui résume parfaitement la situation et l'évolution juridique sur la prise en compte des rapports d'enquêtes privées :
« les constatations effectuées (…) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (…) »
C'est d'ailleurs cette évolution de cette profession vers une activité juridique et la recherche de preuves en vue de procédures civiles ou commerciales, qui ont décidé le législateur à la règlementer.
La « moralisation » et la « professionnalisation » des enquêteurs privés ne peuvent que garantir, aussi, la valeur des témoignages produits en justice et faciliter leur prise en compte laissée à l'appréciation des magistrats.
Comme le rappelait le ministre de l'Intérieur français, dans une réponse écrite publiée au Journal officiel : « … s'agissant de la contribution des agents de recherches privées à la manifestation de la vérité dans le cadre des actions en justice, il est déjà loisible aux justiciables de produire un rapport d'agent de recherches privées devant le juge, qui demeure libre d'en apprécier la valeur probante »[130].
Suisse
La Confédération suisse reconnait, elle aussi, la validité des rapports de détectives et enquêteurs privés tant dans le cadre des juridictions cantonales que fédérales et considère, par exemple, que dès lors que des investigations ont été demandées par une société d'assurances pour démontrer l'existence d'une fraude, la recherche de la preuve prime sur la vie privée sous certaines réserves.
Ainsi, le Tribunal fédéral a donné raison à une compagnie qui refusait, depuis septembre 2004, d'indemniser un assuré (commerçant victime d'une chute en 2003) en relevant, à la suite des constatations d'un détective privé, qu'il travaillait 12 heures par jour[131].
Rapports entre police et détectives
Une légende voudrait qu'il existe une « collusion » entre les services de police et les enquêteurs privés.
Cet amalgame résulte essentiellement du fait que d'anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie ouvrent une agence au moment de leur retraite.
D'autre part, avant la réforme (France) du divorce de 1975, les constats étaient réalisés par les services de police car l'infidélité était, à l'époque, un délit pénal.
Cela entrainait donc, obligatoirement, des contacts pour la réalisation du constat d'adultère avec le service de police désigné par le juge.
Depuis les constats sont dressés par les huissiers de justice et ces contacts n'existent donc plus.
La profession a parfois, aussi dans le passé, été considérée comme une « police parallèle », une « concurrente » des services officiels, mythe qui résulte de l'image des détectives reflétée par certains romans noirs, feuilletons télévisés et films policier au cinéma.
Qu'il s'agisse des romans de Chandler, avec ses détectives « cow-boy » entourés de jolies blondes, qui roulent en voiture décapotable, le Smith et Wesson à portée de main, en passant par Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, le détective privé « virtuel » s'occupe d'affaires criminelles et parvient toujours à trouver les coupables lorsque la police est tenue en échec.
Ce mythe, fortement ancré dans l'esprit du public (la force de la télévision n'y est sans doute pas étrangère) ne correspond aucunement aux réalités françaises, dans un pays qui s'affiche comme le défenseur des libertés fondamentales.
Qu'en est-il alors des différences entre la police et les détectives ?
Pour faire simple, les premiers interviennent dans le cadre des procédures pénales, les second dans celui des procédures civiles et commerciales, deux domaines qui ne se chevauchent pas et pour lesquels la République française ne met pas les mêmes moyens à la disposition des justiciables.
Pour résumer, la Police nationale, les polices municipales, la Gendarmerie nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pénales (ou administratives) sanctionnées par des peines d'amende et/ou de prison : ces services défendent les intérêts de la société.
Les détectives et enquêteurs privés, pour leur part, interviennent dans le cadre des affaires privées, professionnelles, civiles et commerciales, c’est-à-dire dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels : ils défendent des intérêts particuliers.

En effet, la police n'a pas qualité et donc n'a pas le droit d'intervenir dans le cadre de ces affaires civiles et commerciales, ce qui est un bien pour les libertés individuelles et permet d'avoir l'assurance que la vie privée, les problèmes de santé, la vie professionnelle, la vie familiale, les finances, les affaires, et la vie intime ne seront pas « fichés » dans les administrations policières.
Par ailleurs il n'existe pas de juge d'instruction, en procédure civile et commerciale, pour mener des enquêtes comme en procédure pénale (le juge civil étant un simple arbitre qui tranche en fonction des éléments et des preuves apportées par les parties).
Le rôle des enquêteurs de droit privé est donc de rechercher, établir et fixer les preuves nécessaires aux juristes et aux plaideurs dans ces domaines, en apportant la garantie du secret professionnel et que le professionnel se consacrera aux recherches destinées à défendre les intérêts du requérant.
Les détectives n'interviennent-ils jamais dans le domaine pénal ?
En France, le domaine pénal est l’attribut régalien de l’État. Cependant, un détective privé au pénal peut intervenir et collecter des éléments de preuve utiles pour défendre les intérêts du mandant. Par respect de la procédure pénale, un détective privé ne pourra pas investiguer simultanément avec une enquête ou une instruction judiciaire. Donc, l’action d’un détective privé dans le cadre pénal se porte en amont ou en aval de la procédure. Cela concerne les enquêtes pré-pénales et les contre-enquêtes pénales.
En matière d'escroquerie aux assurances, l'enquêteur privé sera saisi par une compagnie aux fins de déterminer — avant le dépôt d'une plainte — si l'assureur a, ou non, été victime de ce délit, car tout dépôt de plainte infondé pourrait entraîner sa condamnation pour « dénonciation calomnieuse »[132].
Si l'enquête privée permet de conclure à une fraude, l'assureur déposera plainte et, mais alors seulement, les services de police prendront le relais, l'enquêteur privé s'effaçant.
Dans le cadre de « contre-enquêtes pénales », l'enquêteur privé agira, après une condamnation (ou une fois l'instruction officielle achevée) pour vérifier les éléments, en chercher de nouveaux qui permettraient d'innocenter un prévenu ou d'obtenir une révision du procès.
Là encore, les services de police n'ont plus à intervenir leur mission étant achevée.
Il ne peut donc y avoir la moindre confusion entre services officiels et enquêteurs privés qui interviennent dans des domaines totalement distincts.
Les arguties consistant à mettre en concurrence la police et les détectives relèvent donc d'une totale méconnaissance de la profession, voire dénote une absence totale de formation juridique pour confondre procédure pénale avec les procédures civiles ou commerciales.
Quels sont les rapports actuels entre la police et les détectives ?
Il n'existait pas de rapports institutionnels entre les services officiels de police et de gendarmerie jusqu'à l'intervention de la loi du 18 mars 2003 qui place les agences de recherches privées sous la surveillance, pour le compte de l'autorité administrative, des commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie nationale.
Il eût certainement été préférable que la profession, une fois réglementée, soit placée sous la tutelle de l'autorité judiciaire (et non du préfet) à l'instar des « experts judiciaires » ou « des enquêteurs de personnalité » puisqu'il s'agit d'une activité auxiliaire des professions juridiques et non pas d'une activité auxiliaire de police.

Toutefois les contrôles de l'autorité administrative n'autorisent aucunement les services de police et de gendarmerie à prendre connaissance des dossiers traités ou de l'identité des clients, ces informations étant couvertes par le secret professionnel.
En fait, les relations entre les services officiels et la profession sont celles de n'importe quel autre citoyen : celles d'un simple « témoin » sur des affaires que l'enquêteur privé a pu traiter et qui sont reprises dans le cadre d'une procédure pénale.
Ainsi, par exemple, en matière de contrefaçon ou de fraude aux assurances, les « privés » peuvent communiquer, à la demande d'un client et en qualité de représentant du plaignant, des informations complémentaires sur les dossiers traités qui ne figurent pas nécessairement dans les rapports transmis, et ce, afin de faciliter l'enquête officielle.
Les missions de l'enquêteur privé

L'activité, n'a rien à voir avec le « mythe » de la profession développé par les romans noirs, le cinéma policier et les feuilletons télévisés comme démontré ci-dessus.
L'enquêteur privé en France est, un auxiliaire aux entreprises et des professions juridiques au service de la recherche de preuves et de renseignements légitimes. L'enquêteur privé est donc très large et peut regrouper diverses activités et professions privées telles que :
- le commissaire-enquêteur (qui exerce une profession libérale, et qui est désigné soit par les Préfets, soit par les juridictions administratives pour effectuer des enquêtes publiques) ;
- l'enquêteur de personnalité (qui est également une profession libérale, il est commis selon le cas par un juge, ou le procureur pour effectuer des investigations sur la « personnalité » d'un prévenu dans le cadre du code de procédure pénale) ;
- l'enquêteur social : également profession libérale, il intervient à la demande du juge civil pour effectuer une enquête sociale sur une famille, un enfant (notamment, par exemple, dans le cadre des procédures de divorce) ;
- détectives privés, enquêteurs privés, enquêteurs d'assurances, etc.
Cette appellation pour les détectives privés et enquêteurs privés a été adoptée, en France en 1997, par une organisation professionnelle, dénommée Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé, qui souhaitait se démarquer du mythe préjudiciable aux activités de la profession de détective privé.
L’enquêteur ou détective privé peut, aujourd'hui, intervenir dans le cadre de très nombreux dossiers tels que :
- conflits familiaux (problèmes avec les enfants mineurs…),
- constatations liées à l'infidélité conjugale ou constat judiciaire d'adultère[133] - [134]
- litiges professionnels (pratiques déloyales)
- litiges économiques (prévention des risques commerciaux, étude d’une entreprise et de ses dirigeants)
- litiges financiers (recherches sur débiteurs, solvabilité)
- litiges d'assurances (circonstances de sinistres, recherche d’une victime ou de ses héritiers pour verser des indemnités, contrôle du préjudice réel…).
- lutte contre la fuite d'informations : l'enquêteur est chargé de cerner l'origine des « fuites » afin d'y mettre un terme (elles peuvent être liées à un personnel malveillant, à de l'espionnage par micros : la « contre mesure électronique » permet de les localiser et de les mettre hors d'état de nuire) ou tout simplement de négligences, etc.
En France, la recherche des bénéficiaires[N 54] de contrats d'assurance vie parait bien constituer une activité de recherche privée soumise à autorisation administrative préalable.
En Belgique, les personnes qui se livrent à la recherche d’héritiers dans le cadre de l’ouverture d’une succession sont également soumises à la législation sur les détectives privés[N 55].
Le détective ou enquêteur privé peut intervenir, avant saisine des services officiels, pour rechercher les éléments de preuve d’une infraction pénale qui permettra au client de déposer plainte sans risque de poursuites pour dénonciation calomnieuse (par exemple en cas de soupçons de fraudes aux assurances), ou pour identifier des contrefaçons.
Très accessoirement, après un jugement, il peut rechercher des éléments nouveaux pour permettre une révision du procès ou un appel (« contre enquête pénale »).
Ces quelques exemples ne sont évidemment pas exhaustifs et l'on citera, pour mémoire, l'activité de la profession qui, pour l'article 1er de la loi Belge du 19 juillet 1991, précise qu'elle a pour objet de :
- rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés ;
- recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes ;
- réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits ;
- rechercher des activités d'espionnage industriel ;
- exercer toute autre activité définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les moyens et méthodes

Les moyens, méthodes et matériels des détectives et enquêteurs privés dépendent de nombreux facteurs à commencer par la réglementation corporative et la législation de droit commun dans chacun des pays : il est donc impossible de lister les méthodes d’investigations d’une façon générale, à l’exception, bien évidemment, de quelques moyens et matériels courants qui sont généralement communs à tous les pays.
Les recherches utilisent, d'abord, l’enquête de voisinage, qui permet, souvent, d’obtenir des informations intéressantes (sauf dans les grands centres urbains où les voisins se connaissent moins).
Ces vérifications locales sur place sont ensuite complétées par des constatations objectives directes, c'est-à-dire des surveillances et filatures avec mise en œuvre des matériels nécessaires tels que « sous-marin » (véhicule de surveillance)[135], voitures, motos, en fonction des difficultés et de la typographie des lieux.
Quelques matériels courants sont, évidemment, indispensables comme les appareils photographiques, téléobjectifs, caméras numériques[N 56], voire, pour les cas difficiles, des appareils miniaturisés[N 57] qui permettent des prises de vues sur la voie publique dans la plus totale discrétion.

Bien évidemment toutes les prises de vues sont soumises aux obligations légales des législations internes : en France, par exemple, il n’est pas possible de prendre une photo ou d'enregistrer des conversations dans un lieu privé sans le consentement de la personne concernée ce qui interdit cette méthode dans de telles enceintes[136], y compris, d'ailleurs, sur la voie publique pour des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Or il existe des appareils (en vente sur Internet) qui permettent à tout un chacun de se livrer à l'espionnage privé, commercial ou industriel, voire politique ou syndical, alors que leur utilisation, leur fabrication, leur détention, l'exposition, l'offre, la location et la vente — et même la publicité pour ce type d'appareils — sont formellement prohibées (toujours dans notre exemple français précité mais dans certains autres pays également), par les articles 226-1 à 226-3 du code pénal à peine de 5 ans de prison et de 300 000 euros d'amende.
Ces matériels, sophistiqués mais peu chers, émettent dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.
Le rôle du détective sera de rechercher ces émetteurs clandestins pour les mettre hors d’état de nuire, ce qui s’appelle de la « contre-mesure électronique ».
Cette méthode de contre-espionnage électronique est régulièrement mise en œuvre dans les entreprises sensibles ou les permanences politiques, chez les juristes (avocats) qui craignent des écoutes sauvages en raison de leurs engagements professionnels, ou encore dans les foyers où des conflits sérieux sont à déplorer, mais aussi dans les locaux syndicaux ou de dirigeants d’entreprises qui craignent d’être espionnés (Présidents, directeurs généraux, locaux de réunions confidentielles, comité d'entreprise, local syndical…).
Dans les pays en pointe, sur le plan technologique, la France pour reprendre cet exemple, les détectives disposent de moyens informatiques sophistiqués leur permettant de consulter des bases de données publiques ou privées, souvent payantes parfois gratuites, susceptibles de leur fournir des informations très précises sur une personne dénommée, ou d’identifier rapidement une entreprise, sa direction, son endettement, ses associés, etc.
Sur le plan informatique, de puissants logiciels spécialisés permettent de mettre en surveillance une entreprise, et d’être informé de modifications intervenues sur la Société que ce soit dans la presse, sur Internet, les réseaux sociaux, ou dans des fichiers administratifs publics : cela s'appelle de la veille technologique.

Sur le plan technique et en fonction des pays, des législations et de la typographie des lieux, des moyens de communications s’avèrent indispensables : GSM (téléphones mobiles), équipements de radiocommunications qui varient selon les fréquences utilisés[N 58].
Des « oreillettes » discrètes sont aussi utilisées pour les filatures à pied afin de rester en contact permanent entre « fileurs ». Elles sont pratiquement invisibles.
La législation interne à chaque pays peut également permettre d’obtenir des informations détenues par les administrations publiques « blanches »[N 59] ou « grises »[N 60] sur une personne préalablement connue, d’où la nécessité d’une excellente formation juridique pour connaître les sources légales de l’information, mais également les conditions à mettre en œuvre pour les obtenir.
Pour rester sur l’exemple français, lorsque des informations « confidentielles » sont nécessaires à l’administration de la preuve, le secret peut être levé par une décision du juge compétent[137] qui peut donc autoriser l’identification d’une preuve (numéro de téléphone, d’une adresse IP, d’une immatriculation de voiture, etc.) voire ordonner un constat judiciaire dans des lieux privés ou faire entendre des témoins susceptibles d’éclairer la partie requérante.

Il existe donc, en matières civile et commerciale (qui ne relèvent pas, en France pour rappel, des services officiels de police et de gendarmerie) une collaboration entre les enquêteurs de droit privé et les avocats pour l’obtention des preuves par des moyens licites et variés : enquêtes, recherches, filatures, constats.
Ces procédures ne sont évidemment pas valides dans tous les pays et nécessitent des législations et moyens juridiques adaptés.
Enfin, les détectives, tenus au secret professionnel et au respect de la vie privée ou professionnelle de leurs clients se doivent de protéger les informations qu’ils détiennent.
Ils utilisent, ainsi, des moyens de chiffrement, en fonction des législations de chaque pays, et les courriels qu’ils adressent à leurs clients doivent être chiffrés pour empêcher leur interception par des tiers non autorisés.
L'avenir de la profession en France
.jpg.webp)
Nous avons vu que l'enquêteur intervient en droit civil et commercial dans le cadre de nombreux litiges qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie.
Par ailleurs l’expert judiciaire, nommé par le juge, ne peut intervenir que pour établir les responsabilités et fixer le montant d’un préjudice, et l’Huissier de Justice, aux termes d’une ordonnance de 1945 qui réglemente cette profession, ne peut procéder qu’à des constatations purement matérielles et ne peut effectuer d’enquêtes. Et comme il n'existe pas, en procédure civile, de juge d'instruction chargé de diligenter les investigations pour recherches des preuves, il ne reste donc qu’une seule activité, dans notre pays, pour rechercher, établir et fixer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige : l’enquêteur ou détective privé.
Certains, qui restent très rares, commencent à être désignés par les Tribunaux pour effectuer une mesure d’instruction.
C'est ici probablement que se situe l'avenir de la profession : la possibilité pour certains enquêteurs (disposant d'une bonne formation juridique), d'intervenir pour le compte du juge, et devenant, ainsi, de véritables auxiliaires de justice.
Cette procédure aurait en effet le mérite de faire contrôler la mission par la justice, garante des libertés individuelles et fondamentales, de compléter les lacunes de la procédure civile où il n'existe pas de professions judiciaires chargées de procéder à des investigations, de contrôler le travail du technicien, de garantir son impartialité et de fixer, judiciairement, le montant de ses frais et honoraires.
La société, les libertés, les justiciables et la profession ne pourraient qu'y trouver intérêt.
Outre cette spécialisation, dans le cadre du droit civil et commercial, un certain nombre d'acteurs juridiques de la procédure pénale souhaitent renforcer les droits de la défense en ayant la possibilité de faire appel à un enquêteur privé pour rechercher les preuves à décharge de leurs clients.
Ainsi, en 1997[138], le Conseil national des barreaux[N 61] a suggéré une telle possibilité, avec faculté que le justiciable économiquement faible puisse bénéficier, à ce titre de l'aide judiciaire[N 62].
La demande de pouvoir faire diligenter une enquête privée a, d'ailleurs, été reprise en 2006[139] par le Barreau de Paris, à la suite de l'affaire d'Outreau.
En janvier 2009, devant la Cour de cassation[140], le président de la République française a évoqué une réforme de la procédure pénale et la suppression du juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction.
L'évolution de la procédure « inquisitoire » vers une procédure de type « accusatoire » pourrait donc renforcer les domaines d'intervention de l'enquêteur privé, mais l'avenir (proche) permettra — seul — de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.
Certains juristes suggèrent, en France, d'autoriser les enquêteurs privés à intervenir en procédure pénale, dans le cadre d'un nécessaire et légitime renforcement des Droits de la Défense. Il ne s'agit, pour le moment, que de propositions (néanmoins transcrites en 1997 dans un rapport du Conseil national des Barreaux et en 2006 dans un rapport du Barreau de Paris) qui ne recueillent pas encore l'avis favorable du ministère de la Justice. Le Garde des Sceaux s'est, en effet, exprimé contre une modification des dispositions relatives aux enquêteurs privés dans le cadre de la réforme de la procédure pénale[N 63].
Il n'en demeure pas moins que les enquêteurs privés participent aux Droits de la Défense, ce qui est désormais reconnu par une autorité administrative de la République française[141] la Commission nationale de déontologie de la sécurité (C.N.D.S.).
Dans ces conditions, le renforcement des Droits de la Défense pourrait entraîner, de façon plus régulière et selon les possibilités juridiques qui seront accordées aux avocats par la réforme de la procédure pénale, un recours à des techniciens, des experts, des Huissiers de Justice comme à des enquêteurs de droit privé.
Relations entre la profession et les avocats
Les relations entre les détectives et les avocats, comme d'une façon générale avec les auxiliaires de justice, sont excellentes car l'enquêteur, depuis toujours, est leur auxiliaire direct.
Bien sûr il y a des « exceptions » qui, par méconnaissance de la profession — telle qu'elle est désormais réglementée et exercée — peuvent craindre des abus (dont on ne peut nier l'existence).
Les détectives et enquêteurs privés sont, aujourd'hui, l'une des professions réglementées, contrôlées, surveillées (même le code monétaire et financier inclus des dispositions les concernant pour empêcher leur prise de contrôle par des sociétés étrangères[142]).
À la suite de la désastreuse affaire d'Outreau (dans laquelle des innocents ont été incarcérés avant d'être libérés et que leur innocence soit établie), le Barreau de Paris a souhaité qu'il soit donné aux avocats la possibilité de conduire des enquêtes privées, preuve de la nécessité de pouvoir faire appel à la profession[143].
Mais déjà l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux avait souhaité, dans un rapport — dès 1997 — que les avocats puissent faire appel à un « agent privé de recherches », et même que les honoraires puissent être pris en charge par l'aide judiciaire (aide juridictionnelle)[138].
Organisation professionnelle
Il n'existait en France, jusqu'au 14 mars 2011, aucun organisme institutionnel, de type ordinal, dans cette profession et le Gouvernement n'a jamais eu l'intention, contrairement aux rumeurs farfelues qui circulaient dans cette activité, de créer un « ordre » des détectives privés[144].
Dans une mise au point publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2006, le Gouvernement affirmait que la création d'un « ordre professionnel » était inutile la profession de détective étant suffisamment encadrée[145].
Par ailleurs dans un arrêt de mai 2008, la Cour de cassation a rappelé que les organismes de la profession ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ordre professionnel[146], la Cour d'appel de Dijon ayant, pour sa part, précisé que la loi n'avait prévu aucun ordre professionnel pour les agents de recherches privées[147].

En conséquence, les organisations professionnelles (sans aucune exception[N 64]) sont des organismes privés, dénués de tout privilège, prérogative et pouvoir de puissance publique. Ils n'ont aucun contrôle sur les membres de la profession[N 65], la discipline, la déontologie, les pouvoirs de régulation étant dévolus aux seules autorités administratives (cf. infra).
Leurs prérogatives ont même été limitées puisqu'ils ne peuvent plus, dans les affaires contentieuses, tenir leur avis à la disposition des parties[N 66]. Ils peuvent, néanmoins, toujours se constituer partie civile[148] lorsque les intérêts généraux de l'activité sont en cause, et ce conformément aux droits généraux des syndicats inscrits dans le code du travail.
Une association loi de 1901 ne dispose pas — juridiquement — des pouvoirs spécifiques réservés aux syndicats par le code du travail. Néanmoins elle peut être « apparentée »[N 67] à un syndicat lorsqu'elle fédère des associations et syndicats et donc les représenter devant les pouvoirs publics[N 68].
L'absence, en France, d'un organisme institutionnel de type ordinal était, d'ailleurs, facilement compréhensible (et légitime) puisque la formation, l'honorabilité, et les conditions d'exercice étaient placées sous le contrôle du préfet, que les commissaires de police et les officiers de la Gendarmerie nationale assuraient, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des agences, que l'éthique était contrôlée par une autorité administrative indépendante[N 69], la Commission nationale de déontologie de la sécurité[N 70] et qu'enfin les syndicats pouvaient être consultés[N 71] ou se constituer partie civile[N 72] lorsque les intérêts de la profession sont mis en cause.
Dans ces conditions, la création d'un « ordre professionnel » s'avérait, effectivement, inutile.
Cependant, des modifications législatives et constitutionnelles sont venues bouleverser l'équilibre juridique de la règlementation et du contrôle de la déontologie des enquêteurs privés.
La Commission nationale de déontologie de la sécurité créée par une loi du 6 juin 2000 a disparu (en 2011) au profit du défenseur des droits. Elle était spécifiquement chargée de contrôler le respect de la déontologie par l'ensemble des professions de sécurité (publiques et privées).
Elle est remplacée par le défenseur des droits qui a repris ses compétences et attributions. Il veille, désormais, au respect de la déontologie par les professions de sécurité, qu'elles soient publiques ou privées, y compris les détectives et enquêteurs privés.
Son caractère d'Autorité Constitutionnelle[149] permet de garantir — contrairement au C.N.A.P.S[150]. Une totale indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des autorités administratives, mais aussi une instruction objective des contrôles.
Parallèlement, devant l'engorgement des préfectures à traiter les contrôles sur les activités de sécurité privée, le gouvernement décida de remplacer le représentant direct de l’État par un organisme qui serait chargé de ces contrôles et, au surplus, doté de pouvoirs disciplinaires.
Il fut ainsi créé un nouvel organisme placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, qui n'est ni une organisation professionnelle, ni une autorité publique indépendante, mais un service de police administrative, sous la forme d'un établissement public : le Conseil national des activités privées de sécurité.
Ainsi est né le C.N.A.P.S. par la loi du 14 mars 2011[151], qui a créé un titre 2 bis, nouveau, le concernant dans la loi sur les professions de sécurité privée[152].
Cet organisme public de contrôle et de régulation n'est, toutefois, pas un ordre professionnel au sens corporatif et juridique du terme car, d'une part, il couvre plusieurs professions très différentes[153] et que, d'autre part, il est dirigé par un directeur nommé par décret. En outre son collège se compose, en majorité, de représentants de l’État — dans lesquels les représentants du Ministère de l'Intérieur sont sur-représentés — ainsi que d'un seul magistrat, et d'un seul représentant des juridictions administratives.
La profession, pour sa part, y figure théoriquement, mais par une seule personne qui ne dispose donc pas du moindre pouvoir décisionnel compte tenu de la composition du collège : son rôle semble donc limité, dans les faits, à une représentativité honorifique.
L'établissement public administratif n'a pas qualité pour contrôler la déontologie des enquêteurs privés, contrôles qui relèvent, constitutionnellement, du seul défenseur des droits.
Il ne serait pas, en effet, concevable de confier, à un Préfet ou à un service sous tutelle de l’État le contrôle de la déontologie des enquêteurs de droit privé, ce qui aurait entraîner, de la part du représentant de l'État, des services administratifs et des services de police éventuellement mandatés, des incursions dans la vie privée, familiale, intime, professionnelle, financière, médicale de nos concitoyens, ou — pire — permettrait à des agents publics de prendre connaissance de renseignements et informations couverts par les droits de la défense, les avocats étant les principaux prescripteurs des enquêteurs privés.
En revanche, le C.N.A.P.S. a été doté d'un pouvoir disciplinaire et peut donc sanctionner les atteintes aux lois et règlements ainsi que les violations du droit corporatif qui seraient portés à sa connaissance par le défenseur des droits.
Le contrôle des enquêteurs de droit privé s'articule, donc aujourd'hui, autour de cinq autorités publiques :
- le défenseur des droits qui reprend les attributions de l'ancienne C.N.D.S.* le C.N.A.P.S. service de police administrative chargé de délivrer, pour le compte de l'État, les agréments, les autorisations, de procéder à des contrôles y compris dans les locaux, de créer une déontologie et d'en sanctionner les manquements ;
- le Préfet qui conserve la faculté de fermer une agence en cas d'atteinte à l'ordre public (commission d'un délit par un détective privé par exemple) ;
- les commissaires de la Police Nationale et les officiers de la Gendarmerie Nationale qui disposent de pouvoirs spécifique pour surveiller les agences de recherches privées pour le compte de l'autorité administrative ;
- la CNIL qui veille au respect, par les agences de recherches privées, de la loi informatique et libertés et qui est déjà intervenue dans plusieurs offices.
Ainsi les enquêteurs de droit privé, dans l'intérêt du public, sont probablement devenus l'une des professions les plus surveillées de notre pays, ce qui ne peut qu'améliorer la prise en compte, par les Cours et Tribunaux, de leurs rapports et constatations dans les domaines qui ne relèvent pas des services officiels (procédures civiles et commerciales, contre-enquêtes pénales, etc.).
Aux côtés des différentes autorités administratives il existe, comme dans toutes les activités, des associations et des syndicats professionnels dont l'objet est de défendre les intérêts de la profession. Il s'agit d'organismes privés dénués de tout privilège, prérogative ou pouvoir de puissance publique. Enfin il existe également, en dehors des syndicats professionnels, un organisme associatif sans but lucratif exclusivement consacré, depuis 1986, à l'information sur cette activité professionnelle tant en France qu'à l'étranger[154].
Choisir un détective
Le choix d'un professionnel varie en fonction de chaque pays, de sa règlementation et de l'objet des investigations.
Il est donc difficile de dégager des critères universels car les conseils varient en fonction d'éléments divers et des situations locales.
Dans les pays où la profession est règlementée, il convient, avant tout, de s'adresser à l'organisme public chargé du contrôle pour vérifier si l'agence exerce légalement ou si elle est bien autorisée à exercer (cf. infra).
Néanmoins quelques critères communs peuvent se dégager :
- La recommandation d'un juriste est un excellent critère pour s'adresser à un office de recherches : un avocat, un huissier de justice, un notaire, un conseil juridique ne recommanderait pas (en principe) un professionnel qui ne lui a pas donné satisfaction.
- Adressez-vous à un cabinet qui ne se cache pas derrière des enseignes fantaisistes[155] des sigles ou des pseudonymes, mais plutôt à une agence qui exerce « à découvert » sous les Nom et prénom de son dirigeant pour une profession libérale. Lorsqu'il s'agit d'une société, évitez les dénominations farfelues[155] et exigez de connaitre le nom du dirigeant légal.
- Réclamez un contrat écrit, en double exemplaire, qui précisera les identités respectives, l'objet des investigations, et précisera les coûts.
- Fuyez les agences qui accepteraient des missions illégales, qui peuvent s'avérer douteux.
- Ne versez pas d'argent en numéraires sans exiger un reçu. Dans certains pays[156], le montant pouvant être payé en numéraires est d'ailleurs limité.
- Pour votre sécurité personnelle, et le respect de votre vie privée, exigez que tout message, tout courriel, toute information, tout rapport transmis sur le réseau Internet[157] soit chiffré afin qu'il ne puisse être intercepté par des tiers non autorisés qui pourraient, ensuite, dévoiler les informations aux enquêtés et aux surveillés ou exercer un chantage (contre eux ou à votre endroit).
- Dans certains pays[158] il existe des contrats « responsabilité civile professionnelle » qui couvrent les erreurs de l'agence et ses fautes. Faire appel à un Office qui dispose d'une assurance « R.C.P. » vous assurera d'être indemnisé par la compagnie en cas d'erreur, de faute de l'agence ou de ses collaborateurs.
- Ne vous fiez pas à des tarifs fixés par téléphone : un détective privé ne vend pas des tapis ou des baguettes de pain et chaque mission doit être parcimonieusement étudiée pour vérifier sa faisabilité, les difficultés ou les facilités qu'elle soulève. Des tarifs bas et fixés téléphoniquement pour « appâter » le client pourront, ensuite, se révéler imprévisibles avec des suppléments pour diverses raisons.
Le seul moyen d'étudier un dossier, de bien l'appréhender, de conseiller le client[159] comme d'obtenir un devis écrit et précis, consiste à exposer votre problème dans le cadre d'une « consultation technique » qui peut, selon les difficultés, durer une ou deux heures.
La consultation peut être gratuite (ce qui n'est pas une obligation)[160] ou peut, également, constituer une provision à valoir sur le dossier c'est-à-dire que, dans ce cas, la somme payée par le client est, ensuite, déduite du prix de la prestation s'il y est donné suite ce qui revient à la gratuité de la consultation[161].
Dans le cas contraire, il n'est pas déontologiquement (ni juridiquement) illégitime de facturer l'immobilisation d'un professionnel qui se sera donné la peine de recevoir le demandeur, d'étudier le dossier et de lui prodiguer les conseils techniques qui, éventuellement, permettront d'aider le client dans ses recherches personnelles ou de le diriger vers une autre activité concernée par le problème s'il ne relève pas d'un enquêteur privé.
A savoir, il est possible pour le mandant d’être remboursé des frais et honoraires d’un détective privé dans le cadre d’une procédure judiciaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La jurisprudence a admis plusieurs fois, notamment en matière commerciale (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 décembre 2021, 19-22.135), la nécessité de rembourser les frais d’investigations privées, lorsque celle-ci était nécessaire pour assurer la défense du demandeur.
Belgique
Les agences sont contrôlées par un bureau spécifique de la Police fédérale auprès duquel il convient de s'adresser.
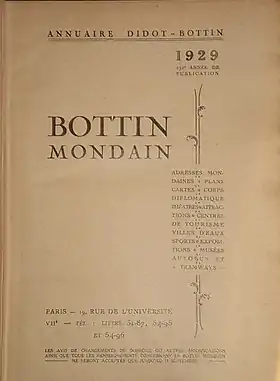
Dans les régions où la profession n'est pas règlementée, le choix sera sans doute plus difficile et, dans ce cas, le recours à un organisme professionnel qui tentera de sélectionner ses adhérents pourra être un critère qui n'offre pas le même intérêt dans les pays où la profession est contrôlée par la puissance publique.
Dans certains pays (ce qui est interdit en France[N 73]), des organismes professionnels peuvent établir des barèmes afin de permettre au client de connaître, approximativement, le coût raisonnable d'une enquête, encore que ce coût — aléatoire — puisse varier en fonction des situations juridiques, techniques et géographiques, des difficultés ou des facilités.
Choisir une agence sur le fondement exclusif d'un bas tarif transmis téléphoniquement n'est peut être pas le meilleur moyen de s'adresser à une agence sérieuse car un bon professionnel doit prendre le temps d'étudier le dossier avant de pouvoir établir un devis précis des investigations à effectuer.
La carte professionnelle (ou un document justificatif) peut être obligatoire dans certains états (en Belgique, au Canada, en France : arrêté préfectoral d'agrément, etc.) et le client doit donc l'exiger.
Des assurances peuvent, également, apporter des garanties aux clients d'une agence comme pour la France, l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui permettra de se retourner contre le professionnel en cas de faute ou d'erreur.
Dans tous les cas il est conseillé de réclamer un reçu des sommes versées et d'en conserver trace en cas de litige, et recommandé que les investigations fassent l'objet d'un ordre de mission écrit (aussi dénommé « contrat » ou « mandat »), daté signé par les deux parties (client et agence) dont chacune devra conserver un exemplaire.
France

Le CNAPS, à travers ses Commissions locales d’agrément et de contrôle dites CLAC, délivre les documents officiels pour exercer l'activité de détective privé[163]. Un dirigeant de cabinet a besoin d'un agrément dirigeant, un assosié d'une société d'enquête d'un agrément associé et un salarié doit solliciter une carte professionnelle. Par ailleurs, chaque établissement doit disposer d'une autorisation d'exercer[164].
Le 16 mai 2017, le CNAPS a publié une liste Nationale des Enquêteurs privés. Toujours en ligne, relevons que cette liste n'a jamais été mise à jour et qu'elle est donc devenue obsolète.
Rappelons, pour mémoire, les recommandations du Ministre français des PME : « Il convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui souhaite recourir à une agence de recherches privées, de vérifier que l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et de sa qualification professionnelle ».
A cette fin, le CNAPS a mis en ligne le téléservice DRACAR qui permet aux usagers de vérifier les titres individuels ainsi que les autorisations des entreprises. Les dates d'échéance des titres délivrés sont indiquées mais les sanctions ou suspensions ne sont pas précisées.
Québec
La loi a créé un « bureau de la sécurité privée » chargé de contrôler les agences d'enquêtes privées. C'est donc auprès de ce service qu'il convient de vérifier si le professionnel dispose d'une licence[165].
Suisse
Les petites agences travaillent avec leurs propres agents, les rendant reconnaissables, les grandes travaillent avec des auxiliaires de sécurité pouvant être formés et mobilisés, qui n'exercent généralement pas cette occupation à plein temps, font principalement de la surveillance de personnes (contrôle d'arrêt maladie pour les assurances par exemple), et sont attribués à un quartier, une mission précise ou une plage horaire et ensuite affectés à d'autres personnes. Ils peuvent être mobilisés dans la minute via leur téléphone mobile. La police peut y avoir recours comme témoins sur une intervention ou un évènement particulier. Ils n'ont besoin d'aucun diplôme particulier. Ces agents rendent la filature obsolète car en quadrillant un quartier ils peuvent anticiper chaque mouvement de la cible.
Coopération internationale
.gif)
Les détectives et enquêteurs privés de tous les pays ont tissé, entre eux, des réseaux qui permettent, aux uns et aux autres, de saisir un confrère dès l'instant où la mission dépasse le cadre du pays d'origine.
Il existe, à l'instar d'Interpol[166] au niveau international ou d'Europol[167] au niveau européen, des organisations internationales qui se sont constituées pour faciliter les relations entre les professionnels.
Les éléments sont transmis par message chiffré au professionnel étranger et, par exemple, une filature commencée à Paris, peut ainsi être reprise à Bruxelles par un confrère Belge à la descente du train ou de l'avion, ce qui permet à la fois de respecter les lois de l'État concerné et de faciliter la mission sur un territoire inconnu de l'enquêteur français dans cet exemple.
L'enquêteur français peut, ainsi poursuivre sa mission en toute sécurité dans le pays étranger ou rentrer en France si sa présence n'est pas indispensable.
En règle générale ces organismes se composent d'associations et de syndicats, mais il peut également exister des organisations qui regroupent des membres individuels par pays.
Les professionnels échangent également entre eux les adresses de confrères étrangers qu'ils connaissent et qu'ils peuvent recommander, notamment par le biais de leurs organisations professionnelles nationales.
Détectives et Union européenne
Il n'y a pas de règlementation européenne pour les détectives privés, chaque pays membre de l'Union Européenne étant libre de légiférer en la matière, sous réserve, bien évidemment, de respecter les traités Européens.
Il existe, toutefois, une directive traitant des agences de renseignements et qui concerne la liberté d'établissement dans tous les pays membres de l'Union Européenne[168].
C'est ainsi que l'Espagne qui imposait, dans sa règlementation relatives aux professions de sécurité, des conditions particulières a fait l'objet de plusieurs recours de la Commission devant la Cour de Justice des Communautés européennes[169] et a été contrainte à modifier sa législation.
Statistiques
- Autriche
- 280 enquêteurs professionnels environ sur l'Autriche (en 2004)[170]
- dont environ 70 agences à Vienne
- Belgique
- environ 900 détectives autorisés dans l'ensemble du territoire belge (avril 2010)[171]
- Cameroun
- plus d'une centaine d'agences (en 2005) probablement entre 100 et 500 à exercer surtout dans les métropoles de Yaoundé et Douala.
- France
- 2 905 agences[N 74] en janvier 1998[172]
- 3 271 agences en septembre 2004[172]
- 1 200 agences en décembre 2019[173]
- Genève (Suisse)[174]
- 232 agences (fin 2013)
- Québec
- Statistiques en février 2008[175] :
- 97 agences d'investigations (seules) - 56 agences d'investigations ET de sécurité - 71 agences de sécurité (seule)
- Statistiques au 8 juillet 2010[176] :
- 139 agences d'investigations (140 en mai 2010 dont une a été révoquée le 8/6/2010)
- statistiques début 2012[177] :
- 175 à 190 agences de recherches privées employant 1 700 enquêteurs
- Pakistan
- 1 seule agence officiellement déclarée et autorisée à Lahore [178] mais il y aurait de nombreuses personnes s'affirmant « enquêteurs privés » en l'absence de législation réglementant la profession.
- Roumanie
- 340 agences (en 2010)
- 1 340 professionnels[179]
Stéréotype du détective privé
Toujours dans le contexte des fictions anglo-saxonnes, le recours à l'enquête d'un détective privé a placé cette figure de scénario dans le registre de l'archétype de la sécurité privée des personnes.
Dans la fiction
- Littérature
- Sherlock Holmes
- Hercule Poirot
- Eddie Valiant (Who Censored Roger Rabbit?)
- Mike Hammer
- Nestor Burma
- Cinéma
- J. J. Jack Gittes (Chinatown ; The Two Jakes)
- Eddie Valiant (Who Framed Roger Rabbit)
- Mike Hammer
- Nestor Burma
- Télévision
- Thomas Magnum (Magnum, P.I.)
- Adrian Monk (Monk)
- Josef Matula (Un cas pour deux)
- Mike Hammer
- Nestor Burma
- Comics
- Jeux vidéo
- Nick Valentine (Fallout 4)
- Booker DeWitt (BioShock Infinite)
- Sam et Max (Sam and Max)
Notes et références
Notes
- En 1871, une étude belge sur la réforme de l'instruction criminelle parle déjà des détectives privés londoniens dans les termes suivants : « … ; mais il y a aussi des citoyens qui exercent cette profession par goût ou par vocation et qui, simples particuliers, louent leurs services à qui veut les employer. Ce ne sont ni les moins habiles, ni les moins recherchés ». (cf. reforme de l'instruction préparatoire en Belgique par Messieurs Adolphe Prins et Hermann Pergameni, avoués près la cour d'appel de Bruxelles. Éditeur : Durand et Pedone Lauriel à Paris et Claaseen à Bruxelles. Document conservé à la Bibliothèque nationale de France)
- En fédération de Russie les agences de « police privée » sont régies par la loi no 2487-I du 11 mars 1992 sur le gardiennage et la police privée (protection, investigations). Les entreprises ont, notamment, pour objet de rechercher des renseignements pour les affaires civiles sur la base contractuelle avec les plaideurs, faire des études commerciales, rechercher des informations pour les négociations d'affaires, révéler des partenaires d’affaires insolvables ou incertains, établir la contrefaçon de marques, la concurrence déloyale, la violation de secrets commerciaux, rechercher des personnes disparues… Une licence est délivrée par le Ministère des Affaires intérieures de Moscou. L’enquête privée doit être la principale activité du professionnel. Il ne peut cumuler sa profession avec une activité publique ou avec une fonction élective payée par des organismes publics. Il bénéficie de droits importants par rapport aux autres législations européennes.
- Cette autorisation est délivrée par le département de l'Économie Publique en application d'une loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie, dite « loi sur l'industrie ».
- La consultation moyenne était fixée, en 2005, à environ 10 000 Francs CFA et l'ouverture d'un dossier aux environs de 50 000 Francs CFA.
- Le jeudi 31 mars 2009 au congrès du syndicat national des détectives privés du Cameroun, un vague projet gouvernemental pourrait être envisagé pour encadrer cette activité, mais le texte n'est pas encore confirmé et se limiterait, en l'état, à un avant projet de loi devant encore être soumis au président de la République.
- En 2005 on estimait le nombre de détectives au Cameroun à plus d'une centaine.
- Ils se sont regroupés, en avril 2005, dans le « Syndicat des détectives privés du Cameroun ».
- Le 23 mars 2005, la Cour suprême de Yaoundé rejetait la demande de réglementation déposée par les détectives privés plaignants.
- La formation est gérée par la formation professionnelle locale, dénommée : Institut de perfectionnement professionnel.
- Avant la création de cette nouvelle formation universitaire les enquêteurs privés Texans devaient justifier de 3 années d'expérience pour se présenter au diplôme d'État. Ils pourront désormais s'y présenter directement à l'issue de leurs études universitaires grâce à une modification règlementaire prise par le département de la Sécurité de l'État du Texas.
- En mai 2010.
- Kocaeli est une province du nord de la Turquie, située au bord de la mer Noire. Son chef-lieu se nomme également Kocaeli, mais est également connu sous le nom d’İzmit.
- Toutefois le résultat de cette réforme est que les plaideurs disposent, maintenant, d'une fonction libérale et règlementée pour rechercher, établir et fixer les preuves dont ils ont besoin dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels. Cette réforme se met progressivement en place, le dernier décret (attendu depuis 5 ans) n'ayant été promulgué que le 24 février 2009. Néanmoins le nombre d'agences a déjà considérablement diminué avec les contrôles opérés par les services administratifs (Préfet, Police, Gendarmerie). Ne devraient désormais subsister que des agences sérieuses et crédibles.
- En Italie l'aide judiciaire peut être attribuée pour faire appel aux services d'un détective privé. En France, c'est une demande des organismes professionnels, afin que tous puissent avoir accès à l'assistance d'un enquêteur privé pour se défendre. Cette faculté a, également, été évoquée en 1997 dans le rapport du Conseil national des Barreaux français.
- L'accès à la Licence professionnelle intervient soit avec les diplômes correspondant à BAC +2 soit avec une mise à niveau résultant d'un diplôme d'Université « enquêteur privé ». Au surplus l'enseignement pour le diplôme d'État est gratuit en formation initiale à l'Université Paris 2.
- L'article 1er de la loi no 42-891 du 28 septembre 1942 imposait pour diriger, administrer ou gérer une agence privée de recherches, la nationalité française, de n'avoir pas encouru de condamnation et de ne pas être juif. Cette discrimination a, toutefois, été abrogée dès la libération du territoire français par l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité Républicaine.
- A titre d'exemple cette appellation est souhaitée par l'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé et l'ensemble des organismes qui lui sont affiliés, mais elle l'est aussi par la CNDEP qui, au nom de l'ensemble des organismes qu'elle représentait, a remis un rapport — en 1999 — à la Délégation Interministérielle aux Professions Libérales pour réclamer la « protection des titres d’AGENT DE RECHERCHES et d’ENQUÊTEUR DE DROIT PRIVÉ ».
- Le droit local permettait au Préfet d'interdire l'exercice de la profession, d'abord à toute personne qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale d'une certaine gravité. En outre l'administration était en droit d'interdire la profession si le postulant ne présentait pas la compétence ou la qualification requise. L'interdiction était prononcée selon une procédure de nature à protéger les droits de la défense, dans la mesure où la décision du Préfet était susceptible d'un recours devant le Tribunal administratif. Cet article avait été maintenu en vigueur par la loi du , puis par la loi du 23 décembre 1980 relatif aux agents privés de recherches. Il a été abrogé par l'article 107 de la loi no 2003-239 du .
- Divers autres textes règlementaires sont également intervenus créant un contrôle de l'autorité administrative et donnant, aux préfets, le pouvoir de fermer des agences en cas d'infraction (décrets no 77-128 du , no 81-1086 du , no 87-593 du ) ou classant les enquêteurs privés dans le groupe des professions libérales (décret n° 77-1419 du 15/12/77)
- La législation de Nouvelle-Calédonie était, au demeurant, désuète et constituait un mélange des anciens textes législatifs et règlementaires français, totalement dépassés.
- Cet ultime décret no 2009-214 du (J.O du 25/2) permet à la législation française de s'appliquer intégralement.
- Comme la chambre commerciale de la Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé dans un arrêt du .
- Hors les cas où la loi l'oblige ou l'autorise à témoigner.
- Avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité du (saisine 2008-135 : § sécurité privée) : « À l'instar de l'obligation de coopération loyale, le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l'enquêteur de droit privé et son mandant. Dégagée par la jurisprudence (C.A. Paris [NDLR - faute de frappe lire ], et , consacrée de manière ponctuelle par certains textes règlementant la profession (décret no 2003-1126 du [NDLR - fautes de frappe : lire décret no 2005-1123] sur la formation des enquêteurs), reconnu par l'ensemble des organisations professionnelles représentatives des agences de recherches privées, l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé. Sans cette obligation, les mandants ne pourraient se confier ni être défendus. Dans le cadre d'une procédure en révision comme en l'espèce, l'avocat, qui ne peut instrumenter lui-même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant l'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l'enquêteur est nécessairement dépositaire d'informations confidentielles dans le cadre d'un secret partagé avec l'avocat. Toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles est alors constitutive d'un manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d'un délit pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pén. ; (…) ».
- Article 226-13 (Ordonnance no 2000-916 du art. 3 Journal officiel du en vigueur le ) « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
- Art.34 : Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
- « Nul ne peut divulguer à quiconque un renseignement obtenu dans le cadre de ses fonctions d'enquêteur privé, sauf lorsque la divulgation est légalement autorisée ou requise »
- Il s'agit bien ici d'un secret professionnel et non d'une simple obligation de réserve. En effet le texte interdit aux détectives privés de divulguer des informations, mais aussi sanctionne, pénalement, les manquements par les peines visées à l'article 458 du code pénal belge, relatif aux violations du secret professionnel. En outre l'article 19 de la loi punit plus sévèrement lorsque la divulgation concerne la vie des personnes.
- Article 16§2 loi du 19 juillet 1991 modifiée : « Dans le cadre de la protection de la sûreté nationale, du maintien de l'ordre public, de la prévention ou de la recherche de faits punissables, le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre de la Justice ou les autorités judiciaires, dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent requérir du détective privé les renseignements concernant une mission en cours ou exécutée nécessaires à la sûreté nationale, au maintien de l'ordre public et à la prévention ou à la recherche de faits punissables. Celui-ci est tenu d'y répondre sans délai. Le détective privé n'est tenu de répondre à la demande d'information relative à une mission en cours ou exécutée, que dans la mesure où les personnes chargées de recueillir ces renseignements sont en possession d'un mandat spécifique délivré à cet effet par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice ou l'autorité judiciaire, chacun dans le cadre de ses compétences ».
- Article 19 : « (…) Les auteurs des infractions visées à l'article 10 sont punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal ; lorsque les informations divulguées sont relatives à la vie des personnes, elles sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 20 000 francs ou d'une de ces peines seulement ».
- Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros].
- Dans le cadre du principe de la confidentialité des informations auxquels les enquêteurs sont soumis, mais également dans le cadre de la législation sur la protection des renseignements personnels.
- Une loi, de l'année 2000, sur les enquêtes pénales instaure le droit du détective au secret professionnel.
- Il est interdit au détective privé de recueillir sur les personnes qui font l'objet de ses activités professionnelles, des informations relatives à leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales et à l'expression de ces convictions [ou relatives à leur appartenance mutualiste]. Il est interdit au détective privé de recueillir des informations relatives au penchant sexuel des personnes qui font l'objet de ses activités, sauf s'il s'agit d'un comportement contraire à la loi ou qui peut constituer un motif de divorce s'il agit à la requête d'un des conjoints. Il est interdit au détective privé de recueillir des informations relatives à la santé [ou aux origines sociales ou ethniques] des personnes qui font l'objet de ses activités.
- « La loi (…) et le décret (…) ont pour finalité, entre autres, de moraliser l'exercice de la profession d'agent privé de recherches. Rien ne s'oppose à ce que ces mesures d'ordre législatif et réglementaire soient suivies, à l'initiative de la profession, de la mise au point d'un code auquel souscriraient les intéressés. Mais les agents concernés ne sont ni constitués en un « ordre » professionnel, ni bénéficiaires d'un statut. L'expression « code de déontologie » doit en conséquence être entendue dans le sens qui peut être le sien en l'occurrence : un document officieux, émanant d'une organisation représentative de la profession et édictant à l'usage de ceux de ses membres qui accepteront de s'y soumettre un certain nombre de règles et d'obligations ».
- Mais également de représentants des grands corps judiciaires de l'État, d'un commissaire du gouvernement etc.
- C'est le 2 décembre 2008 que, pour la première fois depuis sa création, cette autorité administrative indépendante a été saisie d'une plainte contre un détective privé, transmise par M. Patrick Labune, député de la Drôme. Elle s'est alors déclarée compétente pour contrôler le respect de la déontologie des enquêteurs de droit privé (source : saisine n° 2008-135).
- La fin de la CNDS a été programmée par un projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale le 3 juin 2008 et dont l'article 31 a créé un poste de « défenseur des citoyens » (ou « défenseur des Droits » selon le rapport de la Commission des lois du Sénat qui préfère cette appellation) destiné à remplacer plusieurs Autorités administratives indépendantes dont la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
- Dans le cadre de la saisine 2008-135 évoqué plus haut, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a pris la décision suivante à l'encontre du détective contrôlé (source : avis CNDS 2008-135 du 21/9/2009) : « compte tenu de la gravité et du nombre de manquements constatés, la commission transmet son avis :
- conformément à l'article 7 de la loi du 6 juin 2000, au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités locales pour réponse ;
- au procureur de la République territorialement compétent aux fins d'apprécier l'opportunité de poursuites pénales contre (…) ;
- au préfet de (…) et aux préfet de police de Paris pour information »
- Contrairement aux sociétés de gardiennage qui, pourtant régies par la même loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, sont titulaires d'une carte professionnelle officielle, mais virtuelle, plus une carte professionnelle matérielle délivrée par leur employeur - cf. Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur, circulaire n°INTA0900045C du 24/2/2009 relative à l'entrée en vigueur de la carte professionnelle des salariés participant aux activités privées de sécurité)
- « La carte professionnelle instituée à l'article 6 (…) ne concerne pas (…) les agents de recherches privés dont les activités sont règlementées au Titre II de la loi du 12 juillet 1983 » (Source : circulaire Ministre de l'Intérieur du 24 février 2009).
- L'article 444-3 du code pénal français punit de 5 ans de prison et de 75 000 € la contrefaçon et la falsification des imprimés officiels et l'article 444-5 d'un an de prison et 15 000 € d'amende leur imitation.
- Les formations doivent être soit inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles, soit agréées par le Ministère de l'Intérieur dans le cadre des C.Q.P. (Certificats de qualification professionnelle).
- Qui n'impose aucunement une inscription au RNCP mais ces écoles doivent alors disposer d'un numéro d'enregistrement préfectoral.
- « Le diplôme est un monopole du service public d'éducation et le restera […] Le diplôme reste le moyen de reconnaître les qualifications, y compris professionnelles » : précision juridique rappelée par le ministre de l'Éducation nationale dans un article du Monde du 14 décembre 1998.
- Le premier diplôme d'université pour cette activité professionnelle a été créée en 1998, sous l'impulsion du professeur Marc Gjidara, directeur du centre de l'Université PARIS 2 à Melun et d'une fédération représentant la profession. Il sera suivi, en 2000 d'un second diplôme d'université puis en 2006 d'un diplôme d'État.
- Le ministre de l'intérieur a précisé au Conseil d'État que l'enquête de moralité « concerne les personnes devant suivre un stage pratique en entreprise, aux fins de protéger tant les agences de recherches privées elles-mêmes que les citoyens (…) L'enquête n'est pas liée à l'accès à un cycle d'étude ou à une formation mais uniquement à la perspective d'un stage devant être accompli dans une agence de recherches privées, au cours de laquelle le stagiaire, si sa moralité est douteuse, présentera un risque d'atteinte aux libertés individuelles protégées par le Code pénal et le Code civil, dans le cadre des missions qui lui seraient confiées. Ainsi il ne s'agit pas d'enquêter sur les étudiants suivant un enseignement donné, mais uniquement de prendre des garanties dans les deux mois précédant une inscription en stage ». Source : Conseil d'État : Fédération UFEDP c/Premier ministre, 4 juillet 2006 réf. : DLPAJ/CJC/LP/ER/5523.
- Stage (non rémunéré) qui n'a pas pour objet de suivre une formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles.
- Le rapport d'un détective privé, d'où devrait apparaître la prostitution de l'épouse du travailleur, ne peut être admis à titre de témoignage, dans la mesure où un détective privé est spécialement engagé et payé par une des parties directement intéressée au litige. Le classement sans suite de la plainte du chef d'atteinte à l'honneur, formée contre l'employeur ne peut faire présumer l'exactitude des faits. En outre, le terme de « prostitution » employé dans la lettre de rupture, sans autre donnée concrète ni précision, ne définit pas de façon suffisamment claire et précise le fait reproché au travailleur. Le motif grave ne peut être admis. Les accusations portées par l'employeur ont causé de sérieuses tensions psychologiques tant au travailleur qu'à sa famille; en outre, ces accusations sont susceptibles de compromettre le déroulement futur de la carrière du travailleur. En conséquence, ce dernier est en droit de réclamer, outre l'indemnité forfaitaire de préavis, une indemnité pour dommage moral qu'il y a lieu d'évaluer ex æquo et bono à 40 000 F. (Tribunal du Travail de Bruxelles, 13/09/1985).
- Article L121-8 ancien code du travail, Article L1222-4 du Nouveau Code du travail qui stipule : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. »
- Ce service « grand public » n'étant pas destiné à des juristes l'auteur de l'article n'entre pas dans le détail de la jurisprudence et des dispositions juridiques appropriées concernant l'apport de preuves en droit du travail.
- Article 1382 du code civil français promulgué le 17 février 1804 (loi du 7/02/1804) modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4 : Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
- Code civil - Article 1382 (lire en ligne)
- D'une part l'assurance vie n'entre pas dans le cadre des successions, d'autre part il s'agit bien ici de rechercher non pas un héritier mais une personne physique ou morale bénéficiaire du contrat : association humanitaire ou non, société caritative, institution de protection animalière, ami(e) etc. Il s'agit aussi de retrouver des assurés qui ne donnent pas de nouvelles et dont l'assureur a perdu la trace. Ces activités ne relèvent donc pas de la généalogie successorale, mais bien de recherches privés et imposent une autorisation préfectorale des entreprises qui s'y livrent, et un agrément et un contrôle de l'État sur les dirigeants de ces sociétés et les enquêteurs employés, notamment d'anciens fonctionnaires de police ou de gendarmerie.
- Source : ministère de l'Intérieur Belge, direction générale de la sécurité et de la prévention, direction de la sécurité privée : La recherche privée couvre de nombreux domaines, comme la recherche de personnes disparues ou de biens volés. Elle consiste également en la collecte de toutes sortes d’informations sur des personnes : comportement, fortune, moralité ou encore état civil. De même, la collecte de preuves ou le constat de faits dans le but de trancher un litige font également partie du travail de recherche. Toute personne accomplissant ces activités est légalement considérée comme étant un détective privé, même si elle n’utilise pas ce nom dans l’exercice de sa fonction. Experts, inspecteurs d’assurances, enquêteurs travaillant pour des agences de recouvrement… ce sont tous des détectives privés. La recherche privée consiste en des activités déterminées, exercées par des personnes privées et définies par la loi. Il s’agit des activités suivantes : 1° Rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés. Exemples de tâches de détective visées par cette activité : — la recherche par systèmes dits « car-tracers » de véhicules volés ; — la recherche d’enfants disparus ou enlevés ; — la recherche d’héritiers dans le cadre de l’ouverture d’une succession. 2° Recueillir des informations relatives à l’état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes ; exemples de tâches de détective susceptibles d’être classées dans cette catégorie : — le recueil d’informations concernant un futur conjoint ; — le contrôle des prestations du postulant à un emploi auprès de ses précédents employeurs ; — le contrôle de la solvabilité d’un emprunteur potentiel ; — la surveillance des activités nocturnes d’un employé titulaire d’une fonction requérant la confidentialité. Par « personnes », on vise à la fois les personnes physiques et les personnes morales. Cela signifie que la collecte d’informations concernant la solvabilité d’entreprises fait partie des activités d’un détective. Ainsi, les personnes actives dans des entreprises de renseignement commercial sont soumises à la loi sur les détectives. Ce n’est toutefois que lorsque les informations sont recueillies auprès d’autres personnes que le client ou la personne qui fait l’objet de l’enquête que l’on pourra parler d’une activité de détective au sens de la loi. 3° Réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits ; quelques exemples : — le contrôle des prestations professionnelles d’un employé ; — le constat d’adultère, afin de régler un conflit entre conjoints dans le cadre d’une procédure de divorce ; — la recherche des circonstances réelles du déclenchement d’un incendie, pour résoudre un conflit entre un assureur et un assuré ; — la détermination des prestations d’un vendeur. Ici aussi, on vise par « personnes » à la fois les personnes physiques et les personnes morales. Par le terme « conflit », on vise toute « divergence d’opinion » entre personnes (morales), indépendamment du fait que le litige puisse ou non avoir des suites judiciaires. 4° Rechercher des activités d’espionnage industriel. On pourrait décrire l’espionnage industriel comme l’accumulation secrète de données dans une entreprise dans l’intention d’acquérir une connaissance aussi complète que possible des possibilités et des intentions du concurrent, et d’utiliser ces informations pour élaborer sa propre stratégie commerciale. 5° Exercer toute autre activité définie par Arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Bien que son intention première ne fût pas de réglementer d’autres activités que celles visées aux points 1° à 4°, le législateur a préféré laisser une porte ouverte pour l’avenir. Cela n’est pas superflu, vu l’évolution rapide de la demande sur ce marché de services. La loi permet ainsi au gouvernement de parer rapidement à de nouvelles évolutions en réglementant également d’autres activités. Par exemple, par le biais d’un Arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Toutefois, cette compétence n’a pas encore été utilisée.
- Une caméra numérique offre la faculté de tirer une image très nette dans un ensemble de prises de vues.
- Dans certains cas, ou certaines zones « sensibles » la prise de photographies sur la voie publique peut s'avérer difficile. Il peut être utilisé des appareils miniaturisés et totalement invisibles contenus dans les stylos, des montres ou même des lunettes.
- Le 27 MHz qui n’est plus utilisé par la profession en France imposait, par exemple, des antennes comportant des « bobines » facilement repérables, ou pour de longues portées des antenne de 2,75 m de haut, mais il existait, aussi, dans les années 1970, des antennes 144 MHz « camouflées dans de fausses antennes télescopiques de type « autoradio » qui s'installaient sur l'aile d'une voiture et étaient, à l'époque, indécelables.
- Une information « blanche » est une information publique ouverte à tous.
- Une information « grise » est un renseignement public mais qui peut nécessiter des conditions pour les obtenir ou d'être identifié, par exemple par un abonnement.
- Le Conseil national des Barreaux est un organisme institutionnel, regroupant tous les Barreaux de France, qui est chargé, par la loi, de représenter les avocats français sur le plan national et international. Il est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Il contribue à l'élaboration des textes concernant la profession d'avocat et son exercice, mais il intervient également sur les questions relatives aux textes dans les domaines juridiques et de l'institution judiciaire.
- En Italie, les justiciables peuvent bénéficier de l'aide judiciaire pour s'attacher les services d'un détective privé.
- Réponse ministérielle du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 8 décembre 2009 : « Le comité de réflexion sur la justice pénale présidé par M. Philippe Léger, ancien avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes, a remis son rapport au président de la République le 2 septembre 2009. « Ce comité, qui avait pour mission de réfléchir à une rénovation et à une remise en cohérence du code de procédure pénale, formule douze propositions afin de réformer cette procédure. Il est ainsi proposé de rénover en profondeur la phase préparatoire au procès pénal en transformant le juge de l'instruction en un juge de l'enquête et des libertés, en créant un cadre d'enquête unique dirigée par le procureur de la République et en renforçant les droits des mis en cause et des victimes. « Le comité envisage également un nouveau déroulement de l'audience pénale avec un président davantage arbitre du débat judiciaire et des interrogatoires menés par le ministère public et les parties. Enfin, une modernisation de la procédure criminelle est souhaitée à travers un renforcement des garanties entourant le procès d'assises et un allègement de la procédure en cas de reconnaissance de sa culpabilité par l'accusé. « Sur les bases de ce rapport, une large consultation va être menée par le ministère de la justice afin de poursuivre cette réflexion et de permettre la finalisation d'un avant-projet de loi début 2010 et la présentation au Parlement d'un projet de loi à l'été 2010. « Quelles que soient les orientations retenues, cette réforme de la procédure pénale devra renforcer la protection des libertés individuelles et les droits des victimes, tout en accroissant la simplicité et l'efficacité de la justice pénale. « À cet égard, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, veillera à ce que les contreparties procédurales ou statutaires susceptibles d'être justifiées par la suppression du juge d'instruction soient examinées avec une attention toute particulière. « Toutefois, il n'est nullement envisagé de privatiser l'enquête pénale qui doit être menée par les pouvoirs publics, et principalement par les services de police et de gendarmerie. « Sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il appartiendra à ces services de conduire, à charge et à décharge, les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. « Il n'est dès lors pas prévu de modifier dans le cadre de cette réforme les dispositions relatives aux enquêteurs privés.
- C'est-à-dire qu'elles s'intitulent « syndicat », « chambre », « conseil », « ordre », « office », « comité », « commission », « association », « fédération », « confédération », « observatoire » ou toute autre appellation.
- en dehors de leurs seuls adhérents.
- En vertu de l'article L 411-19 de l'ancien code du travail, les syndicats pouvaient, dans les affaires contentieuses, tenir leur avis à la disposition des parties sur tout ce qui touchait à leur spécialité mais cette disposition a été abrogée par le nouveau code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008.
- Cf. Cour d'appel de Dijon, arrêt du 23 juin 2007 : Et attendu qu’ayant relevé que (X association loi 1901) et (Y association loi 1901) s’apparentaient à des syndicats professionnels, la cour d’appel a retenu, à juste titre, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la qualification d’ordre professionnel et n’avaient donc pas à être appelés.
- Par exemple l'U.N.A.P.L. Union Nationale des Associations de Professions Libérales, association loi de 1901 qui représente les professions libérales et regroupe à la fois des associations et des syndicats.
- Créée par la Loi 2000-494 du 6 juin 2000 la Commission nationale de déontologie de la sécurité est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller aux respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
- La Commission nationale a rendu, le 21 septembre 2009, un avis aux termes duquel : le secret professionnel constitue le socle de la déontologie des enquêteurs de droit privé, mais aussi qu'ils sont tenus à une obligation de loyauté à l'égard des mandants et, qu'enfin, l'exercice de la profession sans agrément de l'État constitue un manquement déontologique sans préjudice de l'infraction pénale (usurpation de titre) : source Assemblée plénière CNDS du 21/9/09, saisine n° 2008-135.
- Si l'article L411-19 du code du travail a été abrogé depuis 2008, il n'est aucunement interdit à une organisation professionnelle de communiquer à une partie les informations nécessaires pour l'éclairer en cas de litige par exemple avec un faux détective qui exercerait illégalement cette profession règlementée.
- Art. L.2132-3 du nouveau code du travail français entré en vigueur le : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
- Le Conseil de la Concurrence a, ainsi, estimé que constituait une « action concertée » nuisible à la concurrence le fait d'établir de tels barèmes : Considérant que, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de quelque manière que ce soit ; qu'en particulier les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leur propres coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix ; que l'élaboration et la diffusion par une organisation professionnelle d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constitue une action concertée (Source : République Française, Conseil de la Concurrence, décision n° 92D39 du 16 juin 1992).
- Le terme « agence » regroupe les directeurs de cabinets d'enquêtes privées mais également les collaborateurs indépendants qui, exerçant une activité libérale, sont assimilés, juridiquement, à des directeurs d'agences.
Références
- La Belgique, en revanche, utilise le terme de détectiove privé : loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (source : Gazette des Enquêteurs
- par contre l'usurpation de qualité (et non pas de titre) a été retenue par une juridiction correctionnelle du Nord de la France contre un agent municipal qui exerçait la profession sans y être autorisé sur le fondement de l'article 433-17 du code pénal (Tribunal correctionnel de Cambrai, 6 avril 2009. Source : Gazette des Enquêteurs)
- Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, Annexe I, chapitre I-3 : « les agences privées de recherche (…) exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale ».
- Assemblée plénière, Commission nationale de déontologie de la sécurité, avis no 2008-135 du 21 septembre 2009.
- Cf. infra à règlementation française : Titre II de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 créé par l'article 102 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003
- loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (modifiée par la loi du 30/12/1996 et la loi du 7 mai 2004).
- Loi sur la sécurité privée no 23/1992 du 30 juillet 1992 (« Ley de Seguridad privada »), et décret royal no 2364/94 du no 2364/94 portant approbation du règlement sur la sécurité privée (« Reglamento de Seguridad Privada », ci-après le « règlement sur la sécurité privée »).
- consultez la législation intégrale du Québec
- Au Québec une nouvelle loi adoptée le 14 juin 2006 va entrer en vigueur : la loi sur la sécurité privée : L.Q,2006, c23 du 14/6/2006.
- consultez la législation intégrale de Genève
- La profession est règlementée par la loi du 20 mai 1950 sur les "agents intermédiaires et de son règlement d'application du 31 octobre 1950.
- voir la carte professionnelle du canton Genève
- Article 2, §1er, alinéa 1, loi du 19 juillet 1991
- Article 2, §1er, alinéa 2, loi du 19 juillet 1991
- Loi du 12 novembre 2002 et règlement Grand Ducal du 22 août 2003 relatifs aux activités privées de gardiennage et de surveillance
- loi du 28 décembre 1988 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
- Par courrier (ref. Z-87/07) du 23 octobre 2007 adressé à l'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé, le Ministre de la Justice du Grand Duché confirme que « la profession de détective n'est pas règlementée par la législation luxembourgeoise. En vue de l'exercice de la profession de détective il suffit d'avoir une autorisation de commerce en vertu de la loi du 28 décembre 1988, dite loi d'établissement, qui régit, fondamentalement, l'accès aux activités soumises à agrément du Ministre des Classes moyennes et leur exercice ».
- Article 1er de la loi no 96/020 du 21 février 1996 sur le gardiennage.
- Loi no 010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d'intervention de l'État et répartition des compétences entre l'État et les autres acteurs du développement.
- Lancement de la formation à l'Université de Dallas : 19 mars 2010.
- Lancement de la formation à l'Université de Saint Thomas : 26 mars 2010.
- Site Internet de NALI
- Öğret 2010
- Décret no 2009-214 du 23 février 2009, publié au journal officiel du 25 février 2009
- Directive no 67/43/CEE du 12/01/1967
- Loi no 95-73 du 21/01/1995, loi no 2000-494 du 06/06/2000, loi no 2003-239 du 18/03/2003, loi no 2006-64 du 23/01/2006, loi no 2007-297 du 05/03/2007
- Décret no 77-1419 du 15/12/1977 (social), décret no 81-1086 du 8/12/1981 (Intérieur) qui sera prochainement remplacé par un décret sur les agréments et autorisations préfectorales), décret no 2005-1123 du 06/09/2005 (Intérieur), décret no 2005-1124 du 06/09/2005 (Intérieur), décret no 2006-1120 du 07/09/2006 (Intérieur), décret no 2007-1181 du 03/08/2007 (Intérieur), décret no 2009-214 du 24/02/2009
- Arrêté du 19 juillet 2007 du 19/07/2007 (Défense), arrêté du 21 juin 2006 (diplôme d'État)
- La dernière, du Ministre de l'Intérieur, en date du 31 mars 2010 circulaire du 31 mars 2010
- Cf. historique des détectives privés (avec lettres de Vidocq)
- Sous le titre Approches du XIXe siècle sont recueillies trente-cinq études de Loïc Chotard consacrées à des auteurs et à des œuvres de l'époque romantique, dont « Alfred de Vigny » (Approches du 19e siècle, Presses de l'Université de Paris Sorbonne). « L'existence de Vigny entre 1937 et 1838 est marquée par une série de chocs (…) il a rompu son ancienne liaison avec l'actrice Marie Dorval dont il faisait espionner les infidélités par Vidocq »
- Arrêté du Ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'Enseignement supérieur du 21 juin 2006 : cf. nombreux articles dont Agence France-Presse : dépêche du 18.12.2006, édition internationale anglophone
- À l'exception de l'Alsace Moselle où la profession était régie, depuis 1900, par une loi locale issue du droit allemand : cf. infra (règlementation française).
- Histoire des détectives privés en France (1832-1942) par Dominique Kalifa - éditions Nouveau Monde
- Dictionnaire de l'Académie Française, 9e édition : « DÉTECTIVE n. m. XIXe siècle. Emprunté de l'anglais detective. 1. Dans les pays anglo-saxons, fonctionnaire de police chargé de conduire les enquętes. Les détectives de Scotland Yard. 2. Par ext. Détective privé ou, ellipt., détective, personne qui, à titre privé et contre rémunération, effectue des recherches, des filatures. Une agence de détectives ».
- cf. infra (liste de groupements américains dans la rubrique « se renseigner »)
- art. 21 loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée : « la dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé » (…)
- Titre II de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 créé par l'article 102 de la loi no 2003-239 du 18/3/2003
- Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Son annexe I, dispose (chapitre I-3) que : (…) les agences privées de recherches (…) exercent des activités de sécurité privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. (…)
- art. 14-I (2°) loi no 83-629 du 12/07/1983 modifiée)
- article 5 (7°) loi no 83-629 du 12/7/83 modifiée
- décret no 77-1419 du 15.12.1977 portant classement des « Agents privés de recherches et de renseignements » dans le groupe des professions libérales
- l'UFEDP — Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé — qui a même mis cette appellation dans sa dénomination, ainsi que les associations et syndicats qui lui sont affiliés, mais aussi la CNDEP (Confédération nationale des détectives et enquêteurs professionnels) et les associations et syndicats qui lui sont affiliés qui écrit, dans un rapport remis à la délégation interministérielle aux professions libérales : « Il serait tout aussi souhaitable que cette même délégation puisse également appuyer les nécessaires dispositions relatives à : (…) — Protection des titres (…) enquêteur de droit privé (…) C’est la raison pour laquelle nous nous permettons, Monsieur le Délégué Interministériel (…) de solliciter votre appui ».
- Article 35, loi du 26 juillet 1900 dite "code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle : « L'exercice de la profession de professeur de danse, de gymnastique ou de natation ainsi que l'exploitation d'établissements de bains devra être interdit quand il existera des faits d'où il résulte que le requérant ne présenta pas, en ce qui concerne l'exercice de ces professions, les garanties suffisantes. Devront être interdits, pour les mêmes raisons, le commerce d'oiseaux vivants, le métier de fripier (commerce de vieux habits, literie ou linge usagés, commerce de revendeur de vieux métaux, ferraille, etc.) de même que le commerce de revendeur de déchets de fils et tissus de soie, laine, coton ou lin, le commerce de la dynamite ou d'autres matières explosives, et le commerce de billets de loteries et de tombolas ou de certificats provisoires ou coupures de ces billets. Il en sera de même des professions consistant à s'occuper des intérêts juridiques de tiers et à traiter leurs affaires auprès des autorités, notamment par la rédaction écrite de pièces y relatives, des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé, des opérations de ceux qui professionnellement donnent du bétail à cheptel (bail à cheptel), du commerce du bétail et de la vente de fonds ruraux, des agences de courtiers pour opérations immobilières ou de prêts des agences matrimoniales et du métier de commissaire-priseur. La vente aux enchères d'immeubles est interdite à ceux qui exercent le métier de commissaire-priseur, à moins qu'ils n'aient été nommés en cette qualité par les autorités de l'État ou des communes ou les corporations, compétentes à cet effet ». Pour mémoire, cet article 35 ne concerne plus la profession d'enquêteur ses dispositions ayant été abrogées pour cette activité en 2003 (loi no 2003-239 du , article 107, paragraphe II : « Dans la première phase du troisième alinéa de l'article 35 de la loi du dite "code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle", les mots "des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé" sont supprimés »).
- loi no 42-891 du complétée par la loi no 80-1058 du
- loi no 2003-239 du , (articles 102 et suivants)
- loi no 2011-267 du , J.O. du 15 mars, dite loi « LOPPSI2 ».
- Loi 83-629 du modifiée par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.
- Journal officiel de la République française du , page 11061 : réponse ministérielle, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
- Extrait du rapport no 508 du : Cet article définit les activités de recherches privées comment étant celles qui consistent, pour une personne, à recueillir, même sans faire état ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Il peut s’agir de la classique mission de filature dans le cadre d’un différend conjugal, mais aussi de la recherche, plus sophistiquée de renseignements à caractère économique. (Assemblée nationale, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (page 70) champ d’application du titre II de la loi)
- Cour d'appel de Paris, 13e chambre, arrêt du et cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du )
- Entre 1993 et 1995, 43 français ont été assassinés en Algérie, détournement d'un Air bus à Marseille en 1994, attentats de Paris de 1995.
- 2905 agence en , 3271 en septembre 2004
- Le projet de loi a été dépose par Monsieur Charles Pasqua, Ministre de l'Intérieur, qui avait, lui-même, exercé la profession de détective dans sa jeunesse
- Projet de loi no 543 (1993-1994);
- loi no 95-73 d'orientation et de programmation relative à la Sécurité
- ordonnance n° 2012-351 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure
- date d'entrée en vigueur du code de la sécurité intérieure et d'abrogation de la loi du 12 juillet 1983 : 1er mai 2012
- amendement gouvernemental rectificatif n° 387 du 6 septembre 2010 au Sénat
- projet de loi d'orientation pour la performance de la sécurité intérieure
- Il s'agit, ici, d'une autorité administrative de contrôle et de régulation mais pas d'un ordre professionnel bien qu'il sera doté des moyens coercitifs des instances ordinales : code de déontologie, moyen de contrôle, sanctions disciplinaires. Cette personne morale de droit public sera gérée en majorité (aux 3/4) non par les professions de sécurité mais par des représentants de l'État ainsi que par des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, même si chaque profession concernée sera représentée au conseil d'administration.
- loi no 2011-267 du , publiée au journal officiel de la République française du
- En effet le collège (ou organisme d'administration) est essentiellement composé de représentants de l'État, de magistrats, de membres des tribunaux administratifs, son directeur est nommé par décret, et les agents de contrôle sont désignés, dans chaque région et départements, par les préfets
- à savoir : gardiennage, protection physique des personnes (ou garde du corps), transports de fonds et détectives privés
- pour rappel : gardiennage, protection physique des personnes (ou garde du corps), transports de fonds et détectives privés
- en application de l'article 40 du code de procédure pénale
- Cette autorité sera donc, à la fois, policier et juge, ce qui parait pour le moins surprenant et ne semble correspondre ni au respect des droits de la défense ni au procès équitable. Cette situation, de juge et partie à la fois, entraînera probablement la saisine des juridictions internationales pour déterminer si ce dispositif est conforme au droit européen (notamment à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), même si le Conseil constitutionnel n'a pas cru devoir s'y arrêter alors qu'il a annulé, d'office, tout le titre 3 nouveau de la même loi relatif aux sociétés d'intelligence économique, pour non-conformité à la Constitution.
- sauf que le Bureau de la Sécurité Privée du Québec contrôle, aussi, les serrurier et les installateurs d'alarmes ce qui n'est pas le cas du CNAPS français. Le Ministère de l'Intérieur français a même tenté de sortir l'intelligence économique du contrôle du C.N.A.P.S. ce qui a été annulé par le Conseil Constitutionnel français dans une décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 (cf. les considérants n° 74, 75, 76 annulant l'article 32 de la loi LOPPSI 2 pour violation de la constitution).
- Avis de la Commission
- Loi no 2006-64 du , (J.O du 24/01), article 25-−3°.
- Extrait du rapport no 117 - Commission des Lois du Sénat - .
- Informations complémentaires
- TGI Paris : , relevant la faute d'un détective en raison de ses indiscrétions - C.A. Paris relevant que les enquêteurs ont trahi les secrets de leurs missions - C.A. Paris annulant la saisie de documents dans une agence tenue au secret professionnel (Source A.C.I.D.) + un jugement du Tribunal correctionnel de Paris datant de 2001 confirmé en appel (C.A. Paris 2002)
- Loi n° 78-17 du .
- Art. 226-17 du code pénal :
- « Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi no 78-17 du précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »
- Rapport du la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
- Article 19 de la loi du organisant la profession de détective privé.
- Loi sur le respect des intérêts du mandataire.
- Loi du organisant la profession de détective privé
- www.up-nb.be
- Sauf les cas prévus par la loi : cf. secret professionnel ainsi que les articles 10 et 19 de la loi belge organisant la profession de détective privé.
- Publié au Moniteur Belge du 02.10.1992
- La C.N.A.R. Chambre nationale des agents de recherches
- Décision renvoyée le 2 mai 1983, sur le rapport de M. Rudloff, au nom de la Commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, à Monsieur le ministre de l'intérieur et de la décentralisation
- www.ufedp.fr
- http://syndicat.apar.online.fr
- http://syndicat.adexa.online.fr
- http://association.afed.online.fr
- www.cnsp.org
- www.snarp.org
- www.cndep.org
- www.detective-ond.org
- observatoire des détectives
- créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, ses prérogatives ont été transférées au défenseur des droits à compter du et, pour les détectives privés, au Conseil national des activités privées de sécurité créé, lui, par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 dite LOPPSI2.
- Loi n° 2000-494 du 6 juin 2000
- Article 15 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V).
- Assemblée plénière CNDS du 21/9/2009, saisine n° 2008-135 - dépêche AFP du 13/11/2009 - infos complémentaires - Le Figaro du 13/11/2009
- Art. 433-17 C. pén.; usurpation de titres : source : avis 20089-135 du 21/9/2009 C.N.D.S.
- loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, publiée au journal officiel du 15 mars 2011, article 31 V.
- alors que la loi législation votée le 18 mars 2003 n'avait même pas eu le temps de s'appliquer faute de décret d'application promulgué en février 2009 avec 6 ans de retard et que les instructions aux préfets pour l'appliquer n'avaient été signées que par circulaire du 31 mars 2010
- Art. 33-2 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par article 31V de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (J.O. du 15/3/2011)
- Art. 33-6 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par article 31V de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (J.O. du 15/3/2011)
- Circulaire du Ministre de l'Intérieur aux Préfets n° NOR IOC/D11/08868/C du 28 mars 2011, page 3.
- article 30-1 nouveau de la loi 83-629 du 12 juillet 1983, créé par l'article 31 (V) de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée ».
- Article 16 du règlement toujours en vigueur depuis le 5 novembre 1950.
- Loi de 1978.
- « CNAPS : Conseil National des Activités Privées de Sécurité », sur www.cnaps-securite.fr (consulté le )
- loi LOPPSI2 du 14 mars 2011
- article 33-2 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, créé par l'article 31 (V) de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011
- Décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981.
- Articles 102 et suivants de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ajoutant un titre II réglementant les agences de recherches privées dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
- « Carte professionnelle - Cnaps Sécurité », sur www.cnaps-securite.fr (consulté le )
- voir modèle sur le site C.I.D
- art. 2 et 12 de la loi du 19 juillet 1991 modifiée organisant la profession de détective privé
- article 6, loi du 1er septembre 1974 sur les détectives, refondue le 22 juin 2006
- seule l'Université Panthéon Assas Paris 2 délivre ce diplôme en France.
- https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=616
- Décret n° 2005-1123 du 6/9/2005
- Article 4 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005.
- L'article 1353 du code civil Belge, entré en vigueur le 13 septembre 1807, précise : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont, en vertu de l'article 1353 du Code civil, abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».
- C.A. Bruxelles, 30/11/1983
- « Le rapport d'un détective privé produit dans le cadre d'une procédure en divorce pour cause déterminée ne peut être tenu pour dénué de toute valeur probatoire que lorsque les constatations qui s'y trouvent ne sont corroborées par aucun autre élément de la cause. En l'espèce, les faits constatés par le détective ne sont pas, dans leur matérialité, contestés par l'épouse et peuvent être mis en relation avec d'autres éléments de preuve du dossier produit par le mari. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats les éléments tirés du rapport du détective rétribué par le mari ».
- Cour d'appel de Bruxelles 04/02/1999 : La preuve par rapport de détective privé est, en principe, admissible dans le cadre d'une procédure en divorce étant donné que le législateur, dans la loi du 19 juillet 1991 réglant la profession de détective privé, lui a reconnu un rôle actif dans le cadre de telles procédures.
- « Les rapports établis par un détective privé, même s'ils sont établis par une personne rémunéré par celui qui lui a confié la mission de lui apporter des preuves, ne sont pas nécessairement dépourvus de toute valeur de preuve mais peuvent être pris en compte par le juge lorsqu'ils tendent à confirmer des données prouvées d'une autre manière ». (Cour d'appel de Bruxelles 18/12/2001)
- Cour de Cassation Belge, 24 avril 2007 : La seule circonstance qu'un juge d'instruction soit chargé de l'instruction d'une infraction n'empêche pas la partie civile de mener elle-même ou par les services d'un détective privé une enquête interne en ce qui concerne le dommage résultant de cette infraction, et de communiquer les informations ainsi recueillies au juge d'instruction.
- Arrêt n° 1020 du 7/11/1962, 2e chambre civile, affaire dame G. contre son époux
- cf. étude effectuée, sur les arrêts des Cours d'appel, par le service de documentation de la Cour de cassation et publié dans le bulletin d'information n° 712 du .
- Cf. infos complémentaires pour la jurisprudence française concernant la validité des rapports devant les cours et tribunaux : étude détaillée.
- Cour d'appel de Caen, 4 avril 2002
- Journal officiel de la République française, Assemblée nationale du 23 mars 2007.
- Tribunal Fédéral Suisse 15 juin 2009. Le Tribunal a, en outre, fixé les limites de l'intervention du détective qui ne doit pas tendre de piège à l'assuré
- Article 226-10 du code pénal français.
- Malgré les différentes réformes du divorce, l'infidélité conjugale constitue toujours une faute cf. jurisprudence susceptible de rendre intolérable le maintien du lien conjugal
- 15 à 20 % des affaires en France, alors que les affaires commerciales constituent 60 % : cf Profession détective privé sur RTL le 24 novembre 2010
- un "sous-marin peut prendre toutes les formes légales imaginables : camion, camionnette, fourgonnette, van, caravane…)
- Article 226-1 du Code pénal.
- Par exemple dans le cadre des articles 145 et 812 du Code de procédure civile.
- Source : rapport du 28 avril 1997, Conseil national des Barreaux français
- Source : rapport du Barreau de Paris à la Commission Outreau du 6 mars 2006
- Vœux du président de la République à la Cour de cassation, 9 janvier 2009 - cf. discours pour les juristes
- Avis 2008-138 CNDS 21/09/2009 : Dans le cadre d'une procédure en révision comme en l'espèce, l'avocat, qui ne peut instrumenter lui-même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant l'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense.
- Article R153-2 (2°) du code : « Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique ressortissante d'un État non membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes États ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes : (…) 2° Activités réglementées de sécurité privée » ;
- Source : rapport du Barreau de Paris à la Commission Outreau du 6 mars 2006
- même si quelques individus avaient cru devoir créer une association sans but lucratif, lui donnant cette appellation. Il ne s'agissait que d'un organisme purement privé, et, au surplus, également privé de tout privilège, prérogative ou pouvoir de puissance publique
- Source : Assemblée nationale - Réponse du ministre de l'intérieur, publiée au Journal officiel du 3/10/2006, page 10392 à la question n° 100822 de Monsieur Bernard Brochand député des Alpes Maritimes JO du 25/7/06, page 7728). La profession est en effet strictement règlementée notamment par la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 27 mai 2008, pourvoi n° T 07-13.131 (rejet)
- Cour d'appel de Dijon, arrêt du 23 janvier 2007
- Art. L.2132-3 du nouveau code du travail français entré en vigueur le 1er mai 2008 : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
- article 71-1 de la Constitution française
- qui est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du Ministre de l'Intérieur, dirigé par un préfet, et comportant plusieurs représentants de ce ministère (directeur des libertés publiques, préfet délégué interministériel à la sécurité privée, directeur de la police, directeur de la gendarmerie)
- Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, publiée au journal officiel du 15 mars, dite loi LOPPSI2 (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure
- Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée à de multiples reprises
- les enquêteurs et détectives privés, les enquêteurs d'assurances, les agents privés de recherches, les agents de sécurité, les transports de fonds, la protection physique de personnes
- (avec, néanmoins, une prééminence francophone) : le Centre d'Information et de documentation sur les détectives et enquêteurs privés.
- par exemple une dénomination ressemblant à un service public pour tromper le client et faire croire à un pouvoir imaginaire, ou encore des appellations issues de feuilletons télévisées etc.
- en France, par exemple, au-delà d'une certaine somme le règlement est interdit et pénalement et fiscalement sanctionné
- Il s'agit, ici, de la transmission d'informations par courriel (mails). Ceux-ci doivent, soit être chiffrés grâce à la possession (par l'expéditeur et le destinataire) d'une signature numérique, soit, cas le plus fréquent les particuliers ne disposant pas de certificat numérique, être chiffrés dans une pièce jointe au mail qui ne s'ouvrira qu'avec un mot de passe confidentiel et transmis verbalement au client ou préalablement convenu avec lui.
- En France, l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle est obligatoire
- En France, par exemple, le devoir de conseil est une obligation légale imposée à tous les professionnels
- la gratuité ou le règlement de la consultation dépend de chaque office de recherches
- Il appartient, au client, de vérifier — au moment de la prise de rendez vous — quel sera le montant facturé dans le cadre de cette consultation.
- article 25 II, 1er alinéa, Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, et article 1er-1 décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005
- « Organisation | Internet CNAPS », sur cnaps.interieur.gouv.fr (consulté le )
- « Agréer votre entreprise | Internet CNAPS », sur www.cnaps.interieur.gouv.fr (consulté le )
- au 14 avril 2009 ce bureau n'est pas encore constitué et il convient de s'adresser à la gendarmerie royale
- W.A.D. World Association of Detectives
- I.K.D. Internationale Kommission der Detektiv-Verbände ou également I.R.I.S., groupement européen élitiste
- directive du Conseil des Communautés européennes (n° 67/43/CEE du 12 janvier 1967) instaurant la liberté d'établissement pour les agences de renseignements dans les pays de la Communauté
- Arrêts des 29/10/1998 n°C-114-17, et 26/01/2006 n°C-514-03
- Bulletin d'information du ministère fédéral de l'Intérieur - No. 5-6/2004, rubrique « sécurité publique »)
- Liste du Ministère de la Sécurité publique, direction générale de la sécurité et de la prévention, direction de la sécurité privée. Liste à jour au 6 avril 2010. Le calcul a été effectué comme suit : la liste nationale des détectives privés autorisés en Belgique comporte 145 pages à raison de 7 détectives par page (à quelques exceptions près, par exemple la dernière qui ne comporte que six noms) soit un total de 915 détectives autorisés.
- Recensement effectué par la fédération UFEdp auprès des Préfectures du territoire métropolitain et des D.O.M. (hors T.O.M.)
- Le CNAPS estime à 1 200 le nombre d'autorisations d'exercer valides en France en décembre 2019. La baisse importante du nombre d'agences s'explique par le durcissement des conditions de création d'un cabinet d'investigations initié en 2003 et poursuivi jusqu'à aujourd'hui.
- La Confédération suisse est divisée en cantons. La République et Canton de Genève a réglementé la profession qui doit disposer d'une autorisation délivrée par le Conseil d’État. Cette République comptait 232 agences à la fin de l'année 2013 selon une enquête réalisée par la Tribune de Genève en date du 26 mars 2014. source
- Sécurité publique du Québec. Elle fait la distinction entre les trois activités, soit investigations seules, soit investigations et sécurité, soit sécurité seule.
- Bureau de la sécurité privée du Québec : ce bureau est désormais chargé, par la loi, du contrôle des professions de sécurité au Québec
- source
- Centre d'information sur les détectives et enquêteurs privés
- Auteur inconnu (Courrier international) 2010
Voir aussi
Sources externes
- « Roumanie. L’État embauche des détectives privés pour lutter contre le travail au noir », Courrier international, (lire en ligne)
- (en) Özgür Öğret, « Turkih private detectives lobby for legal status », Hürriyet Daily News, (lire en ligne)
Syndicats et associations de détectives privés
- Syndicats français de détectives privés (cf. rubrique prévention et sécurité)
Articles connexes
- Enquêteur d'assurances
- Enquêteur de droit privé
- Enquêteur de fiction
- Fuite d'information
- Roman policier, avec une liste des principaux détectives privés ou institutionnels de la littérature.
- Liste des métiers de la sécurité privée
Liens externes
- Centre d'information sur les détectives et enquêteurs privés site associatif consacré à l'information (mondiale francophone) sur cette activité.
- Défenseur des Droits : nouvelle autorité constitutionnelle française chargée de contrôler le respect de la déontologie par les détectives privés depuis mai 2011.
- Commission nationale de déontologie de la sécurité : autorité publique française chargée de contrôler le respect de la déontologie par les détectives privés jusqu'en mai 2011)
- Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés : autorité administrative française chargée de vérifier que les agences de détectives n'usent pas de moyens informatiques illégaux.
- Loi règlementant les enquêteurs privés français sur Legifrance : voir le titre II
- Préfecture de Police de Paris : seule autorité administrative compétente pour les détectives de l'Union Européenne souhaitant exercer ponctuellement en France.
- CNAPS : Conseil national des activités privées de sécurité


