Marie Dorval
Marie Dorval, née Marie Amélie Thomase Delaunay le à Lorient et morte le dans l'ancien 10e arrondissement de Paris[2], est l’une des plus célèbres actrices françaises du XIXe siècle. Ses succès au théâtre et sa vie sentimentale bien remplie contribueront à en faire un mythe.

| Naissance | |
|---|---|
| Décès |
(à 51 ans) Ancien 10e arrondissement de Paris |
| Sépulture | |
| Nom de naissance |
Marie Amélie Thomase Delaunay |
| Nationalité | |
| Activité | |
| Conjoint | |
| Enfant |
Gabrielle Dorval (d) |
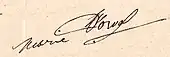


Biographie
Fille des comédiens ambulants Marie Joseph Charles Delaunay (1766-1802) et Marie Bourdais[3], Marie Dorval est abandonnée par son père à l’âge de cinq ans. Peu de temps après, elle perd sa mère, victime de la tuberculose. Elle joue d’abord des rôles d’enfants à Lille, sous le nom de « Bourdais », qui est celui de son oncle, acteur comique distingué[4].
Le , à Lorient, elle épouse le maître de ballet Louis Étienne Allan-Dorval[5], dont elle aura deux enfants : Marie Louise Désirée[6] et Catherine Françoise Sophie[7]. Le couple se sépare en 1818, mais Dorval laisse à son épouse son nom de scène qui passera à la postérité[8].
Se produisant définitivement sur la scène, elle est attachée à diverses troupes de province pour les amoureuses de comédie et les dugazons d’opéra comique. À Strasbourg, elle commence à jouer les premiers rôles de comédie et de drame et se fait remarquer par Charles-G. Potier, qui la fait engager à Paris, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, en 1818[4] - [9].
De 1818 à 1826, elle entretient une relation avec le compositeur Alexandre Piccinni, dont elle aura trois filles[10].
En 1827, elle connaît le succès dans la pièce Trente ans, ou la vie d’un joueur de Victor Ducange et Prosper Goubaux, où elle a pour partenaire le célèbre acteur Frédérick Lemaître. Veuve de son premier mari, elle épouse en secondes noces, à Paris, le , le journaliste Jean-Toussaint Merle[11], mais le couple s'accorde sur le principe d'une union libre permettant aux deux partenaires d'avoir des aventures passagères.
En 1832, elle devient la maîtresse d’Alfred de Vigny[12] - [13] qui, avec Victor Hugo, la fera entrer au Théâtre-Français au mois de [9]. Le nom de Marie Dorval se rattache à la révolution dramatique de l’école romantique. Son jeu, où l’art disparaît sous le naturel de la sensibilité et sous les élans de la passion, s’adapte parfaitement à la nouvelle littérature. À la majesté classique, elle substitue, elle aussi, la violence des effets.
En , elle se lie avec l'écrivaine George Sand après avoir reçu d'elle une lettre admirative concernant l’une de ses représentations[14]. Leur amitié intense donne lieu à des rumeurs de lesbianisme à Paris, d'autant que chacune des deux femmes avait fait l'objet de ces rumeurs auparavant[15]. Gustave Planche écrit à Sand de se méfier de cette « dangereuse amitié[16] » tandis qu'Alfred de Vigny écrit à Dorval de rester à distance de Sand, qu’il qualifie de « damnée lesbienne[17] ». Les historiens actuels restent partagés sur la nature de cette relation, dont le caractère amoureux ou sexuel n'a pas été vérifié [18]. En 1840, elle joue la pièce Cosima, de George Sand, à la Comédie française[19]. Les deux femmes collaborent même au manuscrit, mais la pièce, mal reçue, n'aura que sept représentations[20].

Marie Dorval exprimera son talent remarquable à la Porte Saint-Martin, dans des œuvres mélodramatiques, le Château de Kenilworth, les Deux Forçats, Trente ans, ou la Vie d’un joueur, etc. ; puis des créations d’un ordre plus élevé, Antony et Marion de Lorme, lui développeront l'ampleur de son talent. Elle a été applaudie, à la Comédie-Française, dans Chatterton, pièce dans laquelle elle a incarné le rôle de Kitty Bell[21]. Toujours à la Comédie-Française, en 1835, elle joue dans Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo en compagnie de sa rivale Mlle Mars. Les deux actrices sont distribuées à contre-emploi, Marie Dorval interprétant le rôle de Catarina, noble femme d'Angelo[22], et Mlle Mars celui de la Tisbe, courtisane, comédienne et maitresse du tyran de Padoue[23].
Elle apparaît dans Lucrèce de François Ponsard (1843) et, revenant au drame des boulevards, elle remporta malgré ses forces épuisées et sa voix presque éteinte, un dernier succès avec Marie-Jeanne, ou la femme du peuple, d’Adolphe d'Ennery [24].
Vers la fin de sa vie, elle s’essaya au répertoire classique à l’Odéon, créa Agnès de Méranie de François Ponsard (1846) et joua, non sans succès, les rôles de Phèdre et d’Hermione[4]. Les changements dans la mode et le désir du public de voir des actrices plus jeunes achèvent sa carrière par des tournées en province. Elle meurt, très dépressive, à l’âge de cinquante et un ans, après la mort d’un petit-fils.
Après le service funèbre, célébré le surlendemain de sa mort, à Saint-Thomas-d’Aquin, elle a été inhumée au cimetière du Montparnasse[25], au côté de son mari[26].
Postérité littéraire

Michel Mourlet a publié un roman (Histoire d’un maléfice, 2001) et une pièce de théâtre (Marie Dorval) qui s'inspirent librement des amours de Marie Dorval[27]. Après une mise en espace en 2002, en la crypte de la Madeleine (ADAC Ville de Paris), par la troupe de Dominique Leverd, la pièce a été créée la même année au théâtre de Saint-Maur dans une mise en scène de Jean-Pierre Savinaud[28]. Elle a fait l'objet d'une nouvelle mise en scène en 2003 au Théâtre de l'Entre-Texte d'Arles et a été publiée en 2014 dans le recueil Pièces masquées[29].
Notes et références
- Jean-Claude Daufresne, Théâtre de l’Odéon : architecture, décors, musée, Mardaga, , 297 p. (ISBN 978-2-87009-873-8, lire en ligne), p. 57-58.
- Fiche sur l'état civil reconstitué de Paris (XVIe-1859), vue 50/51
- Née en 1781 et morte vers 1816.
- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, , xvi-2096, 2 tomes en 1 vol. ; 25 cm (lire en ligne), p. 651.
- Né le 25 décembre 1777 à Paris Ve, et mort, le 30 mai 1820, à Saint-Pétersbourg.
- Née en 1814.
- Née en 1815.
- « Orpheline à quinze ans, j’épousai le premier venu qui voulut bien se charger de mon sort ; le hasard intervertit les rôles, je devins la protectrice de mon protecteur. Les souffrances elles travaux de la maternité, les soucis du ménage, les dures peines de l’acteur de province, sans feu ni lieu pour ainsi dire, en butte aux caprices du public, aux faillites des directeurs, ont rempli ma jeunesse. » Voir Coupy, op. cit.
- E. Coupy, Marie Dorval, 1798-1849 : documents inédits, biographie critique et bibliographie, Paris, Librairie internationale, , xii-471, 1 vol. ; in-12 (lire en ligne), p. 6.
- Deux d'entre elles mourront en bas âge.
- Europe : revue littéraire mensuelle, Paris, (lire en ligne), p. 188.
- Liaison tumultueuse puisque le poète fit suivre sa maîtresse par le premier détective de l'histoire : Vidocq. (source : Historique des détectives privés)
- Alfred de Vigny et Marie Dorval (préf. Ariane Charton), Lettres à lire au lit : correspondance amoureuse d'Alfred de Vigny et Marie Dorval (1831-1838), Paris, Mercure de France,
- Jean-Pierre Lassalle, Alfred de Vigny, Paris, Fayard, coll. « Biographies Littéraires », , 500 p. (ISBN 978-2-213-66088-2, lire en ligne), p. 97.
- Jean-Paul Clément, « George Sand : le scandale du pantalon », sur Revue Des Deux Mondes, (consulté le )
- Anna Gaylor, Marie Dorval : grandeur et misère d’une actrice romantique, Paris, Flammarion, , 260 p. (ISBN 978-2-08-066298-9, lire en ligne), p. 116.
- Hans Mayer (trad. de l'allemand par Laurent Muhleisen), Les Marginaux : femmes, juifs et homosexuels dans la littérature européenne, Paris, Albin Michel, , 535 p. (ISBN 978-2-226-06498-1, lire en ligne), p. 113.
- (en) Ruth M. Pettis, « Dorval, Marie (1798-1849 », sur www.glbtqarchive.com, (consulté le ).
- « Marie Dorval 2 vers 1830/ Vigny, Sand... », sur Tours et culture, (consulté le )
- Henri Heine (Note 2), Lutèce : Lettres sur la vie politique, artistique et sociale, Paris, La fabrique éditions, , 475 p. (ISBN 978-2-35872-133-2, lire en ligne), p. 84.
- Alfred de Vigny, Chatterton : drame en trois actes, Paris, Souverain, coll. « Classiques pour tous », , 111 p. (lire en ligne), p. 26.
- Pierre Maleuvre, « Costume de Marie Dorval (Catarina) dans Angelo, tyran de Padoue », (consulté le ).
- Jules Janin, Histoire de la littérature dramatique, t. 6, Paris, 376 p., 6 vol. ; in-18 (lire en ligne), p. 191 & 194.
- « Archives des Théâtre - comédienne : Marie Dorval », sur Tours et culture (consulté le )
- Division 6.
- (en) Bettina Liebowitz Knapp, Marie Dorval : France’s theatrical wonder : a book for actors, Amsterdam ; New York, Rodopi, , 234 p. (ISBN 978-90-420-2132-7 et 90-420-2132-2, OCLC 897034011, lire en ligne), p. 228.
- Michel Mourlet, « Le Démon des planches : Souvenirs d'un intermittent du spectacle », dans Michel Mourlet, L'Anti-Brecht : Le Théâtre, sa mort, sa vie, France Univers, (lire en ligne)
- « Archives du Spectacle »
- Les Cygnes, collect. « Théâtre contemporain ».
Bibliographie
- Dictionnaire des comédiens français, ceux d'hier : biographie, bibliographie, iconographie, Paris (lire en ligne), p. 569.
- Francis Ambrière, Mademoiselle Mars et Marie Dorval, au théâtre et dans la vie, Paris, Le Seuil, , 710 p., 22 cm (ISBN 978-2-02-015963-0, OCLC 406971930).
- E. Coupy, Marie Dorval, 1798-1849 : documents inédits, biographie critique et bibliographie, Paris, Librairie internationale, , xii-471, 1 vol. ; in-12 (lire en ligne).
- Théophile Gautier, « Mort de Madame Dorval », La Presse, , p. 2-3 (lire en ligne, consulté le )
- (en) Anna Gaylor, Marie Dorval : grandeur et misère d’une actrice romantique, Paris, Flammarion, , 260 p. (ISBN 978-2-08-066298-9, lire en ligne), p. 116.
- (en) Bettina Liebowitz Knapp, Marie Dorval : France’s theatrical wonder : a book for actors, Amsterdam ; New York, Rodopi, , 234 p. (ISBN 978-90-420-2132-7 et 90-420-2132-2, OCLC 897034011, lire en ligne).
- Françoise Moser (préf. Henri Guillemin), Marie Dorval, Paris, Plon, , 248 p. (OCLC 718377011).
- Lettres pour lire au lit, correspondance amoureuse entre Marie Dorval et Alfred de Vigny, présentation et notes d'Ariane Charton, Mercure de France, coll. Le Temps retrouvé, Paris, 2009.
Liens externes
- Ressource relative au spectacle :
- Ressource relative aux beaux-arts :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :