Diplomatie byzantine
La diplomatie byzantine, beaucoup plus que la force de ses armées, explique, en bonne partie, la survie millénaire de l’empire face aux nombreux ennemis qui l’entouraient ou s’apprêtaient à envahir ses frontières ; elle se basait sur un judicieux mélange de pression militaire, d’intelligence politique, de corruption et de propagande religieuse.

Elle recueillait d’abord soigneusement toutes les informations sur les peuples qui l’entouraient ou se disposaient à envahir ses frontières provenant de ses émissaires, de ses militaires, de ses marchands et de ses missionnaires. Au sein de la bureaucratie de Constantinople, le « bureau des barbares » recueillait soigneusement les notes et informations sur les peuples étrangers, désignés (sauf pour les Perses et les Arabes qui jouissaient d’un statut supérieur) du terme "τά έθνη", l’équivalent de l’ancien romain « gentes » ou « ces peuples (avec une nuance de mépris) »[1] - [2]. C’étaient, aux VIe siècle et VIIe siècle les peuples germaniques (Vandales, Wisigoths, Ostrogoths, Lombards et Francs) et slaves ou ouralo-altaïques (Croates, Serbes, Bulgares, Huns et Avars) ainsi que les Perses et plus tard les Arabes ; au Xe siècle ce furent les Khazars, Petchénègues, Hongrois (appelés Turcs par les Byzantins). S’y ajoutèrent progressivement des États en voie de se constituer, comme les Royaumes Francs puis l'Empire Carolingien (la Francie), qui deviendra le Saint-Empire romain et le Royaume de France, les autres principautés européennes de Méditerranée, surtout les États italiens (Venise, Pise, Amalfi, Gênes)[3]. À la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, elle inclura également une alliance avec l’Empire mongol[4].
Sauf sous quelques empereurs, elle préféra éviter les conflits militaires et, privilégiant la voie diplomatique, développera divers moyens légaux, culturels et commerciaux qui lui permettront de tisser un réseau d’États alliés où chaque peuple trouvait sa place dans un monde où, conformément à la vision byzantine du monde, ceux-ci gravitaient autour d’un empereur qui avait pour mission de diriger « le monde habité » ou « oikoumène », reflet de l’ordre que Dieu faisait régner dans les cieux, vision du monde que Dimitri Obolensky appellera « Le Commonwealth byzantin ».
Principes et méthodes de la diplomatie byzantine

.
On ne pourrait comprendre les principes directeurs et les méthodes employées par la diplomatie byzantine, sans se rappeler d’abord la conception du monde qui était la sienne. Pour les Byzantins, l’organisation politique du monde (l’oikoumène) devait reproduire sur terre l’harmonieuse organisation céleste. Elle était par conséquent partie du plan de Dieu et devait aider au salut des hommes en attendant la seconde venue du Christ lorsque le monde matériel disparaitrait pour faire place au monde spirituel. D’où également l’union très intime existant entre État et Église[5]. C’est ainsi que Constantin VII Porphyrogénète, prodiguant ses conseils à son fils, écrira dans son livre sur l’administration de l’empire : « De la sorte, puisse le pouvoir impérial s’exerçant avec ordre et mesure, reproduire le mouvement harmonieux que le Créateur donne à tout cet Univers et [l’Empire] apparaitre à nos sujets plus majestueux et, par là même, plus agréable et plus admirable[6]".
En découlaient trois principes fondamentaux sur lesquels s’appuyait la politique étrangère de l’Empire.
Les principes de la diplomatie byzantine
1. L’universalisme et le juridisme. Ces deux principes étaient essentiellement un legs de l’ancienne Rome. Pour les Byzantins, comme l’écrira Agathias au IVe siècle, leur empire embrassait, du moins en théorie, l’ensemble de l’univers civilisé ou oikoumène dont l’empereur était le seul souverain légitime, rêve qu’avaient tenté de réaliser Auguste et ses successeurs immédiats, rêve que reprendra Justinien quelques siècles plus tard[7].
Cet univers constituait un réseau (Dimitri Obolensky utilisera pour le décrire le terme de « Commonwealth ») d’États subordonnés où chaque nation avait sa place dans une hiérarchie qui tenait compte de l’excellence de sa culture, du degré d’indépendance politique dont jouissait son prince, des ressources militaires dont disposait celui-ci et des services que cette nation pouvait rendre à l’empire[8].
Cherchant d’abord à défendre ses frontières, Byzance s’attachera les peuples voisins ou qui menaçaient celles-ci au moyen de traités qui prenaient la forme d’un chrysobulle spécifiant les engagements des deux parties. Ces traités rappelaient les alliances semblables conclues par les Romains avec les peuples barbares, lesquels devenaient des foederati ou alliés de Rome dont ils recevaient protection et qu'ils s’engageaient en contrepartie à défendre contre ses ennemis[9].
Ce genre de traité spécifiait toujours combien de soldats les nouveaux vassaux s’engageaient à fournir à l’empire : 6000 Varègues en fonction du traité passé entre Vladimir de Russie et Basile II en 987[10], 2000 Serbes pour les guerres d’Europe et 500 pour les guerres d’Asie au terme du traité passé entre Manuel Comnène et le joupan de Rascie en 1150[11]. Certains vassaux étaient plus particulièrement chargés de la garde des frontières de l’empire comme les chefs arméniens établis dans l’empire au XIe siècle[12]. Ces contributions n’allaient toutefois pas sans contrepartie financière ; ainsi 700 Rus'[N 1] ayant participé à une expédition contre la Crète furent payés 7200 nomismata[13]. De plus, l’empereur versait généralement à son nouveau vassal une pension (roga) et des indemnités annuelles.
2. La conviction de leur supériorité culturelle qui se traduisait par le terme de "barbares" qu'ils employaient pour décrire les autres peuples, héritage de la culture grecque. Les termes utilisés dans les traités trahissaient la supériorité dont se sentaient imbus les Byzantins. L’empereur était désigné comme le « père » de ces nations, sauf pour les Perses remplacés plus tard par les Arabes et dont les chefs étaient qualifiés de « frères », les deux empires se considérant comme les seuls civilisés face aux peuples barbares[14]. Son nom précédait toujours celui du chef auquel il s’adressait (sauf dans le cas des Perses) et souvent il exigeait des États vassaux la δουλεία ou obéissance propre aux esclaves (δουλοι). En revanche, les chefs de ces peuples se voyaient conférer des titres empruntés à la cour de Byzance, lesquels s’ils flattaient leur vanité, créaient un lien de dépendance en indiquant le rang que tiendrait ce peuple au sein de l’oikoumène dirigée par l’empereur[15]. On se souviendra de la joie de Clovis de recevoir le titre de consul des mains d’Anastase Ier[16]. Même le doge de Venise à un moment où l’ancienne colonie s’était manifestement affranchie des liens de dépendance à l’endroit de l’ancienne métropole reçut le titre de protosébaste, l’un des plus élevés de la nouvelle nomenclature d’Alexis Ier après la victoire navale des Vénitiens sur les Normands en 1082[17]. De même, Stefan Nemanja reçut le titre de sébastocrate, la seconde dignité de l’Empire alors qu’il cherchait à établir l’autonomie de la Serbie face à Byzance[18]. Cet appât fut également utilisé avec les croisés par le parallèle pouvant être fait avec le système féodal qui s’implantait en Europe, impliquant un lien de vassalité entre le seigneur et son suzerain ; c’est ainsi que Bohémond fut fait sébaste en 1108 après la signature du traité de Déabolis.
3. La conception judéo-chrétienne d’un peuple choisi ayant pour mission de diffuser la vraie foi (ou orthodoxie) dans tout l’oikoumène[19]. Dès lors la méthode la plus efficace de rattacher ces peuples à l’empire était l’envoi de missionnaires, non seulement en Europe de l’Est, mais également en Asie et jusqu’en Extrême-Orient où cette méthode eut moins de succès. Le pragmatisme byzantin qui permettait d’évangéliser ces peuples et de célébrer la liturgie dans leur propre langue, alors que seul l’usage du grec, du latin et de l’hébreu était permis par les missionnaires francs, contribua pour beaucoup au succès de l’entreprise chez les Slaves. L’œuvre des frères Cyrille et Méthode, en dépit de son échec initial en Moravie, fut un élément déterminant dans la conversion de la Bulgarie, de la Russie et de la Serbie et de leur inclusion dans le Commonwealth byzantin par leur adhésion à la foi orthodoxe[20]. C’est ainsi qu’alors même que Constantinople était à toute extrémité, le patriarche Antoine rappellera au grand-prince russe Vasili dont les tendances autonomistes devenaient manifestes que de même qu’il n’existait dans le monde qu’une seule Église, il n’y avait également qu’un seul empereur qui était celui de Constantinople et que si d’autres souverains s’étaient appropriés ce titre, c’était par simple usurpation[21].
Les méthodes de la diplomatie byzantine
Les méthodes pour parvenir à ces fins étaient également de trois ordres :
(1) Financier. Devant toujours faire face aux menaces d’invasions venant du sud et de l’est (Perses, Arabes, Turcs), du nord (Hun, Slaves, Bulgares, Petchenègues) et même de l’ouest (Normands, Saint Empire romain), les Byzantins considéreront toujours préférable d’utiliser la diplomatie à la guerre, toujours ruineuse tant en termes financiers qu’en main d’œuvre humaine.

Les empereurs n’hésiteront jamais à verser des sommes considérables pour s’assurer de la loyauté des États satellites. Ainsi, Constantin Porphyrogénète s’adressant à son fils, écrivait au sujet des Petchenègues : « Je pense donc qu’il est toujours préférable pour l’empereur des Romains, d’être conduit à maintenir la paix avec le peuple des Petchenègues et à conclure des conventions et des traités d’amitié avec eux et de leur envoyer chaque année un apocrisiaire (ambassadeur) avec des présents dignes de ce peuple[22]. De même, il lui recommandait de ne pas lésiner sur les cadeaux afin d’utiliser les Petchenègues contre les Russes et les Turcs[23].
Et même lorsque des sommes durent être payées à la suite d'une défaite militaire, devenant ainsi un tribut payé à l’adversaire par Constantinople, celles-ci seront décrites par la propagande impériale comme un dédommagement pour services rendus ou à rendre à l’Empire[24]. Ainsi Justin II dut payer 80 000 pièces d’argent aux Avars, alors que sa femme Sophie versa 45 000 solidi à Chosroês Ier pour une trêve d’une année[25]. Son successeur, Tibère II Constantin (r. -) sera forcé de payer 7 200 livres d’or annuellement pour le même privilège qu’il trouva moins couteux qu’une longue guerre.
La soie constitua également un instrument diplomatique important. Par le traité de 924 conclu entre Siméon de Bulgarie et Romain Ier Lécapène (r. 920 - 944), les Byzantins s'engagaient à donner tous les ans 1 000 tuniques de soie richement brodées à la cour du roi bulgare, en échange de quoi Siméon acceptait de se retirer du territoire impérial.
(2) Culturel. Les Byzantins tenteront d’associer les peuples « barbares » à l’Empire en flattant leur vanité par de riches présents et l’offre de titres qui, tout en les associant à la hiérarchie impériale, étaient accompagnés d’un salaire annuel viager appelé « roga », similaire à celui versé aux fonctionnaires byzantins.

Particulièrement significatif était l’envoi de couronnes à divers souverains étrangers lors de leur avènement. Loin d’être simplement un geste de bonne volonté, cet envoi (qui était du reste également le fait du pape ou d’autres souverains) impliquait la création d’un lien de dépendance au moins moral entre le donateur et le récipiendaire. Particulièrement illustre est la « Sainte Couronne de Hongrie » envoyée par Michel VII Doukas au roi Géza de Hongrie, lequel comme son prédécesseur André Ier faisait preuve de grandes sympathies byzantines. Sur l’un des panneaux au-dessus du bandeau on peut voir, sur le devant le portrait du Christ avec les archanges Gabriel et Raphaël. À l’arrière au même niveau que le portrait du Christ (au-dessus du bandeau), le buste de l’empereur Michel VII portant la couronne impériale ; sous lui (sur le bandeau), le coempereur Constantin et un autre personnage désigné comme « Géza, roi fidèle de Hongrie (Krales Tourkias) ». Mais alors que les représentations de l’empereur et du coempereur portent un nimbe de sainteté et que leurs noms et titres sont inscrits en pourpre, couleur réservée à l’empereur, celui de Géza montre celui-ci le regard tourné vers le coempereur, portant des vêtements moins luxueux que les deux premiers et son titre est inscrit à l’encre bleue. On ne peut voir meilleure illustration de la théorie byzantine de la hiérarchie des États et nations, gravitant en heureuse harmonie autour du monarque et autocrate universel de Constantinople[26].
Longtemps, le mariage de princesses byzantines à des princes étrangers, surtout s’ils étaient païens, était considéré comme une mésalliance. Constantin VII dans le De Administrando Imperio[27] condamne cette pratique tout en reconnaissant que certains de ses prédécesseurs y avaient eu recours « pour le bien de l’État ». Même en 968, lorsque Liutprand de Crémone viendra solliciter la main d’une princesse porphyrogénète pour le fils d’Otton Ier, on lui répondra avec hauteur qu’ « il n’est pas dans l’ordre des choses que la fille née dans la pourpre d’un empereur né dans la pourpre devienne l’épouse d’un étranger[28]".
Toutefois, cette tradition avait déjà souffert plusieurs exceptions, la raison d’État s’inclinant devant les réalités géopolitiques : en 732 Léon III avait officialisé son alliance avec les Khazars en mariant son fils Constantin avec Tzitzak, fille du khagan Bihar ; par la suite le mariage de la petite-fille de Romain Ier (r. 920-944) servit à consolider la paix avec ce pays[29].
Par la suite, et surtout avec l’avènement des Comnènes, on assistera à un renversement complet de la situation, et à l’adoption d’une politique matrimoniale visant à relier la cour de Byzance aux principales cours d’Europe. C’est ainsi qu’après la restauration de l’empire, Michel VIII (r. 1263-1282) conclura une alliance avec le Khan mongol à qui il donnera deux de ses filles en mariage : Euphrosyne Paléologue qui maria Nogai Khan de la Horde d’Or et Maria Paléologue qui maria Abaqa Khan de Perse[30].

(3) Religieux. La période de grande activité diplomatique qui commença avec le milieu du IXe siècle coïncida avec une époque de grande activité missionnaire. En faisant des leaders de ces peuples baptisés les « fils spirituels » de l’empereur, Byzance établissait son influence culturelle auprès de ces élites, complétée par le travail de ses missionnaires auprès du peuple[31].
Déjà sous Justin Ier (r. 518-527), le roi des Lazi, peuple du Caucase, qui cherchait la protection de l’empire avait adressé à l’empereur une lettre en ces termes : « Nous espérons que Tu feras de nous des chrétiens comme Toi-même, et nous serons sujets de l’empire des Romains »[32].
En 860, sous Michel III (r. 842-867), les frères Cyrille et Méthode furent envoyés en mission chez les Khazars, peuple des steppes établis au nord de la Mer Noire qui constituaient une sérieuse menace pour l’empire ; ils auraient fait de nombreuses conversions dans ce peuple converti au judaïsme au IXe siècle. Peu après leur retour, en 862, le prince Rastislav de Grande Moravie qui cherchait à échapper à l’emprise germanique envoya une ambassade à Constantinople pour demander des clercs capables de christianiser ses sujets dans leur propre langue. Pour ce faire, les deux frères originaires de Thessalonique qui parlaient déjà le slavon développèrent un alphabet, le glagolitique, permettant la mise par écrit de cette langue. Même si après leur mort le christianisme orthodoxe qu'ils y avaient implanté tomba sous les coups du clergé germanique fidèle à Rome, les disciples qui les avaient accompagnés trouvèrent refuge en Bulgarie où le tsar Boris Ier (r. 852-889), en guerre avec Byzance, accepta de se convertir au christianisme oriental en 864, obtenant en contrepartie la paix et des concessions territoriales en Thrace. Suivant ce qui devenait une tradition, l’empereur Michel III lui servit de parrain ; Boris prit le prénom de Michel, alors que sa femme recevait celui de Maria[33].

La conversion de la Russie devait suivre le même schéma politico-religieux. Les premiers efforts de conversion furent probablement faits sous le patriarche Photius qui vers 867 informait les autres patriarches que les Bulgares avaient accueilli le christianisme avec enthousiasme[34]. En 945 ou 957, selon les sources, la princesse régente Olga de Kiev qui s’était convertie et avait pris le prénom d’Hélène (prénom de l’épouse de Constantin VII), vint en visite à Constantinople en compagnie d’un prêtre du nom de Grégoire. L’empereur lui fit une brillante réception au cours de laquelle elle fut reçue à deux reprises par l’empereur et son épouse au cours de cérémonies destinées à montrer que la princesse elle-même, et par conséquent son pays, faisaient maintenant partie des nations importantes de cette grande famille sur laquelle présidait l’empereur[35]. Cette première conversion fut suivie d’un retour du paganisme et ce ne fut que sous Vladimir Ier qu’eut lieu la conversion officielle du pays[N 2].
En 987, Bardas Phocas se révolta contre Basile II (r. 960-1025), lequel demanda l’aide des Rus’. Vladimir accepta en échange d’une alliance matrimoniale. Il accepta en même temps de se convertir ainsi que son peuple au christianisme. Il n’est pas certain si Vladimir fut baptisé à Cherson ou à Kiev ; chose certaine toutefois, Il prit alors le nom chrétien de Basile en hommage à son beau-frère. La cérémonie du baptême fut immédiatement suivie de celle du mariage à la suite de quoi Vladimir envoya 6 000 Varègues au secours de Basile[36] - [37].
Rapport avec les États importants
Les Byzantins voyaient donc le monde comme un ensemble de cercles concentriques au centre duquel siégeait l’empereur. Sous lui venaient les princes et par conséquent les pays professant la véritable orthodoxie ; un peu plus loin, les princes qui pour des raisons historiques ou autres étaient reliés à la maison impériale, même s’ils n’étaient pas (encore) chrétiens, et plus tard au cours de l’histoire les princes chrétiens ne professant pas l’orthodoxie. Il en découle que la distinction entre politique intérieure et politique étrangère était assez floue, tout comme du reste la notion de « frontière », laquelle, contrairement à la notion moderne qui en fait une ligne géographique précise, correspondait plutôt aux territoires sur lesquels s’exerçait effectivement l’autorité d’un prince. Et il est remarquable que les Byzantins utilisaient les termes par lesquelles ils décrivaient leur propre empire – basileia (empire), oikouménè (univers habité) et politeuma (gouvernement-communauté) indistinctement pour l’ensemble des nations sur lesquelles ils étendaient ou prétendaient étendre leur autorité[38].
D’où la nécessité de réconcilier la théorie et la pratique, cette qualité que les Byzantins qualifiaient d’ « oekonomia », aptitude à adapter la vision du monde à la réalité quotidienne et qui contribuera un peu à donner au qualificatif « byzantin » une notion péjorative, selon leur vision.
Même alors que l’empire sera réduit à Constantinople et à ses environs, l’empereur prétendra être le seul monarque ayant droit au titre de basileus (« Βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων : empereur des Romains »). Michel Ier Rangabe refusera de concéder ce titre à Charlemagne, lui donnant simplement le titre de « roi » dans sa translitération grecque. Même lorsque la nécessité obligera à concéder ce titre à un prince étranger, le titre sera d’abord assorti de qualificatifs qui en restreignaient la portée. Ainsi les empereurs du Saint-Empire seront appelés « basileus des Francs » ; même après la disparition de ces restrictions (Nicétas Choniatès donne à Roger de Sicile, Frédéric Barberousse et Henri VII le titre de basileis), le titre complet d’ « Empereur des Romains » sera réservé à l’empereur de Constantinople[39], l'Empereur en Occident reprenant la titulature de « Roi des Romains ».
Sous cet empereur, souverain du monde, les différents peuples et leurs princes étaient classés dans une stricte hiérarchie protocolaire allant des plus puissants aux simples vassaux.
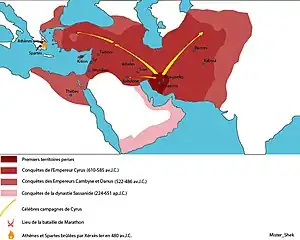
Il n’y avait qu’un seul État avec lequel Byzance traita pratiquement d’égal à égal : la Perse. Depuis la restauration sassanide du IIIe siècle, les deux États se considéraient comme les seuls « civilisés » face aux peuples barbares, ce qui les conduisit, en dépit de leurs luttes incessantes pour la possession des territoires à la frontière des deux empires, à collaborer pour faire face aux invasions des peuples venant d’Asie. Dans leur correspondance, les deux souverains se traitaient de frères et l’empereur sassanide fut le premier à se voir concéder le titre de basileus. Si bien que lorsque Chosroês II sera détrôné, il pourra trouver refuge auprès de l’empereur Maurice en 590 avant d’envahir l’empire en 604 pour venger la mort du même empereur assassiné par Phocas en 602[40] - [41].
Après la conquête de l’empire sassanide par les Arabes, ceux-ci héritèrent des mêmes honneurs, même si les rapports avec les Arabes ne seront jamais aussi étroits, les deux empires n’ayant pas d’ennemis communs contre lesquels se défendre. D’après le Livre des Cérémonies de Constantin VII, le nom du calife précédait celui de l’empereur dans la correspondance impériale, comme auparavant celui des Perses ; il était désigné comme διατάκτωρ (diataktōr – chef, modérateur), avait droit à trois épithètes d’honneur (μεγαλοπρεπέστατος, εύγενέστατος, περίϐλεπτος ) et la lettre était scellée d’une bulle d’or valant quatre nomismata[42]. Plus tard, les empereurs et les sultans mamlouks se traitèrent également de « frères » [N 3] et l’empereur recevait le titre de « Majesté impériale », alors que le sultan recevait celui de « Puissante Souveraineté »[41].
Venaient ensuite les Khazars dont les khans, alliés de l’empire depuis Héraclius et unis à la famille impériale par des alliances matrimoniales puisqu’une fille de Justinien II avait été fiancée en 705 à Tervel, le khan des Bulgares, alors que Constantin V avait épousé en 732 la princesse khazare Tzitzak/Irène. Dans la correspondance, ceux-ci étaient traités comme les princes chrétiens : invocation à la sainte Trinité en introduction, deux épithètes d’honneur (εύγενέστατος καί περιφανέστατος) et une bulle d’or d’une valeur de trois nomismata[43].
Les princes chrétiens recevaient des honneurs similaires, mais étaient traités de « frères spirituels » de l’empereur ; leur nom suivait celui de l’empereur dans la correspondance officielle et le titre qui leur était donné était celui de « roi » et non d’ « empereur »[N 4]. En représailles, les « empereurs » germaniques appelaient le souverain de Constantinople l’ « empereur des Grecs », ce qui constituait une injure laquelle ajoutée à d’autres mena à l’échec de l’ambassade de Liutprand en 968 lorsqu’il se rendit à Constantinople demander à l'Empereur Nicéphore II Phocas la main d'une princesse porphyrogénète pour le fils d'Otton Ier, le futur Otton II.
.svg.png.webp)
Situation similaire avec les Bulgares après leur conversion au christianisme. Élevé à Constantinople, Siméon (r. 893-927) qui rêvait de s’emparer du trône de Constantinople s’intitula « empereur des Bulgares et des Romains ». Ceci conduisit à une longue guerre à partir de 914 ; mais même si la Bulgarie sembla près d’en arriver à ses fins, Constantinople traita toujours Siméon de « Notre cher fils spirituel, par la grâce de Dieu, archonte du peuple très chrétien des Bulgares »[44]. Ce ne fut qu’en 927 que le gouvernement de Constantinople accepta de donner au fils et successeur de Siméon, Pierre, le titre de « basileus des Bulgares », mais en revanche l’empereur ajouta à son propre titre celui d’autocrate (Βασιλεὺς αὐτοκράτωρ τῶν Ῥωμαίων)[45].
Les princes serbes adopteront ce titre d’ « autocrate » sous Stefan Ier Nemanjić (grand-duc de Serbie : 1196 – 1217 ; autocrate de Serbie : 1217 – 1228). Toutefois, pour mettre fin à la longue guerre qui l’opposa à Byzance, Stefan II Uros (r. 1282 – 1321) accepta, après avoir épousé la fille d’Andronic II, le titre de sébastocrate qui en faisait le vassal de l’empereur[46]. Par la suite, Étienne Dušan (roi de Serbie de 1331 à 1346 ; « empereur des Serbes et des Romains » de 1346 à 1355) reviendra à la politique de confrontation en prenant, à l’instar de Siméon de Bulgarie, le titre d’ « empereur des Serbes et des Romains »[47].
Le cas de la Russie et de la Hongrie

Assez curieusement, et en dépit du fait que la Russie ait été, tout au long de son histoire, l’un des plus fidèles défenseurs de l’orthodoxie, elle occupait dans la diplomatie byzantine un rang fort modeste.
Il est vrai que les relations entre les deux pays avaient mal commencé, les Rus' ayant attaqué Constantinople dès 860. Les hostilités reprirent entre 907 et 911 alors que le prince Oleg conduisit une expédition contre Byzance. Au terme du traité qui suivit, les Rus' obtinrent le droit d’entrer dans l’armée « au moment où ils choisiront de venir, et en nombre qu’il leur plaira[48]. ». Ce traité devait être renouvelé en 945 après une autre attaque des Rus' contre Constantinople sous la direction d’Igor ; dans ce nouveau traité, l’empire et la principauté de Kiev étaient déclarés alliés à perpétuité et promettaient de se prêter main-forte contre d’éventuelles puissances ennemies[49]. En vertu de ce traité, des Varègues purent intégrer légalement l’armée byzantine. Ainsi devenus alliés et garants du maintien de la paix dans les steppes situées au nord du Pont-Euxin, les princes de la Russie de Kiev virent leur statut confirmé par la réception solennelle que l'empereur Constantin VII Porphyrogénète offrit en 957, dans le Grand Palais de Constantinople, à la veuve du prince Igor, la princesse-régente Olga[50].
Tel que mentionné plus haut, ce fut sous le règne de Vladimir Ier (r. 980 - 1015) que s’opéra la christianisation de la Russie de Kiev et son entrée dans la communauté des États chrétiens, donc dans l'oikoumène byzantine. Vladimir fit alors le voyage à Constantinople en 988 conditionnant son intervention contre l'usurpateur Bardas Sklèros à l'octroi de la main de la princesse Anne, sœur des empereurs byzantins Basile II et Constantin VIII. Après quoi, Vladimir Ier retourna sur ses terres où il convertit la principauté de Kiev au christianisme orthodoxe byzantin[51]. Ce mariage entre une princesse impériale et un prince étranger était à l'époque rarissime et témoignait de l’impasse dans laquelle se trouvait Basile. À partir de 989 et de la défaite de Bardas Phocas, les Varègues remplacèrent le régiment des Excubites comme garde personnelle de l’empereur et accompagnèrent celui-ci dans toutes ses campagnes jusqu’à ce que la garde soit annihilée à la bataille de Manzikert en 1071 et remplacée par des Anglo-saxons[52].
Mais en dépit du fait que la Russie de Kiev s’affirmait progressivement comme État indépendant, transférant successivement sa capitale de Kiev à Vladimir, puis à Moscou, Byzance continua à adopter à son égard un ton paternaliste et le métropolite de Russie continua à être nommé par Constantinople. Aussi, les relations entre les deux empires passèrent par des hauts et des bas et en 1043 Iaroslav Ier (r. 1016 – 1018 ; 1019 - 1024 et 1024 -1054) enverra son fils unique Vladimir conduire une attaque contre Constantinople qui tourna au désastre. Psellos considéra cette attaque comme une rébellion (έπανάστασις)[53], ce qui semble bien montrer que les Byzantins considéraient encore le nouvel État comme lui devant obéissance. Lors du schisme de 1054 la Russie demeura fidèle au rite byzantin, reflet de ses liens étroits avec Constantinople, qui dominait encore la mer Noire et donc le commerce empruntant la route commerciale du Dniepr. L’attitude paternaliste de Constantinople alors que la puissance de l’Empire byzantin allait en décroissant et celle de Moscou en s’affirmant commença à agacer sérieusement les tsars russes, si bien que lorsque Manuel II demanda l’aide de Moscou en 1398, celui-ci déjà pleinement occupé par des problèmes intérieurs répondit par la négative, ce qui lui attira la réprimande du patriarche de Moscou, Antoine, mentionnée plus haut. Les relations entre Moscou et le patriarcat de Constantinople se détériora également lorsque le patriarche Isodore (métropolite de Moscou 1437 – 1441 ; métropolite de Kiev et toute la Russie 1437 - 1458), qui avait accepté l’Union des Églises lors du Concile de Ferrare-Florence en 1441, promulgua l'Union devant le Grand Prince de Moscou Basile II et sa cour. Quatre jours plus tard, Basile, craignant de perdre le contrôle de l'Église et désireux d'exclure les influences étrangères de son pays, fit arrêter Isidore lequel parvint à s’enfuir et à se réfugier à Rome. Il sera par la suite légat du pape Nicolas V à Constantinople (1452-1453).

Le cas de la Hongrie est sensiblement différent, ce pays ayant au début de son histoire penché en faveur du catholicisme romain et échappant de ce fait au réseau d’états unis à l’empereur par leur foi orthodoxe.
L’installation des Magyars ou Hongrois dans le bassin des Carpates au cours du IXe siècle marqua la fin des grandes migrations asiatiques vers cette région de l’Europe[54]. En même temps toutefois elle coupait la culture byzantine diffusée par les frères Cyrille et Méthode de leur centre de rayonnement, Constantinople[55].
Entre 934 et 961, les Magyars ravagèrent la Thrace et la Macédoine atteignant à deux reprises les murs de Constantinople[56]. Une trêve fut conclue pendant le court règne de Constantin VII lorsque l’un des chefs de clan, Bulcsu, arrière-petit-fils du roi Árpád (r. 896 - 907) fut invité à Constantinople, reçut le baptême, l’empereur lui servant de parrain et repartit, chargé de présents avec le titre de patricius[57]. Cette conversion devait toutefois être de courte durée. Sitôt de retour chez lui, il renonça à sa nouvelle foi orthodoxe, partit en guerre contre l’empire et ravagea une partie de l’Allemagne avant d’être capturé et exécuté à Ratisbonne[58] - [59].
Le même scénario devait se dérouler en 952 avec plus de succès toutefois lors de la visite du prince Gyula qui reçut également le baptême, le titre de patricius, mais repartit avec un moine, Hyérotheus, qui devint « episkopos Turkias », nom que les Byzantins donnaient alors aux Hongrois. Les premiers efforts de christianisation de la Hongrie furent donc le fait de Byzance. Toutefois les territoires à l’ouest de la rivière Tisza étaient la chasse-gardée du clergé franc de Passau. En 970, un missionnaire franc baptisa le prince Géza et son fils qui deviendra saint Étienne (r. 1001-1038). Ce dernier fit pencher la balance en faveur de l’Occident et de la papauté, recevant la couronne royale du pape Sylvestre II en 1000[60]. Les Byzantins répliquèrent en envoyant une première couronne, dite couronne de Constantin Monomaque au roi André Ier (r. 1046-1060), puis une deuxième, dite sainte Couronne de Hongrie, envoyée par Michel VII Doukas (r. 1071-1078) au roi Géza Ier (r. 1074-1077) à l’occasion de son avènement[61].
Même si la Hongrie s’était prononcée en faveur de l’Occident, les relations continuèrent à être étroites entre les deux pays et Étienne conclut une entente avec Basile II contre la Bulgarie, aidant les Byzantins en 1004 à s’emparer de Skopje. Plusieurs des églises construites par ce roi sont nettement d’inspiration byzantine[62] - [63].
Au cours du XIIe siècle les relations devinrent encore plus étroites par le mariage en 1104 de Piroska (qui prit à cette occasion le prénom d’Irène), fille du roi Ladislas Ier à Jean II Comnène (r. 1118-1143), fils de l’empereur Alexis. De leur union naquirent huit enfants dont le futur empereur Manuel Ier (r. 1143-1180). Mais si étroites qu’elles étaient, ces relations étaient pour le moins chaotiques, le gouvernement byzantin ne cessant d’intervenir dans les affaires de la Hongrie et donnant refuge à des membres dissidents de la famille Árpád[64]. La Hongrie pour sa part, désireuse de s’étendre vers l’Adriatique, conquit au début du XIIe siècle la Croatie et la Dalmatie[65]. Et si la Hongrie envoya à diverses reprises des troupes auxiliaires seconder celles de Byzance, Manuel n’envahit pas moins de dix fois la Hongrie au cours d’un règne de trente-sept ans. Manuel rêvait en effet de réunifier l’empire de Justinien, se heurtant en cela au Saint-Empire de Frédéric Barberousse. La Hongrie étant située entre les deux empires pouvait servir de base à ce rêve et Manuel aurait voulu incorporer ce royaume dans son empire. Il vint prêt de réussir en 1167 lorsqu’après une bataille près de Belgrade la Hongrie dut céder des villes importantes à l’empire et reconnaitre la suzeraineté de Byzance, Manuel prenant par la suite le titre de « Oungrikos »[66].
.svg.png.webp)
Cette tension n’avait toutefois pas empêché le prince hongrois Béla III d’épouser en 1163 Marie, la fille de l’empereur. Il dut alors adopter la foi orthodoxe et prendre le prénom de l’empereur Alexis en contrepartie de quoi il reçut le titre de « despote » et fut fait héritier présomptif par l’empereur Manuel. Toutefois, lorsque l’empereur eut un fils en 1169, Béla perdit son titre d’héritier et dut retourner en Hongrie où il devint roi (r. 1172-1196). Avant de quitter la capitale, il jura fidélité à l’empereur et lors de la bataille de Myriokephalon où les Byzantins furent mis en déroute par les troupes seldjoukides, des troupes hongroises combattaient aux côtés de celles de Constantinople[67].
Les plans d’union entre la Hongrie et l’empire refirent surface lorsqu’en 1182 Andronic Comnène s’empara du trône et fit périr la plupart des membres de la famille de Manuel. Allié aux Serbes, Béla prit les armes contre l’usurpateur et s’empara de Niš, Belgrade et Sofia[68]. Parvenu en vue de Constantinople, il revendiqua alors le trône impérial conformément aux dispositions originelles de l’empereur Manuel et exigeant après la mort de sa femme, la main de la sœur de Manuel, Théodora. Encore une fois un évènement imprévu vint déjouer ses plans et en 1185 Andronic fut renversé lors d’une révolte populaire à la suite de laquelle Isaac II Ange fut porté au trône. Se résignant à reconnaitre la réalité, il maria sa fille à l’empereur Isaac. Sous son règne, la monnaie byzantine eut cours légal dans son royaume et la croix à double branche impériale fut introduite dans les armoiries de Hongrie. Cependant la Hongrie glissait de plus en plus dans le camp occidental et en 1186, Béla épousa Marguerite Capet, fille de Louis VII de France. La mort de Béla III en 1196 marque en quelque sorte la fin de la relation entre ce pays et l’empire byzantin, même si après la restauration de l’empire, Michel VIII fera alliance avec la Hongrie contre Charles d’Anjou par le mariage de son fils et héritier Andronic avec la fille du roi de Hongrie, Étienne V[69] - [70].
Rapport avec les autres États
Quant aux autres peuples, regroupés sous le terme collectif de τά ӗθνη, Byzance chercha à s’en faire des alliés, soit pour la défense de son territoire, soit pour lui fournir des soldats pour son armée, ou pour développer son commerce extérieur[2]. Ainsi, les chrysobulles spécifiant les obligations de chaque partie pouvaient varier selon les circonstances et les buts recherchés. Un traité signé avec Kourgouyah, émir d’Alep en 969 à la suite de sa capitulation, par exemple, spécifiait les frontières de la principauté, la nomination de l’émir par le basileus lorsque le présent émir mourrait, le droit du suzerain de traverser la principauté aux frais des habitants, etc. Avec les républiques italiennes, ces traités prévoyaient des concessions tarifaires en matière de commerce sur le territoire de l’empire, l’établissement de quartiers réservés pour leurs citoyens et même la jouissance de leurs propres tribunaux sur ces territoires. Dans le cas des croisés, les textes seront établis selon le droit féodal établi en Occident : aux termes du traité passé avec Bohémond, celui-ci se reconnaissait homme-lige de l’empereur, s’engageait à respecter les terres de l’empire, à ne rien entreprendre contre l’empereur et son fils, etc.[71].
Ceci n'impliquait pas toujours la force ou la fin d'une guerre. Nombreux étaient les peuples qui aspiraient à partager la richesse et la prospérité de la « Reine des villes » et offraient en retour de devenir « les chiens de garde de l’empire[72] ».
Trois périodes furent particulièrement actives dans la création d’une chaine d’États vassaux aux frontières de l’empire : celle de Justinien et de ses successeurs immédiats, celle des guerres mettant aux prises l’empire et les Arabes d’une part, les Slaves d’autre part et celle des Comnène[73].
L’appareil diplomatique byzantin
L’appareil bureaucratique à Constantinople
Reflétant cette conception monolithique de l’empire, il n’existait pas à Constantinople d’organisme s’occupant exclusivement des « affaires étrangères » comme ce serait le cas aujourd’hui.
Du Ve siècle au VIIIe siècle, les relations extérieures étaient dirigées par le magister officiorum qui coiffait trois bureaux spécialisés dont le travail comprenait indifféremment les affaires internes et étrangères : le scrinium epistularum, responsable des lettres, édits ou rescrits impériaux ; l’officium adminisionum qui organisait les audiences impériales et était responsable du service des interprètes ; le cursus publicus ou poste impériale qu’utilisaient les agents envoyés en mission.
Après le VIIIe siècle le bureau du magister officorum fut démembré et ses responsabilités partagées. Vers 740 fut créé le logothète du drome, maitre du service des postes dirigeant l’envoi des ambassadeurs à l’étranger et responsable du corps des interprètes. La réception des ambassadeurs étrangers sera la responsabilité du maitre des cérémonies (ό έπί τής καταστάσεως), véritable chef du protocole, successeur du comes adminisionum.
À partir du IXe siècle, le logothète du drome cumulera les fonctions de ce qui serait aujourd’hui le ministre de l’Intérieur, le ministre des Postes et le ministre des Affaires étrangères[74].
Dans chacun de ces bureaux, on recueillait soigneusement les renseignements en provenance des ambassadeurs, des voyageurs, des marchands et des missionnaires, permettant de connaitre ces peuples, leurs forces et leurs faiblesses, les moyens à utiliser pour s’en faire des alliés en temps de guerre et les neutraliser en cas de guerre, quels présents étaient les plus susceptibles de les amadouer et quelles relations politiques, militaires et économiques il convenait d’établir avec eux[75]. Le De Administrando de Constantin Porphyrogénète constitue un manuel sur la façon de traiter ces peuples avec des chapitres comme : « Les Petchenègues : comment en paix ils peuvent être utiles à l’empereur des Romains » (chap. 1), « Comment envoyer des délégués impériaux de Kherson en pays petchenègue » (chap. 7), « Comment et par qui doit être faite la guerre contre les Khasars » (chap. 10), « Le thème de Lombardie, ses principautés et les princes » (chap. 27), « La généalogie du peuple turc (Hongrois) et d’où ils viennent » (chap. 38), etc.
Les ambassades byzantines à l’étranger
Les diplomates de carrière n’existant pas encore à l’époque, les personnes envoyées en ambassade étaient choisies principalement en fonction de la nature et du prestige que l’on voulait donner à cette mission. Ainsi les ambassadeurs envoyés en Perse au VIe siècle appartenaient presque toujours aux plus hauts degrés de la hiérarchie (Préfet de la Ville, Magister militum, Comes Largitionum, etc.)[76]. Par contre, Constantin V n’envoya au pape et au roi lombard Astolphe qu’un silentiaire, dignitaire palatin subalterne, car sa mission consistait plus à transmettre un ordre qu’à négocier[77].
Mais quelle que soit la nature de la mission, le choix était fait soigneusement et l’ambassadeur retenu devait être « un homme honnête, pieux, incorruptible et disposé comme Régulus à se sacrifier pour la patrie[78]. Ils emmenaient avec eux une suite incluant des interprètes, des natifs de la région visitée lorsque celle-ci était peu connue et apportaient dans leurs bagages des cadeaux choisis en fonction des gouts et aspirations des destinataires et destinés à impressionner ceux-ci par la richesse et la supériorité technique de Byzance (Par exemple, l’orgue offert par une ambassade envoyée par Constantin V auprès de Pépin le Bref en 757)[79].
Ces ambassades pouvaient avoir des objectifs très variés : signature d’un traité à caractère militaire, notification d’un évènement, négociation d’un traité commercial, et même mission de simple information répondant à des peuples lointains, mal connus, mais qui avaient sollicité l’alliance de Byzance (ambassade de Justinien chez le Négus d’Éthiopie en 529)[80].
Les ambassades étrangères à Constantinople

De la même façon, l’accueil des ambassades étrangères avait pour but d’impressionner les ambassadeurs, de leur faire sentir la puissance et la richesse de Byzance, tout en évitant de laisser les envoyés surprendre des secrets d’État ou se livrer à l’espionnage.
Accueillie officiellement dès qu’elle passait la frontière, l’ambassade étrangère était prise en charge immédiatement par l’État byzantin et escortée jusqu’à Constantinople. Son séjour dans la capitale, qui dans certains cas pouvait durer plusieurs années, était organisé par le « bureau des barbares » (Ό βάρϐαρος) qui existait déjà au VIe siècle et qui se perpétua jusqu’au Xe siècle, sorte de service de renseignements sur les mœurs, habitudes, forces et faiblesses de chaque État[81].
Le moment le plus important de toute ambassade était celui de l’audience solennelle auprès de l’empereur. Le récit de Liutprand de Crémone envoyé par Béranger auprès de Constantin VII en 949 est resté célèbre. Émerveillé, l’ambassadeur décrit l’arbre de cuivre doré dans les branches duquel des oiseaux gazouillaient, les lions d’or rugissant de part et d’autre du trône impérial, et la machinerie par laquelle le trône s’élevait dans les airs pour disparaitre aux regards, puis redescendait après que l’empereur eût changé de vêtements[82].
Mais autant Constantinople pouvait réserver un accueil splendide aux ambassadeurs venant en amis, autant elle pouvait se révéler acrimonieuse lorsque les émissaires lui déplaisaient. Liutprand lui-même en fit l’expérience lorsqu’il retourna à Constantinople en 968 demander à l'empereur Nicéphore II Phocas la main d'une princesse porphyrogénète pour le fils d'Otton Ier. Non seulement cette requête parut d’une audace insolente (voir plus haut), mais l’ambassadeur se montra tellement discourtois pendant son séjour[83]qu’on lui fit subir mille avanies sur le chemin du retour[84].
En même temps, les escortes qu’on leur donnait à partir de la frontière n’avaient pas seulement pour but d’honorer les visiteurs; elles les empêchaient d’observer de trop près ce que les Byzantins ne voulaient pas qu’ils voient en chemin. À Constantinople même, ils logeaient dans un palais où ils étaient étroitement surveillés et ils étaient accompagnés dans tous leurs déplacements à travers la ville où les endroits qu’on choisissait de leur montrer devaient les impressionner soit par la splendeur des édifices, soit par la puissance des armées, tout en leur cachant ce qui était considéré comme des secrets militaires, tel le feu grégeois, ce que recommandait Constantin Porphyrogénète à son fils : « Tu dois par-dessus toutes choses porter tes soins et ton attention sur le feu grégeois […]; si on ose te le demander, comme on l’a fait souvent nous-même, tu dois repousser et rejeter cette prière en répondant que ce feu a été montré et révélé par un ange au grand et saint premier empereur, Constantin. »[85] - [86].
Succès et échecs de la diplomatie byzantine
Si l’on considère le nombre d’ennemis auxquels Byzance dut faire face au cours des siècles sur l’ensemble de ses frontières, alors qu’elle ne possédait elle-même que des moyens militaires limités et dut fréquemment recourir à des mercenaires étrangers, lesquels à une époque composaient la majeure partie de son armée, on comprend qu’elle chercha par tous les moyens à éviter les conflits militaires qu’elle n’aurait pu que perdre à long terme. Sur ce plan, elle connut des succès remarquables[87]. En tissant un réseau d’alliances avec les peuples qui l’entouraient conformément à la vision qu’elle se faisait de l’oikoumène, elle assura non seulement sa propre sécurité, mais elle exerça sur eux une influence civilisatrice qui dans bien des cas, comme chez ses voisins immédiats Serbes et Bulgares, ou plus lointains, Rus’, permit à ceux-ci de développer leur propre civilisation.
Cette politique comportait toutefois un danger inhérent : en faisant trop ouvertement sentir sa propre supériorité, en déployant trop ostentatoirement les signes de sa richesse, non seulement elle froissa au cours des siècles bon nombre de susceptibilités mais elle attisa l’envie de ces mêmes peuples lesquels, une fois qu’ils auront acquis un degré de civilisation et de capacité militaire égal ou supérieur au sien, lui feront payer cher son orgueilleuse hauteur[88].
Bibliographie
Sources primaires
- Acta et diplomatica graecae medii aevi, (Colligés par Micklosich et Müller), VI vol. Vienne1860-1890.
- Anne Comnène. Alexiade. [en ligne] remacle.org
- Chronique de Nestor (ou Chronique des temps passés). D’après le manuscrit de Koenigsberg, texte établi par Louis Paris, Paris, Heidelhof et Campé, 1854 [en ligne] http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3D0nJEAAAAIAAJ%26dq%3DLa%2520chronique%2520de%2520Nestor%26pg%3DPP11%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse.
- Constantin Porphyrogénète. Le Livre des Cérémonies. Paris, Belles-Lettres, 1935, 1967.
- Grégoire de Tours. Histoire des Francs. Paris, Gallimard, 1990. (ISBN 2-07-071793-3).
- Liutprand de Crémone. Relatio de Legatione Constantinopolitana, xv, ed. J. Bekker, Scriptores Rerum Germanicum in usum scholarum. Diverses éditions dont Hannover : Hahnsche Buchhandlung.
- Patrologia graeca. Textes rassemblés par Jean-Paul Migne. [en ligne] https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/migne-patrologia-graeca-volumes.asp.
- Photius (patriarche de Constantinople). Laourdas, B. et L.G. Westerinck (éds.). Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia. Vol. I, Leipzig, 1983.
- Procope de Césarée. La Guerre contre les Vandales, Paris, Les Belles Lettres, coll. « La Roue à Livres », 1990 (ISBN 978-2-2513-3905-4).
- Psellos, Chronographie. Paris, Les Belles Lettres, 1967.
- Scylitzès, Jean. Synopsis Historiarum, Bonn, Bekker, 1839.
Sources secondaires
- (en) Antonucci, Michael. “War by Other Means: The Legacy of Byzantium.” (dans) History Today 43.(2), .
- (fr) Arrignon, Jean-Pierre Byzance, Économie et société VII e- XII e s., Paris, Ellipses, coll. « Le monde : une histoire », 2007 (ISBN 978-2-729-83012-0).
- (fr) Benda, Kálmán & alii. Mille ans d’histoire hongroise. Budapest, Éditions Corvina, 1986.
- (fr) Bréhier, Louis. Les Institutions byzantines. Paris, Albin Michel, coll. « L'évolution de l'humanité », 1970.
- (fr) Bréhier, Louis. Vie et mort de Byzance. Paris, Albin Michel, coll. « L’évolution de l’humanité », 1946 et 1969.
- (fr) Canal, Demis-Armand & Steven Runciman. Histoire des croisades [History of the Crusades], Éd. Dagorno, 1998. (ISBN 2-910019-45-4).
- (fr) Cheynet, Jean-Claude. Le Monde byzantin, tome II : L'Empire byzantin (641-1204), PUF, coll. « Nouvelle Clio », 2007. (ISBN 978-2-130-52007-8).
- (en) Chrysos, Evangelos. “Byzantine Diplomacy, A.D. 300–800: Means and End.” (dans) Jonathan Shepard, Simon Franklin: Byzantine Diplomacy: Papers from the Twenty-Fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge, March 1990 (Society for the Promotion of Byzantine Studies). Aldershot, Hampshire: Variorum, 1992 (ISBN 0-86078-338-3).
- (fr) Diehl, Charles. Byzance, Grandeur et décadence. Paris, Flammarion, 1920. Réédité sans date: Nabu Public Domain Reprint. (ISBN 978-1-174-81720-5).
- (de) Dölger, Franz (ed.). Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565–1453. 1. Teil: Regesten von 565–1025. München/Berlin 1924.
- (fr) Ducellier, Alain (dir.), Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Armand Colin, "U", 2e édition, 1996. (ISBN 2200346999).
- (fr) Ducellier, Alain. Les Byzantins, Paris, Le Seuil, collection « Points histoire », 1963. (ISBN 2020099195).
- (fr) Ducellier, Alain et Michel Kaplan. Byzance IVe siècle-XVe siècle, Paris, Hachette Supérieur, coll. « Les Fondamentaux / Histoire », 2004 (ISBN 2011455774).
- (en) Haldon, John F. Warfare, state and society in the Byzantine world, 565-1204, Routledge, 1999 (ISBN 1-85728-494-1).
- (fr) Heller, Michel. Histoire de la Russie et de son empire. Paris, Plon (1997) et Flammarion (1999). (ISBN 978-2-0812-3533-5).
- (en) Herrin, Judith. Byzantium, The Surprising Life of a Medieval Empire. Princeton, Princeton University Press, 2007. (ISBN 978-0-691-14369-9).
- (en) Laiou, Angeliki E. “Writing the Economic History of Byzantium” (dans) The Economic History of Byzantium (Volume 1). Dumbarton Oaks, 2002.
- (fr) Laurent, Joseph. Byzance et les Turcs seldjoukides dans l’Asie occidentale jusqu’en 1081. Nancy, 1919.
- (en) Lee, A.D. Information and Frontiers: Roman Foreign Relations in Late Antiquity. Cambridge 1993. (ISBN 978-0-521-02825-7).
- (fr) Mìrčuk, Ìvan. L'Ukraine dans le cadre de l'Est européen, Éditions Nauwelaerts, 1957.
- (en) Neumann, Iver B. "Sublime Diplomacy: Byzantine, Early Modern, Contemporary" (PDF). Millennium: Journal of International Studies. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'. 34 (3), 2004. pp. 865–888 [en ligne] http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03058298060340030201.
- (en) Norwich, John Julius. Byzantium, the Early Centuries. New York, Alfred A. Knopf, 1989. (ISBN 0-394-53778-5).
- (en) Obolensky, Dimitri. Byzantium and the Slavs. Chap. 1 : “The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy”, St Vladimir’s Seminary Press, 1994, (ISBN 0-88141-008-X).
- (en) Obolensky, Dimitri. The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe 500-1453. London, Phoenix Press, 1971. (ISBN 978-1-842-12019-4).
- (fr) Ostrogorsky, Georges (trad. J. Gouillard). Histoire de l’État byzantin, Payot, 1983. (ISBN 2228070610).
- (en) Shepard, Jonathan & Simon Franklin (ed.). Byzantine Diplomacy. Papers from the twenty-Fourth Spring Symposium of Byzantine Studies (March 1990). Cambridge, Society for the Promotion of Byzantine Studies. Aldershot, Hampshire: Variorum, 1992.
- (en) Sicker, Martin. The Islamic World in Ascendancy: From the Arab Conquests to the Siege of Vienna. Greenwood Publishing Group, 2000. (ISBN 0-275-96892-8).
Notes et références
Notes
- Ce terme désigne les Scandinaves selon certains auteurs, les Slaves selon d'autres utilisant la route fluviale entre la Russie de Kiev et Constantinople soit pour piller, soit pour faire commerce
- Son baptême est reporté différemment par deux traditions : dans la première, Vladimir, régnant à Kiev, fait appeler à lui les représentants des principales religions connues (ou envoie ses émissaires): le christianisme de Rome, le christianisme byzantin, le judaïsme et l'islam. Il opta pour l'orthodoxie et fit baptiser son peuple (rapportée par la Chronique de Nestor) ; dans la deuxième, il demanda le baptême à Cherson en Crimée en échange de la remise de la ville, de la main d’une princesse byzantine et de la guérison de ses yeux(Interprétation, plus politique, issue d’un pamphlet grec du XIe siècle pour empêcher la canonisation de Vladimir)
- Andronic II aura même des scrupules à accorder cette épithète à un infidèle (Pachymère, Histoire, III, 23)
- Si Charlemagne reçut exceptionnellement le titre de basileus en 812, Constantinople revint douze ans plus tard aux usages traditionnels en donnant à Louis le Pieux le titre de « Glorieux roi des Francs et des Lombards, et appelé leur empereur »(Cité par Bréhier (1970) p. 232)
Références
- Diehl (sans date) p. 54
- Bréhier (1970) p. 233
- Diehl (1920) pp. 53-54
- Sicker (2000) p. 132
- Obolensky (1994) p. 13
- Constantin VII Porphyrogénète, De Administrando Imperio, Préface, para 2
- Cité par Obolensky (1994) p. 11
- Obolensky (1971) p. 11
- Bréhier (1970) p. 238
- Cedrenus, Cedrenus Scylitzae Ope II, 444; Psellos, Chronographie, I, 9; Zonaras, Annales, III, 533
- Cité par Bréhier (1970) p. 239
- Laurent (1919) p. 38
- Constantin Porphyrogénète, De Ceremoniis, I, 654
- Bréhier (1970) p. 230
- Obolensky (1994) p. 17
- Grégoire de Tours, Histoire des Francs .II, 38
- Anne Comnène, Alexiade, VI, 5.
- Anne Comnène, Alexiade XI, 9, X, 11 ; Constantin Porphyrogénète, De Administrando Imperio, 7 sq.
- Obolensky (1994) p. 14
- Obolensky (1994) p. 18
- Miklosich et Müller, II, 191 (a.1393)
- Constantin Porphyrogénète, De Administrando Imperio, chap. I, « Les Petchenègues ; comment en paix, ils peuvent être utiles à l'empereur des Romains »
- Constantin Porphyrogénète, De Administrando Imperio, chap. IV, « Les Petchenègues, les Russes et les Turcs ».
- Obolensky (1994) p. 15
- Norwich (1989) p. 271
- Obolensky (1994) p. 160
- Constantin VII, De Administrando Imperio, chap. VIII, « Turcs »
- Liutprand, Relatio de Legatione Constantinopolitana, p. 184
- Obolensky (1971) p. 196
- Canal et Runciman (1998) p. 320
- Obolensky (1994) pp. 15-18
- Cité par Obolensky (1994) p. 17
- Ostrogorsky (1983) pp. 256-258
- Photius, lettre.2.293-302
- Constantin Porphyrogénète, De Ceremoniis, ii, 15
- Chronique de Nestor, Chap. VIII, « Vladimir », p. 130 -133
- Obolensky (1971) pp. 192-197
- Obolensky (1971) p. 2
- Kazhdan (1991) « Basileus », vol. 1, p. 264
- Kazhdan (1991) « Chosroes II », vol. II, p. 432
- Bréhier (1970) p. 231
- Constantin VII Porphyrogénète, De Ceremoniis, II, 48
- Constantin VII Porphyrogénète, De Ceremonis, II, 48
- Constantin VII, De Ceremoniis, II, 48
- Ostrogorsky (1983) pp. 292-293
- Ostrogorsky (1983) pp. 511-512
- Bréhier (1970) p. 232
- Chronique de Nestor, I, col. 33
- Chronique de Nestor, I, col. 46-54
- Constantin VII Porphyrogénète, De Ceremoniis, ii. 15.
- Mìrčuk (1957) p. 113
- Blöndal (1978) p. 45, 110-111
- Bréhier 1969) p. 211 - Psellos, Chronographie, VI, 86 (II,8)
- Benda (1986) p. 27
- Obolensky (1971) p. 153
- Obolensky (1971) p. 154
- Scylitzès, ii. p. 328
- Obolensky (1994) p. 155
- Ostrogorsky (1983) p. 308
- Obolensky (1994) pp. 156-157
- Obolensky (1994) pp. 159-160
- Obolensky (1994) p. 158
- Ostrogorsky (1983) p. 356
- Ostrogorsky (1983) p. 399
- Ostrogorsky (1983) p. 387
- Obolensky (1994) pp. 160-161
- Obolensky (1994) p. 162
- Ostrogrosky (1983) p. 421-422
- Obolensky (1994) p. 163
- Ostrogorsky (1983) p. 481
- Bréhier (1970) pp. 238-239
- Procope de Césarée, Guerre contre les Vandales, IV, 19, Lettre de Sandil roi des Huns à Justinien
- Bréhier (1970) p. 234
- Bréhier (1970) pp. 244-245
- Diehl (1920) p. 54
- Ménandre le Protecteur, Histoire, fragments, fr. 43, 244 et sq (Ambassade de Pierre Le Patrice à Bagdad en 562)
- Bréhier (1970) p. 247
- Excerpta legationum, éd. Dindorf, Patrologia Cursus completus, série graeco-latina, CXIII
- Bréhier (1970) p. 248
- Bréhier (1970) p. 249
- Mentionné par Philothée dans le Cletorologion, 145, 3
- Constantin VII Porphyrogénète, De Ceremoniis, II, 47, 1256
- Bréhier (1970) p. 252
- Herrin (2007) p. 177-179
- Constantin VII Porphyrogénète, De Administrando Imperio, chap. 8 « Turcs »
- Bréhier (1970) p. 251
- Kurbalija (2013)
- Diehl pp. 62-66
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (en) Kurbalija, Jovan. What can we learn from Byzantine diplomacy? (dans) Diplo, . [en ligne] https://www.diplomacy.edu/blog/what-can-we-learn-byzantine-diplomacy.
- (en) Neumann, Iver B. Sublime Diplomacy : Byzantine, Early Modern, Contemporary. (dans) Netherland Institute of International Relations “Clingendael”. [en ligne] https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20051200_cli_paper_dip_issue102.pdf.