Langue des signes
Les langues des signes sont les langues visuo-gestuelles (produites par les mouvements des mains, du visage et du corps dans son ensemble) qui ont émergé au contact des personnes sourdes entre elles et dont l'évolution au cours du temps résulte de la pratique de leurs locuteurs. Elles assurent toutes les fonctions remplies par les langues vocales.
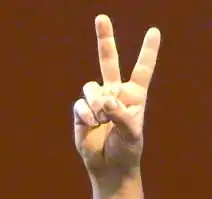
Statut naturel des langues des signes
Les langues des signes sont des langues naturelles, qui, au même titre que les langues vocales, ont émergé et évolué spontanément au cours du temps par la pratique de leurs locuteurs, sans planification ni prescription consciente ou explicite. Il importe en ce sens de les distinguer du langage parlé complété (LPC) et du français signé, modes de communication créés artificiellement par certains courants pédagogiques.
Des recherches linguistiques récentes[1] - [2] menées sur deux langues des signes apparues récemment en Palestine confirment l'émergence autonome des langues des signes et, partant, leur dimension naturelle : la langue des signes ^palestinienne, résultant du contact de différentes langues des signes apportées par la migration qu'a connue le pays au cours du XXe siècle, et la langue des signes bédouine d'Al-Sayyid, apparue spontanément au sein d'une communauté autonome de bédouins comptant de nombreuses personnes sourdes et installée depuis 200 ans dans la région du Néguev. Ces recherches se sont ainsi penchées sur l'évolution de leur grammaire au cours des générations. Elles ont décrit l'apparition, en trois générations, d'une des caractéristiques centrales et propres à la grammaire de toutes les langues des signes : l'usage iconique de l'espace, notamment pour les verbes de déplacement et la plupart des verbes transitifs. Une telle évolution linguistique, à savoir l'apparition d'une caractéristique grammaticale absente des langues vocales environnantes, atteste l'autonomie de ces deux langues et, partant, de leur statut de langue naturelle à part entière.
Le caractère naturel des langues des signes est également attesté par des recherches historiques portant sur l'éducation des enfants sourds en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle. S'il est difficile, faute de traces et documentations écrites, de remonter aux origines des langues des signes au-delà de cette période[3], l'étude de la scolarisation des enfants sourds a apporté la preuve que c'est premièrement le regroupement des enfants en institutions séparées qui a contribué à l'émergence des langues signées et a assuré leur transmission d'une génération à l'autre. En effet, l'éducation des enfants sourds a été marquée par des courants radicalement opposés à la langue des signes et à son usage pédagogique, notamment à la suite du Congrès de Milan de 1880, voire plus tôt déjà[4] - [5]. Or, même durant les périodes bannissant toute communication gestuelle, les langues des signes sont parvenues à se maintenir et à se diffuser parmi les enfants sourds. En regroupant les enfants sourds entre eux, les institutions à visée oraliste ont ainsi sans le vouloir contribué à la pratique des langues des signes en dehors de la classe et, partant, à leur transmission et diffusion[6].
Des recherches utilisant différentes méthodes de neuroimagerie ainsi qu'une méta-analyse récente ont montré que le langage des signes est traité dans des réseaux cérébraux qui chevauchent le traitement du langage parlé[7].
Histoire
Depuis le congrès de Milan de 1880, les méthodes orales ont été privilégiées dans l'éducation des enfants sourds, au détriment des langues visuelles. Dans les années 1960, le linguiste William Stokoe analyse la structure de la langue des signes américaine (American Sign Language, ASL) et met en évidence qu'elle possède les mêmes caractéristiques linguistiques structurelles que les langues parlées : une phonologie, une grammaire utilisant une syntaxe. Cette découverte apporte alors une légitimité aux langues des signes, qu'elles n'avaient pas auparavant. Les langues des signes entrent alors dans l'éducation des enfants sourds de certains pays. En 1980, la Suède décide ainsi que l'éducation des sourds doit être bilingue : la langue des signes est la première langue des enfants sourds, et le suédois est la langue seconde. Des pays de plus en plus nombreux suivent cet exemple[8] - [9].
Sémiologie
Si la langue des signes est enseignée et diffusée, elle est conçue en tant que « reproduction » d'une langue qu'elle visualise et gestualise. Il faut attendre William Stokoe[10] pour que la langue des signes soit observée comme une langue à part entière grâce à la description selon le principe de la double articulation qu'André Martinet[11] développe pour le langage humain en général et atteste pour la langue des signes dans l’introduction à l’Essai de grammaire de la langue des signes française de Nève de Mévergnies[12]. Ces descriptions, très souvent menées selon les critères d'analyse des langues orales, ont contribué à faire peu à peu reconnaître à ces langues leur statut de langues naturelles à part entière. Cependant du fait que les langues des signes utilisent une modalité visuo-gestuelle et non audio-orale, elles mettent en place des structures spécifiques, bien différentes de celles des langues orales et nécessitent donc une description circonstanciée.
Comme toute langue, une langue des signes nécessite un apprentissage mais il n'est pas nécessaire d'avoir une surdité pour apprendre ou communiquer en langue des signes. Par exemple de nombreux entendants (enfants de sourds, partenaires, ou interprètes et autres professionnels en contact avec des sourds) parviennent à développer un haut degré de bilinguisme. Selon le Ministère de la Culture[13], « les langues des signes sont pour les sourds, le seul mode linguistique véritablement approprié, qui leur permette un développement cognitif et psychologique d’une manière équivalente à ce qu’il en est d’une langue orale pour un entendant. »
On parle souvent quand on traite de la langue des signes d'une « pensée visuelle ». Elle remet en question ce que nous considérons habituellement comme appartenant au domaine de la linguistique. En effet, selon Christian Cuxac[14], dans une perspective sémiogénétique, le modèle de la langue des signes française propose une bifurcation de visée entre deux types de structures (fréquemment imbriquées dans le discours) :
- les structures dites standard ou « signes standard », au caractère conventionnel ;
- les structures de grande iconicité, à visée illustrative.
Code gestuel
Les signes standards sont conditionnés par la gestuelle de la ou des mains, de la tête et du visage, par l’orientation du signe, son emplacement et son mouvement, chaque paramètre correspondant à une liste finie d’éléments qui correspond au phonème de la langue orale. Le dénombrement des éléments par catégorie paramétrique varie selon les descriptions. Pour la seule gestuelle des mains, on en compte entre 45 et 60 différentes en langue des signes française. Ces éléments apparaissent simultanément et peuvent se combiner au sein d'un signe de même que les phonèmes se combinent au sein d'un mot.
Prosodie illustrative
Les structures de grande iconicité sont d'un emploi récurrent dans la conduite de récit. Elles sont extrêmement originales et particulières. L'étude poussée de ces structures[15] a permis de mettre en évidence différents types de transferts possibles dans un discours. Par exemple, le locuteur prend alors le rôle d’une personne ou encore, met en situation des formes[16]. Christian Cuxac l'explicite ainsi : « Toutes les langues permettent de reconstruire des expériences, selon des stratégies variées. (…) dans les cas d’ajouts gestuels (ex : un ballon « grand comme ça ») (…), le geste accompagne ou complète la parole, (…) le locuteur prend la voix des personnages dont il parle, pour raconter une histoire. On observe alors des phénomènes de prosodie tout à fait intéressants, lors de ces prises de rôle. Au contraire, les langues des signes donnent à voir constamment, à des degrés divers. La grande iconicité est donc l’activation, dans le domaine du discours, d’une visée illustrative (ou iconicisatrice), lorsque la dimension donnée à voir est présente. »
Espace-temps
Il faut également relever l'utilisation particulière de l'espace par la langue des signes. En effet, alors que les langues vocales utilisent de préférences des structures syntaxiques linéaires pour le marquage temporel ou encore les relations entre différents éléments de la phrase, la langue des signes utilise de préférences des structures syntaxiques spatiales : le temps peut par exemple se dérouler selon un axe arrière-avant dans l'espace du signeur ou encore selon un axe gauche-droite.
Marqueur pronominal
L'espace de signation (là où la personne signe) peut aussi servir à créer des repères, des marqueurs auxquels on se réfère tout au long du discours (par ex. un repère pour l'école, un pour la maison, un autre pour un personnage). Il suffit alors de pointer du doigt ou du regard l'endroit pour "l'activer" et y faire référence dans le discours. C'est en quelque sorte un usage spatial du pronom.
Comparaison des langues des signes

Les langues des signes (LS) ne sont pas universelles, malgré ce que l'on croit. Henri Wittmann (1991) a fourni une classification des langues des signes. Il existe en fait, tout comme pour le langage oral, autant de langues des signes que de communautés différentes de sourds, chaque langue des signes ayant son histoire, ses unités signifiantes et son lexique. Le développement d'une langue des signes dépend de la vivacité de la communauté des personnes qui la composent, comme pour une langue vocale. Les langues des signes sont indépendantes des langues orales pratiquées dans les mêmes régions ; par exemple, en France, le signe « Maman » est différent selon les régions voire selon les départements.
En dépit des différences entre les langues des signes du monde, la compréhension et la communication est rapidement possible entre deux personnes maîtrisant des langues des signes différentes. Cela pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs : proximité des structures syntaxiques employées d'une langue des signes à une autre, ou encore existence pour certains mots de liens naturels entre signifiant et signifié (la lettre C imitée avec le main, le signe « téléphoner »...)[17].
Reconnaissance légale et soutien juridique à l'accès des sourds à la langue des signes
Seules quelques-unes de la centaine de langues des signes dans le monde ont obtenu une reconnaissance légale, les autres ne bénéficiant d'aucun statut officiel.
Aujourd'hui encore, faute d'information, de nombreuses personnes sourdes ou parents de sourds ne connaissent pas l'existence des langues des signes et considèrent avant tout la surdité comme un handicap. Il semble nécessaire d'avoir une approche différente de la simple vision curative de la surdité et de prendre en considération la réalité sociale et linguistique des langues des signes. De nombreux pays souhaitent avant tout un épanouissement des personnes et développent l'accès en langue des signes aux lieux publics[17], aux universités[18], etc.
Reconnaissance des langues signées par pays
- En Algérie, la langue des signes algérienne (LSA) est reconnue officiellement par la loi du relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.
- En Allemagne, la langue des signes allemande, est reconnue officiellement par la loi du [19].
- En Australie, l'auslan est reconnue officiellement en 1987 et en 1991 par le Gouvernement d'Australie.
- En Autriche, la langue des signes autrichienne est reconnue officiellement le 1er septembre 2005. La constitution d'Autriche est modifiée : Die Österreichische Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. Das Nähere bestimmen die Gesetze (« La langue des signes autrichienne est reconnue comme langue indépendante »)[20].
- En Belgique, la langue des signes belge francophone est reconnue officiellement le 2003 par le parlement de la Communauté française de Belgique, la langue des signes flamande est reconnue le 2006 par le parlement flamand et la langue des signes allemande est officiellement reconnue le 2019 par le parlement germanophone[21].
- Au Brésil, le libras est reconnue officiellement en 2002 dans le domaine de l'éducation. Il est statué que chaque enfant sourd a le droit d'apprendre en sa propre langue et d'avoir le portugais comme 2e langue.
- Dans la République tchèque, la langue des signes tchèque est reconnue en 1998[22].
- Au Canada, la province du Manitoba est la première à reconnaître officiellement la langue des signes américaine comme celle des communautés sourdes en milieu anglophone en 1988, suivi de l'Alberta qui reconnaît l'ASL comme langue optionnelle dans l'enseignement en 1990 et l'Ontario qui reconnaît l'ASL et la LSQ comme langues d'enseignement en 1993.
- Le Parlement européen approuve une résolution concernant les langues des signes le . La résolution demande à tous les États-membres la reconnaissance de sa langue des signes comme langue officielle des sourds.
- En Espagne, dans la Ley 27/2007, du 23 octobre, les langues de signes espagnoles sont reconnues officiellement[23].
- Aux États-Unis, American Sign Language est reconnue dans plusieurs États en tant que langue étrangère.
- En Finlande, la langue des signes finnoise est reconnue dans la Constitution de Finlande en août 1995.
- En France, dans l'article 75 du code de l'éducation, la langue des signes française est reconnue à part entière dans le domaine de l'enseignement sous la loi du [24].
- En Norvège, la langue des signes norvégienne est reconnue. Une émission quotidienne Nyheter på tegnspråk (« Actualités en langue des signes ») est diffusée chaque jour sur la chaîne de télévision de Norsk rikskringkasting.
- En Nouvelle-Zélande, la langue des signes néo-zélandaise est la première langue des signes à devenir, le [25], une langue officielle. C'est la troisième langue officielle du pays, après l'anglais (langue officielle de facto) et le maori.
- En Ouganda, la langue des signes d'Ouganda est reconnue dans la constitution.
- Au Portugal, la langue des signes portugaise est reconnue dans le domaine de l'éducation dans la constitution du Portugal.
- En Slovaquie, la langue des signes slovaque est reconnue en 1995 dans la loi de langue des signes des sourds 149/1995.
- En Thaïlande, la langue des signes thaïlandaise est reconnue le .
- Au Venezuela, la langue des signes vénézuélienne est reconnue le dans la constitution.
France
La loi no 2005-102 du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît officiellement la LSF. Ses articles 19 et 75 insèrent les dispositions suivantes dans le code de l'éducation :
- Article L. 112-2-2 : Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et langue française - et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'État fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
- Article L. 312-9-1 : La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
Une émission d'information en langue des signes existe sur la chaîne de télévision France Info[26].
Nouvelle-Zélande
C’est le 11 avril 2006, après une troisième lecture du texte de loi, loi publique numéro 18, que le Parlement de Nouvelle-Zélande a reconnu la langue des signes comme langue officielle (NZSL). C’est le premier pays à reconnaître la langue des signes comme telle. Le but premier de cette loi étant de rendre obligatoire l’utilisation de la NZSL dans le système juridique afin de garantir à la communauté sourde d’avoir le même accès aux informations et aux services gouvernementaux que le reste de la population. Par conséquent, il s’agit également de faire preuve de reconnaissance aux personnes sourdes comme une communauté linguistique, auparavant considéré comme souffrant d’incapacités, notamment dans les politiques en lien avec la santé et l’éducation.
De plus, bien qu’il n’y ait aucune implication budgétaire à la reconnaissance de la NZSL, les personnes sourdes ont 16 Office des personnes handicapées du Québec qui ont participé au processus d’élaboration de la loi et en ont retiré une forme de reconnaissance qu’elles n’avaient pas auparavant et une meilleure connaissance du système politique[27].
Langue des signes pour bébés
Depuis la fin du XXe siècle, on assiste à l'émergence de l'utilisation de la langue des signes pour faciliter la communication entre parents et enfants pré-verbaux.
Langue des signes utilisée avec des enfants autistes
Certaines langues des signes se sont montrées être des compléments intéressants (ou une alternative) aux systèmes de communication dits « améliorés et alternatifs » (CAA) utilisés pour mieux communiquer avec les enfants autistes non verbaux (à condition qu'ils aient de bonnes capacités d’imitation motrice)[28]. Ceci semble aussi parfois faciliter la production de vocalisations et de mots[28]. Selon une revue de la littérature publiée en 2022, la communication simultanée (associant la voix aux signes, et utilisant la syntaxe d’une langue vocale) était à cette date, le système d’apprentissage le plus documenté par les études sur le sujet[28].
Utilisation notable dans la fiction
Films
- Ridicule (Patrice Leconte, 1996) : devant une assemblée d'aristocrates au château de Versailles, l'abbé Charles-Michel de L'Épée présente ses élèves et leurs capacités.
- Sur mes lèvres (Jacques Audiard, 2001) : Carla Behm (Emmanuelle Devos), sourde, avertit son amoureux Paul (Vincent Cassel), recherché par des truands, du danger en langue des signes à travers la fenêtre.
- 11 regards sur le 11 septembre (co-réalisé par 11 réalisateurs, 2002) : dans l'un des 11 courts-métrages, Emmanuelle Laborit attend en banlieue new-yorkaise son compagnon parti à Manhattan, en cuisinant alors que la télévision diffuse, derrière elle (donc hors de sa vue), les images de l'effondrement des tours et elle ne comprend pas l'émotion de celui-ci à son retour.
- La Famille Bélier (Éric Lartigau, 2014) : seule entendante dans une famille de sourds, Paula (Louane Emera), tout en chantant, traduit pour cette dernière en langue des signes la chanson de Michel Sardou Je vole au cours d'une audition pour le concours de la maîtrise de Radio France.
- Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris, 2014) : biographie de Marie Heurtin (1885-1921) femme française sourde et aveugle de naissance.
- J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd (Laetitia Carton, 2015) : film documentaire sur la langue des signes française (LSF), la culture sourde et le monde des sourds.
- Koe no Katachi (Naoko Yamada, 2016) : adaptation en film animé de la série manga de Yoshitoki Oima. Ishida est un garçon qui se fait renvoyer de son lycée car il harcèle régulièrement Nishimiya, une collègue de classe sourde. Des années plus tard, il apprend la langue des signes et part à la recherche de la jeune fille.
- La Forme de l'eau (Guillermo del Toro, 2017) : le personnage principal est une muette ne s'exprimant qu'avec la langue des signes.
- Sans un bruit (John Krasinski, 2018) : l'humanité est au bord de l'extinction à la suite de l'apparition soudaine de monstres aveugles mais sensibles au moindre bruit. Pour ne pas se faire tuer, les quelques humains survivants restent muets en permanence et ne communiquent que par la langue des signes.
- Rampage (Brad Peyton, 2018) : Dwayne Johnson, qui joue un primatologue, communique avec son gorille albinos, George, par langue des signes.
- Hawkaye : Alaqua Cox, qui joue un rôle d'un personnage muet qui communique par la langue des signes.
- CODA : adaptation américaine de La Famille Bélier.
- Les Éternels (Chloé Zhao, 2021) : Lauren Ridloff, une actrice sourde interprète le personnage de Makkari, une Éternelle muette. C'est le premier super-héros sourd à faire son apparition au cinéma. Son statut de film du MCU, ainsi que l'engouement autour du personnage marque un regain d'intérêt pour les langes des signes.
Personnalités sourdes ou ayant recours à la langue des signes
Notes et références
- (en) Mark Aronoff, Irit Meir, Carol Padden et Wendy Sandler, « Morphological universals and the sign language type », dans Yearbook of Morphology 2004, Springer Netherlands, (ISBN 978-1-4020-2900-4, DOI 10.1007/1-4020-2900-4_2, lire en ligne), p. 19–39
- (en) Carol Padden, « The grammar of space in two new sign languages », Sign Languages: A Cambridge Survey, , p. 573-595 (lire en ligne
 )
) - Yann Cantin, « DES ORIGINES DU NOÉTOMALALIEN FRANÇAIS, PERSPECTIVES HISTORIQUES », Glottopol, no 27, (lire en ligne, consulté le )
- yann Cantin et Florence Encrevé, « La vision des ”vaincus” : écrire l'histoire des sourds hier et aujourd'hui », La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, no 64, , p. 29–40 (lire en ligne, consulté le )
- Alan Canonica, Martin Lengwiler, Mirjam Janett et Florian Rudin, Aus erster Hand Gehörlose, Gebärdensprache und Gehörlosenpädagogik in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert, (ISBN 978-3-0340-1569-1 et 3-0340-1569-0, OCLC 1130376461, lire en ligne)
- Aude de Saint Loup, « Tribulations des langues des signes du XIXe siècle à nos jours », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage, no 34, (ISSN 2264-7082, DOI 10.4000/tipa.1976, lire en ligne, consulté le )
- Trettenbrein, Patrick. C., Giorgio Papitto, Angela D. Friederici & Emiliano Zaccarella. (2021): Functional neuroanatomy of language without speech: An ALE meta‐analysis of sign language. Human Brain Mapping, 42(3), 699–712. https://doi.org/10.1002/hbm.25254
- (en) S. N. Mahshie, Educating Deaf Children Bilingually, Washington, DC, Gallaudet University Pre-College Programs,
- Daphné Ducharme et Rachel Mayberry, « L'importance d'une exposition précoce au langage : la période critique s'applique au langage signé tout comme au langage oral », dans Catherine Transler, Jacqueline Leybaert, Jean-Emile Gombert, L'acquisition du langage par l'enfant sourd : les signes, l'oral et l'écrit., Marseille, Solal, , 344 p. (ISBN 2-914513-80-1)
- William C. Stokoe, Sign Language Structure : an outline of the visual communication, Studies in linguistics, Occasional Papers n°8, Buffalo, New York, 1960. et William C. Stokoe, Semiotics and Human Sign Languages, Mouton, La Haye, 1972.
- André Martinet, Éléments de linguistique générale, Armand Colin, Paris, 1960.
- François-Xavier Nève de Mévergnies, Essai de grammaire de la langue des signes française, Fascicule CCLXXI, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Liège, Belgique, 1996.
- Voir sur le site de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
- Christian Cuxac, Fonctions et structures de l’iconicité dans les langues des signes ; analyse descriptive d’un idiolecte parisien de la langue des signes française, thèse de doctorat d’État, Université de Paris V. et Christian Cuxac, La Langue des signes française. Les voies de l’iconicité, Ophrys, Faits de Langue no 15-16, Paris, 2000.
- M-A Sallandre, Les unités du discours en langue des signes française. Tentative de catégorisation dans le cadre d’une grammaire de l’iconicité, thèse de doctorat d'État, Université de Paris VIII, 2003.
- M-A Sallandre, Va-et-vient de l’iconicité en langue des signes française ; Acquisition et interaction en langue étrangère en ligne.
- Art. L. 112-2-2 du Code de l'éducation, inséré par la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).
- Université Gallaudet pour les sourds, USA.
- (de) (de) Allemagne. « Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze », art. 1, §6 [lire en ligne (page consultée le 11 juin 2011)].
- (de) « Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 8, tagesaktuelle Fassung », sur ris.bka.gv.at, 01.09/2005 (consulté le )
- « Angemessene Vorkehrungen für Personen mit Hörschädigungen », sur www.antoniadis.be (consulté le )
- (cs) « ZÁKON ze dne 11. června 1998 o znakové řeči a o změně dalších zákonů - Sbírka zákonů », sur www.sagit.cz (consulté le )
- « pdf », sur Bulletin Officiel de l'État espagnol,
- Art. L. 112-2-2 du Code de l'éducation, inséré par la Loi no 2005-102 du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- (en) « New Zealand Sign Language Act 2006 », sur legislation.govt.nz, New Zealand Legislation (consulté le ).
- data.over-blog-kiwi.com/0/95/30/84/20160829/ob_b65106_franceinfo-grille-tv.pdf.
- « Nouvelle-Zélande: Loi sur la langue des signes néo-zélandaise de 2006 », sur www.axl.cefan.ulaval.ca (consulté le )
- E. Adam et V. Cruveiller, « L’utilisation des langues des signes avec les enfants autistes : une revue de la littérature », Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, vol. 70, no 1, , p. 8–19 (ISSN 0222-9617, DOI 10.1016/j.neurenf.2021.11.001, lire en ligne, consulté le ).
Voir aussi
Bibliographie
- (en) Mark Aronoff, Irit Meir et Wendy Sandler, « The Paradox of Sign Language Morphology », Language, vol. 81-2, , p. 301-344 (ISSN 0097-8507 et 1535-0665, OCLC 50709582, JSTOR 00978507, lire en ligne).
- Patrick Belissen (dir.) et Benoît Drion, Paroles de Sourds : À la découverte d'une autre culture, La Découverte, , 214 p. (ISBN 270719994X et 9782707199942, présentation en ligne, lire en ligne).
- Ivani Fusellier-Souza, « Sémiogenèse des langues des signes. Étude de langues de signes émergentes (LSE) pratiquées par des sourds brésiliens », thèse, Université de Paris VIII, École Doctorale « Cognition, Langage, Interaction », (lire en ligne), .
- (en) Trevor A. Johnston, « The Sign Language of the Australian Deaf community », thèse, Université de Sydney, (lire en ligne).
- Henri Wittmann, « Classification linguistique des langues signées non vocalement », Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée, vol. 10, no 1, , p. 215-288 (lire en ligne).
- Gordon, Raymond, ed. (2008), Ethnologue: Languages of the World, 15th edition, SIL International (ISBN 978-1556711596),
Articles connexes
- Liste des langues des signes, Famille de la langue des signes, Histoire de la langue des signes
- Alphabet dactylologique, Alphabet bimanuel
- Histoire des sourds, Surdité
- Langue des signes pour bébé
- Langue des signes française (LSF)
- Langue des signes de Belgique francophone (LSFB)
- Langue des signes québécoise (LSQ)
- Cerveau et langue des signes
- Langue
Liens externes
- Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF)
- Introduction à la Langue des Signes Française : la place du sourd et de sa langue en France Un article d'Aliyah Morgenstern
- Elix : dictionnaire gratuit français/langue des signes, plus de 6000 signes et 8000 définitions en LSF
- Ressources relatives à la santé :
- (en) Medical Subject Headings
- (no + nn + nb) Store medisinske leksikon
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :