Charles Bombonnel
Charles Bombonnel, né à Spoy le et mort à Dijon le , est un chasseur français de félins sur l'actuel territoire de l'Algérie. Son père lui a transmis les bases de la chasse. En 1831, il perd ses parents, et en 1835 il part pour les États-Unis d'Amérique pour faire fortune.
.jpg.webp)
| Naissance | |
|---|---|
| Décès |
(à 73 ans) Dijon |
| Sépulture | |
| Activités |
| Distinction |
|---|
.svg.png.webp)
_Cimeti%C3%A8re_des_P%C3%A9joces_-_Tombe_de_Charles_Bombonnel_-_01.jpg.webp)
Il revient en France en 1844 où il se marie, et la même année il découvre la faune algérienne et s'installe en Algérie pour chasser la panthère et le lion. En 1870, il organise une légion de francs-tireurs intégrée à l'armée française dans son combat contre les Prussiens.
En 1878, il revient en Algérie pour continuer ses chasses, et en 1890 il meurt de maladie à son domicile. Il a écrit un livre en 1860 qui retrace sa vie de chasseur en Algérie. Il a été décoré en 1871 de la Légion d'honneur.
Famille

Il est né à Spoy le 10 août 1816 de Louis Barthélémy Bombonnel et de Marie-Rose née Grésely, dans une famille peu aisée[1] - [2]. Son père était verrier et chasseur, il l'a inspiré et lui a appris les bases de la chasse[3] - [4] - [1] - [2]. Charles avait 6 frères et 6 sœurs[5] - [6].
L'origine de son ascendance paternelle est sûrement italienne, d'une grande lignée de verriers d'après Yves Cléon[7]. Le premier des Bombonnel à s'être installé dans l'Est de la France est son arrière-arrière-grand-père Gabriel, lui-même qui venait de Provence du petit village de Villes-sur-Auzon[7]. Gabriel s'est marié à Jeanne Lamour à Portieux quand il travaillait à la cristallerie de Portieux[7]. Tous les descendants de Gabriel étaient ouvriers verriers[7]. Le fils de Gabriel, François, a aussi travaillé à la christallerie de Portieux[8]. Le fils de François, Dominique, s'est installé à Baccarat, où il a travaillé à la cristallerie de la ville, puis son fils Barthélémy suivra un temps son exemple dans cette verrerie[8]. En 1810, Barthélémy a épousé la veuve Marie-Rose Grésely, et abandonne la verrerie Baccarat[5], au profit de la verrerie de Spoy, où la sœur aîné de son épouse est la copropriétaire[9].
Du côté de sa mère, il y a eu des noms de famille dijonnaise ou bourguignonne[7]. Et comme dans la famille des Bombonnel, les membres de la famille de Marie-Rose Grésely sont aussi des verriers sur plusieurs générations[5].
Ascendance paternelle direct[10]:
- Pierre Bonbonnel
- Gabriel Bonbonnel dit le Valeur (1664 - 1729) et Jeanne Lamour (1675 - 1745)
- François Bonbonnel (1711 - 1768) et Elisabeth Henri (1705 - 1787)
- Dominique Bonbonnel (1744 - 1800) et Anne Marie Roher (1755 - 1807)
- Louis Brathélemy Bonbonnel (1785 - 1832) et Marie Rose Grésely (1789 - 1831)
- Charles Laurent Bonbonnel
- Louis Brathélemy Bonbonnel (1785 - 1832) et Marie Rose Grésely (1789 - 1831)
- Dominique Bonbonnel (1744 - 1800) et Anne Marie Roher (1755 - 1807)
- François Bonbonnel (1711 - 1768) et Elisabeth Henri (1705 - 1787)
- Gabriel Bonbonnel dit le Valeur (1664 - 1729) et Jeanne Lamour (1675 - 1745)
Biographie
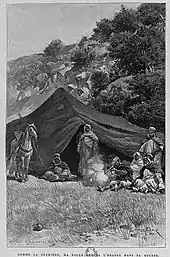
Enfance et adolescence
Toute la famille était installée, à ses débuts, dans l'enceinte même de la verrerie, où est né le futur tueur de panthères[5]. En 1831, la mère de Charles puis, en 1832, son père meurent à cause de la deuxième pandémie de choléra[1] - [11]. Les seules études qu'il a suivies étaient à l'école de son village jusqu'à l'âge de dix ans[6]'[1]. Charles va vivre chez sa tante maternelle Marie-Anne Grésley[12] qui habitait à Dijon, pendant cinq ans selon Bombonnel (ou trois ans selon Cléon[13]), et il va apprendre le commerce de la librairie[3] - [4] - [14] en étant chapeauté par le gendre de Marie-Anne, Victor Lagier[12].
Le 25 septembre 1835, il embarque du Havre vers la Nouvelle-Orléans sur un voilier nommé l’Ernest[15], pour tenter de faire fortune aux États-Unis d'Amérique[16] - [4] - [14]. D'après Cléon, Bombonnel est monté à bord de l' Ernest non officiellement car sans autorisation il ne pouvait pas le faire, il avait 19 ans (mineur) et à l'époque il n'avait pas les moyens, et vraisemblablement il a été accepté par le commandant avec une condition de travail contre son voyage[17] - [18]. L’Ernest accoste à la Nouvelle-Orléans le 16 novembre 1835[18].
En Amérique
Il faisait du démarchage et du colportage pour vendre des marchandises, pour subsister dans ce nouveau pays[16]. Une année plus tard, il se rendit à l'île de la Pass Christian, pour faire du commerce des animaux à fourrure[16] - [14] - [19]. Pendant son séjour auprès des Amérindiens, il reprend la chasse et apprend des nouvelles techniques de cette région[16] - [14].
Quelques années plus tard, il acheta une parcelle de terrain d'environ 1 hectare dans la paroisse de Jefferson acquise le 30 avril 1840, un terrain avec immeuble de 500 m2 situé à Carrollton non loin du vieux carré français acquis le 6 mai 1842 et il construisit un immeuble commercial dans le quartier commercial à l'encoignure de la rue Poydras et la rue du Camp[19] - [20]. Il a fait sa fortune grâce à la location de ces biens, et grâce au magasin de détail qu'il tient dans l'immeuble Red Store Exchange renommé aujourd'hui en Cafe Gumbolaya[20].
Retour en France
En 1844, il revint en France après huit années en Amérique[21], et il se maria à Marie Julie Clémence Stéphanie Guélaud la même année à Dijon[22] - [4] - [14] - [23] qu'il ne connaissait pas encore, c'est son cousin Victor Lagier qui lui la conseilla[24]. Selon Cléon, le mariage a été célébré dans la commune de Gemeaux, car le 7 avril 1844 la mairie de Gemeaux a émis le premier ban de publication du projet de mariage, où il est écrit que Charles Laurent et Clémence Stéphanie ont décidé de s'unir le 23 avril 1844 en cette mairie[25].
La famille de son épouse était une famille de chasseurs[14]. Il va vivre dans la Côte-d'Or, où il commence une carrière de chasseur au loup primé et au sanglier[23] - [26]. La même année, il voyage à Alger pour affaires, où il découvre du nouveau gibier potentiel à chasser comme la panthère[22] - [4] - [14] - [23] et pour son voyage de noce[27] - [28].
En Algérie

En 1850, il fait un deuxième voyage en Algérie. Il se rend à la forêt des Karesas dans la région de Hadjout[29]. s'installant chez le caïd Ben Aouadh[30], où il va chasser pour la première fois la panthère à la chèvre sans succès[31]. Il fait des allers-retours en Algérie pour participer à la chasse, et le il tue sa première panthère dans la région de Kouba après 21 nuits de chasse[32].

En , Charel entend parler d'un lion qui a été aperçu sur le territoire d'El Attaf[33]. Muni d'une lettre de recommandation donnée par le chef du bureau arabe de Miliana, il se rend chez l'agha des Attafs puis part pour Beni Rached accompagné du fils de l'agha, pour trouver le lion qui s'est déplacé vers cette région[34] - [33]. À Beni Rached, il croise Si Mohammed El Beldi, le caïd des Beni Rached, son fils et son gendre[35] - [33]. Sur leur chemin, ils sont attaqués par une douzaine d'hommes armés, pour tuer le caïd[36] - [33], ils s'en sortent sains et saufs et ils ont pu prendre avec eux cinq prisonniers[37] - [33]. Après ces événements, le caïd va organiser une grande chasse de deux cents hommes en l'honneur de Charels qui l'a sauvé lors de l'attaque, pour traquer ce lion, mais ils ne réussissent pas à le trouver[38] - [33].
Lors d'une de ces chasses dans le Corso, il a presque été tué par une attaque d'une panthère, il s'en sort avec de graves blessures à la tête et aux mains[39] - [40], il a été évacué dans le village puis à Alger le pour se faire soigner, il n'a pu se remettre à la chasse qu'après quatre mois[41] - [40]. Entre le [42] et 1863[43] Charles va faire deux campagnes pour aller chasser le lion dans les Aurès, dans la montagne de Touggourt et dans la forêt de la montagne de Bouarif à Batna ou encore dans la région de Khenchela, avec Jacques Chassaing et Émile de Kératry[42].
Guerre franco-prussienne

En 1870 pour aider l'armée française contre les Prussiens, Charles fait un appel pour unir tous les tireurs de la région, et il a organisé une légion de francs-tireurs[44].
Parmi les événements qui ont marqué cette période de sa vie, la nuit du 4 au 5 septembre de la même année, un petit groupe de sa légion avec lui campe à Clairefontaine pour garder trois routes souvent fréquentées par les Prussiens. Le maire de Joinville a transmis l'information que quatorze Prussiens venaient d'arriver dans la ville et qu'ils s'étaient arrêtés à l'hospice, qui d'après Charles était leur caserne. Le groupe de Bombonnel a surpris les quatorze hommes et les a fait prisonniers. Quatre jours avant, ils avaient déjà fait dix prisonniers prussiens[45] - [46].
Sa légion avec lui en tête a été contrainte de faire face à la marche des Prussiens de Champlitte sur Gray[47]. Le 19 janvier 1871, 600 Prussiens sont entrés à Gray. La légion s'est retirée de la ville à l'approche d'un renfort de 1 500 prussiens[48].
En juillet 1871, Le colonel commandant des francs-tireurs bourguignons Bombonnel a été nommé chevalier de la Légion d'honneur par Adolphe Thiers[49].
Retour en Algérie et mort
En novembre 1878, Bombonnel revient en Algérie pour reprendre ses chasses[50]. Il tombe sérieusement malade d'une pleurésie aiguë en hiver 1881 après sa chasse de sa 33e panthère dans le Djurjura[51].
Il est mort à son domicile de Dijon le à la rue de la Préfecture 35, de maladie[52] - [40], veuf et sans postérité[40]. Il a été inhumé au Cimetière des Péjoces[23]. la tombe de Charles est surplombée de sa statue grandeur nature, en costume de chasse de Hubert de Liège, un coutelas au côté et tenant une lance[23], sur laquelle est écrite cette épitaphe « ô, saint Hubert, tu m'as protégé de mon vivant, veille encore sur moi pendant ma mort »[53].
Écrits
Charles Bombonnel a écrit un livre intitulé Bombonnel le tueur de panthères, ses chasses, écrites par lui-même[23]. Ce livre a été réédité 18 fois jusqu'en 1924 et sa 1re édition date de 1860. Dans ce livre, il raconte en 13 chapitres sa vie de chasse en Algérie, et il se présente comme étant un spécialiste de la panthère[23].
Autres
Il s'est fait attaquer par la société protectrice des animaux, puisqu'il a livré des appâts vivants aux félins[54].
Collections
Il a fait don au muséum d'histoire naturelle de Dijon des panthères qu’il a tuées en Algérie[55] et d'un caiman de la Louisiane[56]. À Albert Grévy il a offert la peau de sa 32e panthère en 1879[57] et à Louis Tirman la peau de celle qu'il a tuée en 1884[58].
Mémoires et hommages
En 1931, à la suite de travaux d'extension dans le quartier du drapeau dans la ville de Dijon, une rue porte son nom, avec l'appellation spécifique de tueur de panthères[2], en hommage à sa contribution durant la guerre de 1870, où il dirigait une compagnie de francs-tireurs qui prendra part aux combats de la Loire et de l'Est[59] - [23].
Notes et références
Notes
Références
- De Tilly 1996, p. 107.
- Cléon 1999, p. 20.
- Bombonnel 1896, p. 9.
- Camous 1979, p. 18.
- Cléon 1999, p. 27.
- Cléon 1999, p. 28.
- Cléon 1999, p. 24.
- Cléon 1999, p. 25.
- Cléon 1999, p. 26.
- Cléon 1999, p. 22.
- Cléon 1999, p. 29.
- Cléon 1999, p. 35.
- Cléon 1999, p. 38.
- De Tilly 1996, p. 108.
- Cléon 1999, p. 44.
- Bombonnel 1896, p. 10.
- Cléon 1999, p. 45.
- Cléon 1999, p. 46.
- Cléon 1999, p. 53.
- Cléon 1999, p. 54.
- Cléon 1999, p. 78.
- Bombonnel 1896, p. 11.
- Caroline Jouret, « Une célébrité dijonnaise d'antan : le tueur de panthères Charles Bombonnel », sur France Info, (consulté le )
- Cléon 1999, p. 83-84.
- Cléon 1999, p. 81.
- Cléon 1999, p. 90.
- Cléon 1999, p. 107.
- Cléon 1999, p. 108.
- Bombonnel 1896, p. 30.
- Bombonnel 1896, p. 33.
- Bombonnel 1896, p. 34.
- Bombonnel 1896, p. 57.
- De Tilly 1996, p. 110.
- Bombonnel 1896, p. 60.
- Bombonnel 1896, p. 61.
- Bombonnel 1896, p. 62.
- Bombonnel 1896, p. 63.
- Bombonnel 1896, p. 66.
- Bombonnel 1896, p. 150.
- De Tilly 1996, p. 111.
- Bombonnel 1896, p. 152.
- Chassaing 1865, p. 239.
- Chassaing 1865, p. 265.
- « Renseignements divers », Courrier de Saône-et-Loire, no 3424, , p. 2 (ISSN 1620-8943, lire en ligne)
- « Bombonnel et ses prisonniers », Courrier de Saône-et-Loire, no 3445, , p. 3 (ISSN 1620-8943, lire en ligne)
- « Informations », Le Figaro, no 254, , p. 2 (ISSN 1241-1248, lire en ligne)
- « Les derniers combats de l'Est », Le Rappel, no 610, , p. 2 (lire en ligne)
- « Informations », Gazette nationale ou le Moniteur universel, no 31, , p. 7 (ISSN 1169-2529, lire en ligne)
- « Chronique Régionale », Le Progrès de la Côte-d'Or, no 106, , p. 3 (lire en ligne)
- « Petites nouvelles », Le Petit Caporal, no 693, , p. 3 (ISSN 2554-6503, lire en ligne)
- « Les on-dit », Le Rappel, no 3985, , p. 2 (lire en ligne)
- « Mort de Bombonnel », Le Progrès de la Côte-d'Or, no 156, , p. 2 (lire en ligne)
- Anne-Françoise Bailly, « Dijon : ces tombes insolites du cimetière des Péjoces », sur bienpublic.com, (consulté le )
- V. de Cottens, « Souvenirs de Bombonnel », Le Siècle, no 19890, , p. 2 (lire en ligne)
- « Éphémérides Bourguignonnes », Le Progrès de la Côte-d'Or, no 121, , p. 12 (lire en ligne)
- « La question du musée d'histoire naturelle », Le Progrès de la Côte-d'Or, no 311, , p. 2 (lire en ligne)
- « Faits divers », Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, no 11785, , p. 5 (lire en ligne)
- « Bombonnel en Algérie », Courrier de Saône-et-Loire, no 10742, , p. 2 (ISSN 1620-8943, lire en ligne)
- [PDF]« Sur les rails de la généalogie, Le canard de la section généalogie UAICF de Dijon », sur uaicf-dijon.fr, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
Sources primaires
- Charles Bombonnel, Bombonnel, le tueur de panthères, ses chasses, Paris, Hachette Livre, , 6e éd., 224 p. (lire en ligne sur Gallica).

- Henri Germain, Les vacances de Paulː voyage en Algérie, Paris, Hachette Livre, , 1re éd., 196 p. (lire en ligne sur Gallica), p. 145-166
- Jacques Chassaing, Mes chasses au Lion, Paris, Dentu, , 1re éd., 313 p. (lire en ligne sur Gallica).

Sources secondaires
- Yves Cléon, Bombonnel, Aventurier Dijonnais Ou Sur La Piste Du Chasseur De Panthères, Besançon, Neo Editions, , 313 p. (ISBN 2-9513106-5-X).

- Laurence Camous, Les Grands voyageurs bourguignons du XVIe siècle à nos jours, Dijon, Bibliotheque municipale, , 67 p. (présentation en ligne).

- Marie De Tilly, Mémoires de la Société académique du département de l'Aube : Où l'onvoit passer un petit monsieur, Sainte-Savine, Covam, (lire en ligne sur Gallica), p. 107-112.
