Basilique Notre-Dame de Sion
La basilique Notre-Dame de Sion est une basilique de culte catholique construite sur la colline de Sion-Vaudémont, sur la commune de Saxon-Sion, dans la région naturelle du Saintois située au sud de Nancy (département de Meurthe-et-Moselle).

| Type | |
|---|---|
| Diocèse | |
| Religion | |
| Patrimonialité | |
| Site web |
| Pays | |
|---|---|
| Région | |
| Département | |
| Commune | |
| Adresse |
La Côte de Sion |
| Coordonnées |
48° 25′ 51,4″ N, 6° 05′ 01,6″ E |
|---|
 |
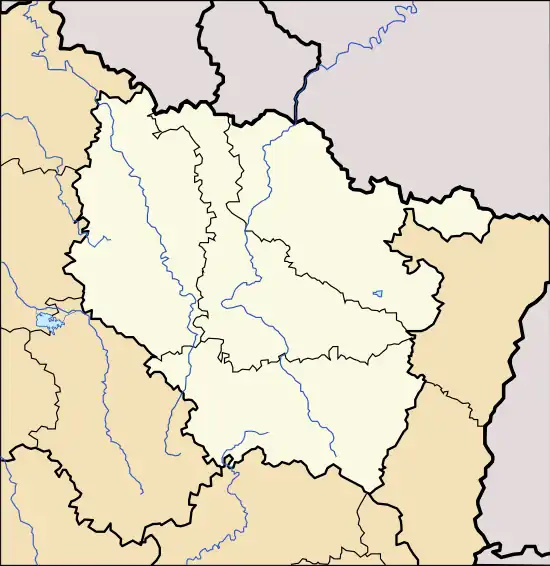 |
 |
Haut lieu de dévotion mariale du duché de Lorraine, les ducs venaient en pèlerinage sur la colline de Sion.
À l'instar d'autres lieux de pèlerinage dédiée à la Vierge Marie, elle est située à un endroit où les anciens romains venaient adorer les déesses latines, succédant à un haut-lieu celtique.
La basilique
Abside XVe siècle, nef XVIIIe siècle, tour XIXe siècle de 45 mètres due aux architectes François Lamorre et Léon Vautrin ; grille du chœur des ateliers de Jean Lamour, Vierge XIVe siècle provenant de Vaudémont, autel XVe siècle.

La tour-clocher
La tour de la basilique est couronnée d'une statue monumentale représentant l'Immaculée Conception. Cette statue, qui mesure 7 mètres de haut, date du milieu du XIXe siècle et provient de la fonderie de Tusey à Vaucouleurs (Meuse). Après avoir été déposée en 1999, dans le cadre des travaux de restauration de la basilique, elle a, une nouvelle fois, dû être déposée à la suite de l'incendie qui toucha la basilique le . Celui-ci a pu être contenu à la tour, la nef de la basilique étant préservée du sinistre, mais les quatre cloches furent détruites. Le , la statue a été remontée sur le clocher, après des travaux de restauration. Quatre nouvelles cloches ont été bénies ce même jour.
Le clocher de la basilique constitue pour l'IGN un point géodésique du réseau de détail français[1].
Les plaques commémoratives
En 1873, 1920, 1946 et 1973 sont apposées des plaques commémorant l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne à la suite de la guerre de 1870, puis sa restitution à la France après la Première Guerre mondiale, et enfin son annexion par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale :
- Le , 30 000 personnes acclament surtout les bannières endeuillées de Strasbourg, de Metz et des grandes cités mosellanes. L' évêque de Metz, Mgr Paul Dupont des Loges, que les autorités Allemandes ont laissé en place mais qui vient de décliner les honneurs concordataires des soldats allemands, est présent. On appose solennellement dans l'église une plaque de marbre timbrée d'une croix de Lorraine rompue, soulignée de ces mots : « Ce name po tojo » (« Ce n'est pas pour toujours »)[2].

- Le , Mgr Willibrord Benzler, évêque Allemand de Metz, ayant été chassé par les autorités Françaises, c'est son successeur, Jean-Baptiste Pelt, évêque et son confrère de Strasbourg qui font l’ascension de la colline. L'écrivain Maurice Barrès se joint a eux, et c’est lui qui pose, sur la Croix de Lorraine, une palme d’or cachant la brisure. Puis les prélats ajoutent un ex-voto portant ces mots : « Ce nato me po tojo » (« Ce n’était pas pour toujours »)[2].
- Le , une grande foule fait le pèlerinage. Aux places d'honneur figurent, aux côtés des évêques Lorrains (Mgrs Heintz, Weber, Dubourg, Fleury, Blanchet, Maisonnobe, Gaudel et Petit), les grands capitaines qui ont combattu l'Allemagne, et des membres du gouvernement de la République (Pierre-Henri Teitgen). Une troisième Inscription vient s'ajouter aux deux autres sous la croix de Lorraine ressoudée : « Estour hinc po tojo » (« Cette fois, c’est pour toujours »)[2].
L'incendie de 2003
Avant l'incendie, l'édifice ne bénéficiait pas de protection au titre des monuments historiques ; l'incendie a incité le ministre de la Culture de l'époque, Jean-Jacques Aillagon, à demander au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir la Commission régionale du patrimoine et des sites à cet effet[4]. L'inscription fut obtenue pour l'intégralité de la basilique, ainsi que pour les toitures et la façade de l'ancien couvent voisin, par un arrêté du [5].
Galerie
 Statue de l'Immaculée Conception au sommet de la basilique.
Statue de l'Immaculée Conception au sommet de la basilique. Vierge à l'Enfant, devant le vitrail flamboyant du chœur de la basilique.
Vierge à l'Enfant, devant le vitrail flamboyant du chœur de la basilique. Statue de Marguerite de Lorraine-Vaudémont.
Statue de Marguerite de Lorraine-Vaudémont. La chapelle Notre-Dame de Pitié.
La chapelle Notre-Dame de Pitié. Saint Joseph et l'Enfant.
Saint Joseph et l'Enfant.
Références
- « Saxion-Sion I », site no 5449701, IGN. Consulté le 8 septembre 2008.
- Gabriel Bichet, « Demain à Sion s'inscrira le dernier acte d'un grand drame lorrain », L'Est républicain, , p. 6 (lire en ligne).
- Plaque dans la basilique Notre-Dame-de-Sion
- « Incendie du clocher de la basilique Notre-Dame de Sion », communiqué de presse du ministère de la Culture, 8 novembre 2003. Consulté le 8 septembre 2008.
- « Église paroissiale de la Nativité de la Vierge dite Basilique Notre-Dame-de-Sion et ancien couvent des Tiercelins de Sion », notice no PA54000059, base Mérimée, ministère français de la Culture. Consulté le 8 septembre 2008.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives à la religion :
- Ressource relative à l'architecture :
- Sanctuaire de Notre-Dame de Sion - Sanctuaires catholiques en France
- Présentation et informations sur la sanctuaire Notre-Dame de Sion, Église catholique en Meurthe-et-Moselle
- Sanctuaire Notre Dame de Sion - Messe.info