Trésor des Atrébates
Le trésor des Atrébates est un ensemble de 42 pièces, essentiellement des parures gauloises en or, découvert dans des conditions controversées en 2010 à Warlincourt-lès-Pas, dans le département du Pas-de-Calais (France).
| Trésor des Atrébates | |
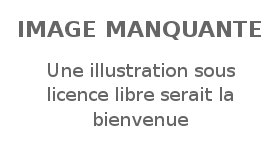
| |
| Poids | 904,45 g |
|---|---|
| Matériau | Or |
| Période | Âge du Fer |
| Culture | Celtes |
| Date de découverte | 24 septembre 2010 |
| Lieu de découverte | Warlincourt-lès-Pas, Pas-de-Calais |
| Coordonnées | 50° 09′ 08″ nord, 2° 29′ 24″ est |
| Conservation | Musée d'Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye |
| Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Pas-de-Calais
| |
Daté de la fin de l'âge du fer, vers les IIe – Ier siècles av. J.-C., le trésor est attribué au peuple gaulois des Atrébates.
Description
Composé de 42 pièces[1], le trésor est attribués aux Atrébates[2], peuple gaulois, peut-être originaires des régions danubiennes, présent en Gaule belgique depuis le IIIe siècle av. J.-C. et qui a laissé son nom à l'Artois[3].
D'une masse totale avoisinant les 900 grammes, il est notamment constitué de parures en or dont quatre torques complets et des éléments d'autres torques, d'un brassard décoré, de quatre anneaux lisses, de quatre bagues ornées ainsi que de deux petits lingots d’or[3].
Présentant « un réel intérêt » archéologique bien que sa provenance ne soit pas totalement assurée[4], l'ensemble constitue, suivant les responsables du musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Lay (MAN), « l'une des découvertes majeures de toute l'histoire de l'archéologie gauloise »[5].
Découverte et acquisition
Selon son inventeur, le trésor a été découvert le 24 septembre 2010[5], alors que le musée d'Archéologie nationale parle de 2011[3]. L'annonce publique de cette découverte n'est faite qu'en 2014[6]. Philippe Vanderbeken, le maire de Warlincourt, est l’un des premiers élus à avoir été prévenu de la trouvaille[7].
La découverte s'est faite sur une propriété privée du Pas-de-Calais[5], dans un bois situé entre les communes de Pas-en-Artois et Warlincourt-lès-Pas[8].
Selon le bulletin de l'association Amis des Études Celtiques, l’exhumation s'est faite sans faire attention, dans un premier temps, au terrain mais des repérages archéologiques ultérieurs auraient révélé la présence, dans les alentours, de bâtiments et structures antiques diverses qui permettent de faire des hypothèses sur les raisons d'un enfouissement qui interroge[3].
Le trésor est ensuite étudié pendant deux ans et restauré[3] au laboratoire TRACES du CNRS et de l'université Toulouse II-Jean-Jaurès[5]. Le , il est classé « œuvre d’art d’intérêt patrimonial majeur » afin d'en empêcher la vente à l'étranger[3], et est confié au MAN, qui l'expose brièvement en septembre 2014[3].
En septembre 2014, le MAN, autorisé à acquérir le trésor[9] évalué à 800 000 € par une commission spécialisée, lance un appel aux dons pour financer son rachat[8], mais le caractère licite ou non de la découverte du trésor interroge[10] au point que sa vente à l’État est suspendue[11].
En 2014, quatre ans après la mise au jour du trésor, aucune fouille n'a été entreprise ni programmée sur le site de sa découverte et aucune publication concernant son étude n'a été publiée[9] - [N. 1].
Le rapport d'activité pour l'année 2017 du MAN publié en 2018 indique que le dossier du dépôt de parures en or celtiques, dit « trésor des Atrébates », est alors en attente des décisions de justice[13].
Conservé depuis au musée d'Archéologie nationale[14], le trésor fait en 2020 l'objet d'une proposition de classement en tant qu’ensemble historique mobilier[14], ce type de classement ayant pour conséquence l'obligation conserver l'ensemble dans son intégrité et de limiter la vente sur le territoire français avec notification préalable[15].
Controverse sur les circonstances de la découverte
Les circonstances de la découverte font l'objet d'une controverse.
L’inventeur déclare qu'au cours d'une promenade, il a aperçu sur un talus ce qu'il pensait être un morceau de tôle froissée et qu'après avoir dégagé ce qui lui semblait être du cuivre, sont apparus des bagues et des anneaux qu'il a emmené chez lui pour les mettre en sécurité[5]. Il ajoute avoir ensuite appelé la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) du Nord-Pas-de-Calais afin que celle ci puisse poursuivre les fouilles en sa présence. Il précise que début octobre 2010 les archéologues de la DRAC de Lille et le responsable du Service Régional d'Archéologie d'Arras se sont rendu avec lui sur le lieu de la découverte et que la décision a été prise d'excaver les objets restant par mesure de sécurité[5].
Selon le propriétaire du terrain, l'inventeur du trésor serait entré sans autorisation sur sa propriété avec un détecteur de métaux[12].
Pour l'association HAPPAH, « il ne s’agirait pas de la découverte fortuite d’un promeneur ; on aurait affaire à un chasseur de trésors, fouilleur clandestin de la région, équipé d’un détecteur de métaux, ayant prospecté sur la propriété d’un château privé et creusé le sol pour déterrer les objets. »[3]
Le 21 juin 2017, le tribunal d'Arras classe sans suite une plainte déposée par la ministre de la culture Fleur Pellerin à l'encontre de l'inventeur et d'un ou de plusieurs archéologues, indiquant qu'aucun élément probant n'a permis de remettre en cause le caractère fortuit de cette découverte et que rien ne fait plus obstacle, au plan pénal, au projet d'acquisition par le MAN[16]. Une nouvelle plainte du ministère débouche sur un non-lieu en juillet 2020, mettant un terme à l'action publique[17].
Le , la Voix du Nord indique que l'inventeur, conforté en sa qualité d'inventeur du trésor des Atrébates au fil des procédures judiciaires, attend toujours sa part[17]. Ce dernier est par ailleurs condamné le pour diffamation par le tribunal d'Arras pour avoir évoqué sur les réseaux sociaux, une « corruption » dans les services du CNRS[18].
Inspirations
La découverte aura inspiré un Escape Game par une association de la région[19] - [20].
Notes et références
Notes
- Le 29 septembre 2014, l'association Halte au pillage du patrimoine archéologique et historique (HAPPAH) adressait une lettre ouverte à la ministre de la Culture[9], « s'étonnant des conditions de cette découverte et s'interrogeant sur d'éventuels arrangements passés entre l'inventeur, le Musée de Saint-Germain-en-Laye et les services de l’État » et lui demandant comment expliquer que « ce dépôt qui a reçu le statut d’œuvre d'intérêt patrimonial majeur. [...] ne soit répertorié dans aucune publication, rapport ou ressource scientifique, et qu'on ne retrouve aucune trace de fouille officielle y afférant ? »[12]
Références
- Rédigé par l'équipe franceinfo Culture (avec AFP), « Trésors : Le Musée d'archéologie nationale lance un appel aux dons », sur France Info (chaîne de télévision), (consulté le ).
- Rédigé par l'équipe Le Parisien, « Un appel aux dons pour enrichir la collection du musée », sur Le Parisien, (consulté le ).
- Jacques Lacroix, « Le trésor des Atrébates », Bulletin de liaison/Amis des Études Celtiques, no 66, , p. 8-17 (e-ISSN 1270-8291, lire en ligne)
- Xavier Delestre, Pillages archéologiques : Les « orphelins de l’histoire », Ministère de la Culture/Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ISBN 978-2-11-167099-0, HAL hal-03411342), p. 88
- Yann Fossurie, « Trésor gaulois de Pas-en-Artois : L'inventeur livre sa version des faits », sur France 3 Hauts-de-France, (consulté le ).
- « Appel aux dons : Aider le musée d’Archéologie nationale à acquérir le trésor des Atrébates » [PDF], sur Musée d'Archéologie nationale, (consulté le ).
- « À Pas-en-Artois, « ce qui choque, c’est que le trésor des Atrébates parte près de Paris » », sur La Voix du Nord, (consulté le )
- Yann Fossurie/AFP, « Le musée d'Archéologie nationale lance un appel aux dons pour acquérir un trésor gaulois découvert près d'Arras », sur France 3 Hauts-de-France, (consulté le ).
- Virginie Duchesne, « Panique autour du trésor des Atrébates », sur Le Journal des arts, (consulté le ).
- Hélène Hannon, « Ça se dispute autour du trésor gaulois », Aujourd'hui en France,
- « Où en est-on du trésor des Atrébates? », sur La Voix du Nord (consulté le ).
- « Trésor gaulois de Pas-en-Artois : découverte fortuite ou pillage archéologique ? », sur France 3 Hauts-de-France, (consulté le ).
- « Rapport d'activité 2017 », sur Musée d'Archéologie nationale, (consulté le ), p. 35.
- « Bilan 2020 – Activité de la CNPA et des CRPA »
 [PDF], sur culture.gouv.fr, , p. 9
[PDF], sur culture.gouv.fr, , p. 9 - Laura Scurti, « Le classement des objets d’art et le droit de propriété », sur gazette-drouot.com,
- « Classement sans suite dans l’affaire du Trésor des Atrébates », sur La Voix du Nord, (consulté le ).
- « Arrageois : l’inventeur du trésor des Atrébates attend sa part... depuis douze ans », sur La Voix du Nord, (consulté le ).
- Alexis Degroote, « Pourquoi l’homme qui avait découvert le Trésor des Atrébates a été condamné à Arras pour diffamation ? », sur lavoixdunord.fr, (consulté le ).
- « Une Fête du livre sur le thème du polar à la médiathèque de Leforest », sur La Voix du Nord, (consulté le )
- « L’Enquête Atrébate (The Atrebate Inquiry) », sur Morty App (consulté le )
Annexes
Bibliographie
- Xavier Deru et Roland Delmaire, La Gaule Belgique, Picard, 2016, 134 p. (ISBN 978-2-7084-1009-1)
- Jean-Marc Doyen, Gallia Belgica, Germania Inferior & Moesia Superior - Trésors monétaires anciens et nouveaux (IIe-Ve siècles), Moneta, 2008, 396 p. (ISBN 978-90-77297-48-3)
- Alexandre Dumont-Castells, Pillages archéologiques - Le cas Pierre-Calixte Duretête, Errance, 2021, 127 p. (ISBN 978-2-38473-008-7)
- Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier, Institutions et fastes de la province romaine de Gaule Belgique : d'Auguste à l'Empire gaulois (27 av. N.E.-260 D.N.E), CReA-Patrimoine, 2021, 218 p. (ISBN 978-2-9602029-4-6)
- Michel Reddé, Gallia Comata - La Gaule du Nord, Presses universitaires de Rennes, 2022, 400 p. (ISBN 978-2-7535-8238-5)

