La vie est un long fleuve tranquille
La vie est un long fleuve tranquille est un film français réalisé par Étienne Chatiliez et sorti en 1988. Le film remporte 4 récompenses à la 14e cérémonie des Césars.
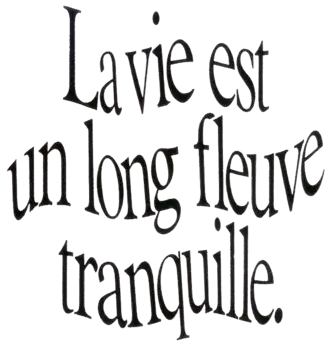
| Réalisation | Étienne Chatiliez |
|---|---|
| Scénario |
Étienne Chatiliez Florence Quentin |
| Acteurs principaux | |
| Sociétés de production |
Téléma MK2 FR3 Cinéma |
| Pays de production |
|
| Genre | Film de mœurs |
| Durée | 90 minutes |
| Sortie | 1988 |
![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution
Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution
Résumé
Dans une ville du Nord de la France, à Bapaume, coexistent deux familles radicalement opposées et parodiant les stéréotypes sociaux[1].
D’un côté, les Groseille et leurs six enfants, aux revenus modestes, vivant d’aides sociales dans une HLM, et dont l’existence est constituée de combines, de larcins et des dures réalités de la vie. Le fils aîné Franck âgé de 18 ans est d'ailleurs en prison pour vol. Parmi leurs autres enfants, Maurice (surnommé Momo), 12 ans, est de loin le plus débrouillard et le plus intelligent.
De l’autre, les Le Quesnoy, famille aisée catholique pratiquante : Monsieur est directeur régional de l’EDF et Madame, outre ses actives participations aux kermesses de la paroisse, s’occupe de leurs cinq enfants. Les seuls tracas viennent de la part de Bernadette, 12 ans, qui agit de façon un peu erratique ces derniers temps ; elle vole le maquillage de sa mère et s'habille en tenue légère.
Les deux familles qui vivent chacune de leur côté auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais douze ans plus tôt, le soir de Noël, à la maternité, l’infirmière Josette, excédée par l'indifférence de son amant, le docteur Mavial, gynécologue, décide d’échanger au berceau deux nouveau-nés : le fils Le Quesnoy et la fille Groseille. Ainsi sont venus au monde, sur un coup de colère, Maurice Groseille et Bernadette Le Quesnoy.
Restée fidèle à son amant durant toutes ces années, espérant enfin faire vie commune après la mort de Mme Mavial, Josette voit ses illusions partir en fumée lorsque le docteur lui dit, lors des obsèques de sa femme : « Je ne pourrai jamais la remplacer. ». Pour se venger en ruinant sa carrière, elle décide d’informer, par lettre, les parents des deux enfants et le docteur Mavial de l'échange des nourrissons. Celui-ci, humilié, quitte la ville.
Les Le Quesnoy et les Groseille reçoivent la révélation chacun à leur manière. Les Le Quesnoy, contre un peu d’argent, convainquent les Groseille de leur confier Maurice en simulant une adoption tout en conservant Bernadette et en omettant de lui révéler qu’ils ne sont pas ses vrais parents pour lui éviter un traumatisme.
Maurice semble parfaitement se fondre dans le monde bourgeois de ses parents géniteurs et se montre gentil avec ses frères et sœurs. Toutefois, il vole de la vaisselle en argent et la revend. Un jour, après que Bernadette lui a dit qu’elle n’aime pas les pauvres, Maurice lui révèle qu’elle n’est pas une fille Le Quesnoy mais la fille des Groseille. Bernadette décide d’aller voir sa « vraie » famille, mais est tétanisée par le mode de vie des Groseille et leur grossièreté. Elle fait une dépression.
Maurice fait en sorte que les enfants Le Quesnoy et les enfants Groseille se rencontrent et tous vont se baigner dans la Deûle alors que l’endroit est interdit car dangereux ; Roselyne Groseille, « l’ex-sœur » de Maurice, fait des avances à Paul Le Quesnoy, son frère aîné… qui se laisse séduire.
Jean et Marielle Le Quesnoy sont furieux lorsque leurs fils leur reviennent éméchés : ils ne comprennent pas pourquoi. Marielle sombre elle aussi dans l’alcool.
Après que Bernadette a tenté de fuguer, Jean propose à Marielle de partir, avec leur fille et leur domestique Marie-Thérèse, au Touquet pour se reposer. Il promet de les rejoindre avec leurs autres enfants une fois l'école terminée.
La veille du départ, Maurice se rend chez les Groseille où il est bien accueilli… et rentre chez lui à pied.
Le film se termine sur une dernière apparition de Josette. Celle-ci habite désormais dans une petite maison au bord de la plage du Touquet… avec Mavial, amoindri et brisé. L’ex-infirmière savoure ainsi sa victoire sur l’ex-gynécologue après des années de patience et d’humiliation.
Fiche technique
- Titre : La vie est un long fleuve tranquille
- Réalisation : Étienne Chatiliez
- Scénario : Étienne Chatiliez et Florence Quentin
- Musique : Gérard Kawczynski
- Sociétés de production : Téléma, MK2, FR3 Cinéma
- Pays d'origine :
 France
France - Langue : français
- Format : Couleurs - 1,66:1 - son Dolby numérique - 35 mm
- Genre : comédie de mœurs
- Durée : 93 minutes
- Date de sortie :
- Tous publics
Distribution
Enfants échangés
- Benoît Magimel : Momo Groseille / Maurice Le Quesnoy, enfant de 12 ans, débrouillard, très habile pour commettre des larcins de façon discrète, prêt à tout pour trouver de quoi nourrir sa famille. Il combine avec Ahmed l'épicier de son quartier pour faire exploser la voiture de ce dernier et toucher l'assurance. Une fois qu'il vient habiter chez ses parents géniteurs les Le Quesnoy, il dérobe ensuite l'argenterie pour la revendre. Il entraîne par la suite ses frères et soeurs sur la mauvaise pente.
- Valérie Lalande : Bernadette Le Quesnoy / Bernadette Groseille: enfant de 12 ans, bien élevée mais qui surprend ses parents par son attitude parfois déplacée. Après avoir appris qu'elle était un enfant de la famille Groseille, elle fait une dépression puis fugue.
Famille Le Quesnoy
- André Wilms : Jean Le Quesnoy, le père, cadre supérieur, directeur régional d'EDF, homme calme, distingué et donnant une bonne éducation à ses enfants. Il est écœuré par les conditions de vie dans lesquelles a été élevé Maurice.
- Hélène Vincent : Marielle Le Quesnoy, la mère, femme dévouée à son mari, à ses enfants ainsi qu'à la paroisse où elle contribue aux spectacles donnés. Après l'arrivée de Maurice dans la famille, elle n'arrive plus à empêcher ses enfants de faire des bêtises et devient dépendante à l'alcool.
- Guillaume Hacquebart : Paul Le Quesnoy, adolescent de 16 ans aîné des enfants Le Quesnoy, poli et courtois comme son père. Il tombe amoureux de Roselyne Groseille qui le séduit puis change d'attitude avec ses parents, devient vulgaire et veut son autonomie.
- Emmanuel Cendrier : Pierre Le Quesnoy, enfant de 13 ans, bon pianiste, celui qui croit le plus aux valeurs chrétiennes. Il est pour la charité envers les personnes démunies mais contrairement à ses frères, il reste à l'écart des mauvais coups après l'arrivée de Maurice.
- Jean-Brice Van Keer : Mathieu Le Quesnoy, enfant de 9 ans, souriant et poli. Après l'arrivée de Maurice, il commence à être sur la mauvaise pente, boit de l'alcool, va se baigner à un endroit interdit et se blesse.
- Praline Le Moult : Emmanuelle Le Quesnoy, enfant de 6 ans qui est curieuse et pose beaucoup de questions. Elle est déçue quand sa vie de famille est bouleversée par l'arrivée de Maurice et de ne plus pouvoir bénéficier d'une cuisine saine.
- Catherine Jacob : Marie-Thérèse, la femme de ménage de la famille, sympathique mais qui est vite dépassée par les évènements. Elle révèle à sa patronne qu'elle est enceinte mais jure qu'elle n'a eu de relation sexuelle avec personne, ce qui épouvante Marielle.
Famille Groseille
- Tara Römer : Million Groseille, enfant de 13 ans, complice de Maurice dans les vols commis pour nourrir la famille.
- Jérôme Floch : Toc-Toc Groseille, enfant de 8 ans très chahuteur, vulgaire comme ses parents.
- Sylvie Cubertafon : Ghislaine Groseille, enfant de 5 ans en surpoids, victime de la mauvaise alimentation chez la famille Groseille.
- Axel Vicart : Franck Groseille, jeune adulte de 18 ans, aîné des enfants Groseille. Il a été en prison à la suite de vols, il est vulgaire et obsédé sexuel.
- Claire Prévost : Roselyne Groseille, adolescente de 16 ans un peu enveloppée, elle sait comment séduire les hommes et fait tomber sous son charme Paul Le Quesnoy.
- Christine Pignet : Marcelle Groseille, mère de famille vulgaire, raciste et irresponsable, elle laisse ses enfants livrés à eux-mêmes, elle ne tient pas ses comptes et bien que Jean Le Quesnoy lui donne 20 000 francs par mois, elle dépense sans compter y compris des choses inutiles. Elle aime ses enfants malgré tout.
- Maurice Mons : Fredo Groseille, père de famille un peu simplet et raciste, il a été soldat pendant la guerre d'Algérie, ne travaille pas et passe ses journées à faire des réussites. Comme sa femme, il laisse ses enfants livrés à eux-mêmes.
Maternité
- Daniel Gélin : docteur Louis Mavial, le gynécologue, homme hautain qui trompe sa femme avec Josette. Lorsque sa femme décède, il dit à Josette lors des obsèques qu'il ne pourra jamais la remplacer. Furieuse, cette dernière révèle pour se venger qu'elle a échangé deux bébés à la naissance quelques années auparavant.
- Catherine Hiegel : Josette, infirmière amante du docteur Mavial qui apprend que le docteur ne l'épousera pas après la mort de sa femme. En conséquence, elle révèle qu'elle a échangé deux bébés à la naissance 12 ans auparavant.
- Elisabeth Tavernier et Frédérique Moidon : les infirmières
Paroisse
- Patrick Bouchitey : père Aubergé, le curé de la paroisse
Autres
- Abbes Zahmani : Ahmed, épicier du quartier Moulin de la Vierge où habite la famille Groseille; de fort caractère, il est malgré tout victime de racisme de la part de la famille Groseille excepté Maurice. Il a de l'affection pour ce dernier qui lui permet de s'enrichir, notamment par une escroquerie à l'assurance lorsque sa voiture explose délibérément.
- Khadou Fghoul : Latifa
- Ismael Bourabaa : Rachid
- Louise Conte : la grand-mère Le Quesnoy
- Liliane Ledun : Mme Mavial
- Gilles Defacque : le chauffeur de taxi
- Philippe Peltier : l'instituteur
- Pierre Rougier : le professeur d'anglais
- Louis Becker : l'agent EDF #1
- Jean-Pierre Fouillet : l'agent EDF #2
- Luc Samaille : le livreur
- Marc Spillman et Louis-Marie Taillefer : les flics
- Philippe Vacher : le docteur
- Roger Dancoine : le brigadier
- Denis Barbier : le contrôleur SNCF
- Marie-Luce Delesalle et Rina Garfneur : les speakerines
- François Paoli : le journaliste de télévision
- Johan Le Poulain, André Vlaminck et Franck Rossignol : les Labitte et Imor
Production
Genèse et développement
Après avoir fait carrière dans la publicité, Étienne Chatiliez décide de faire un long métrage. Créant un partenariat avec Florence Quentin, ils imaginent ensemble l'histoire de deux familles aux classes opposées dont les destins se croisent. La coscénariste trouve alors l'idée de les réunir par deux enfants échangés à la naissance. Après avoir situé dans un premier temps l'action à Compiègne où Florence Quentin a grandi, les deux auteurs décident finalement de la faire dérouler dans la région du Nord, terre natale d'Étienne Chatiliez, jugeant qu'il y a une meilleure concentration des deux classes sociales. Lui-même a côtoyé des familles bourgeoises et catholiques durant son enfance et déclare avoir remarqué notamment leurs principes d'éducation mais aussi des habitudes alimentaires (d'où la réplique : « Lundi c'est ravioli. »). L'histoire s'inspire d'un fait divers ayant eu lieu à Roubaix dans les années 1950, concernant deux bébés, une fille et un garçon, nés à la maternité de l’hôpital de la Fraternité[2].
Attribution des rôles
Étienne Chatiliez ne souhaite en aucun cas engager des vedettes pour les premiers rôles de son film, prétendant même ne pas imaginer Catherine Deneuve en Mme Le Quesnoy ou encore Josiane Balasko dans le rôle de Mme Groseille. Il souhaite en effet choisir exclusivement des comédiens de théâtre.
Si Hélène Vincent est vite engagée pour le rôle de Marielle Le Quesnoy, le casting pour celui de Jean Le Quesnoy est plus long. Après bon nombre de candidats, André Wilms se présente à son tour. Ayant une personnalité très différente du personnage, l'acteur se rase la barbe, se coupe les cheveux puis enfile un costume très distingué pour se préparer à son rôle. Chatiliez est immédiatement conquis par la prestation de Wilms.
Le réalisateur engage également Catherine Jacob après l'avoir déjà dirigée dans une pub pour le camembert Le Rustique. Il confie le rôle du gynécologue Mavial à Daniel Gélin.
Tournage
Le film est tourné pendant l'été 1987 dans plusieurs localités du Nord : Roubaix, Lille (en face du conservatoire), Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq (le bain se fait d'ailleurs dans la Deûle), et du Pas-de-Calais : Hénin-Beaumont, la scène dans le collège Jean-Macé[3] ou encore à Noyelles-sous-Lens, en haut du terril 94.
Des changements de dernière minute s'effectuent, entre autres Patrick Bouchitey qui donne à son personnage du père Aubergé une facette différente par rapport au script.
Lors de la scène de la réaction de Mavial à la suite de la révélation dans la lettre de Josette, Daniel Gélin devait à l'origine ne prononcer qu'une seule fois la grossière réplique (« La salope ! ») mais Étienne Chatiliez jugeait que ce n'était pas suffisamment comique. Il a donc demandé au comédien de la réciter de manière répétitive.
Bande originale
![]() Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.
Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.
- C'est comme ça (chanson des Rita Mitsouko de ).
- Jésus reviens par Patrick Bouchitey (sur la scène de la fête ; fin du générique de fin).
- Paris en colère par Mireille Mathieu de (Josette réjouie assise face à la mer en compagnie du docteur Mavial en état végétatif, début du générique de fin).
Accueil
Distinctions
- Nomination au César du meilleur film
- César du meilleur scénario original ou adaptation écrit par Étienne Chatiliez et Florence Quentin
- César du meilleur premier film
- Nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle pour Patrick Bouchitey
- César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Hélène Vincent
- César du meilleur espoir féminin pour Catherine Jacob
Autour du film
- De tous les enfants du film, seuls Benoît Magimel et Tara Römer ont poursuivi une carrière de comédien. Magimel est devenu un des acteurs fétiches du réalisateur Florent-Emilio Siri et s'est imposé notamment avec Les Rivières pourpres 2 : les Anges de l'Apocalypse et Les Chevaliers du ciel. Quant à Römer, il est apparu, entre autres, dans Raï et Taxi avant de mourir dans un accident de la route le à l'âge de 25 ans.
- Étienne Chatiliez a eu l'idée de choisir la chanson Paris en colère dans le but d'exprimer d'une certaine façon qu'un homme doit être averti de ce qu'il peut risquer en allant vers une femme.
- Le film pose la question de l'inné et de l'acquis.
- En 1995, la sitcom de France 2, Les Gromelot et les Dupinson est vaguement inspirée du film[5] - [6].
- Le dessin animé japonais Nathalie et ses amis (1971) présente un scénario très similaire[7].
Notes et références
- « LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE », sur www.cinema-francais.fr (consulté le )
- Bernard Termeulen, « Des bébés échangés », sur Bibliothèque numérique de Roubaix, (consulté le )
- « Vie est un long fleuve tranquille (La) (1988) - Lieux de tournage », sur L2TC.com
- « La vie est un long fleuve tranquille - critiques presse », sur Allociné (consulté le ).
- Ariane Chemin, « “Les Gromelot et les Dupinson” dans la règle des sitcoms », Le Monde, (lire en ligne) : « Riches et pauvres, mis à la sauce télévisée façon « Maguy » adaptés au goût des années 90 façon La vie est un long fleuve tranquille, le grand succès cinématographique de l'année 1988, réalisé par Etienne Chatiliez. »
- Jacqueline Beaulieu, « Les Groseille et Duquesnoy du pauvre », Le Soir, (lire en ligne) : « Les Gromelot et les Dupinson sont les Groseille et les Duquesnoy du pauvre, ces personnages de «La vie est un long fleuve tranquille», qui sont devenus quasiment des entités. »
- « Nathalie et ses Amis », sur Planete Jeunesse
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives à l'audiovisuel :
- Allociné
- Centre national du cinéma et de l'image animée
- Ciné-Ressources
- Cinémathèque québécoise
- Unifrance
- (en) AllMovie
- (pl) Filmweb.pl
- (en) IMDb
- (en) LUMIERE
- (de) OFDb
- (en) Rotten Tomatoes
- (mul) The Movie Database