Henri de Joyeuse
Henri de Joyeuse, duc de Joyeuse, comte du Bouchage, est un prêtre capucin français, nommé en religion « Père Ange », né le à Toulouse et mort le à Rivoli en Italie. Il a aussi été lieutenant général de la province du Languedoc puis maréchal de France en 1595[1].

| Duc de Joyeuse | |
|---|---|
| - | |
| Prédécesseur | |
| Successeur | |
| Naissance | |
|---|---|
| Décès |
(à 44 ans) Rivoli |
| Activité | |
| Famille | |
| Père | |
| Mère |
Marie de Batarnay (d) |
| Fratrie | |
| Conjoint |
Catherine de Nogaret de la Vallette (d) |
| Enfant |
| Ordre religieux | |
|---|---|
| Grade militaire | |
| Distinctions |
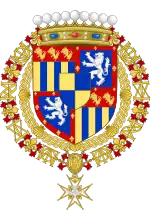
Biographie
Henri de Joyeuse est le fils de Guillaume de Joyeuse et de Marie de Batarnay du Bouchage. C'est également le frère d'Anne de Joyeuse et du cardinal François de Joyeuse. Il rejoint ses frères à la cour d'Henri III, qui le nomme grand maître de sa garde-robe.
Le , âgé de 18 ans, il épouse Catherine de Nogaret de La Valette, âgée de 15 ans, sœur du duc d'Épernon. Leur fille, Henriette-Catherine de Joyeuse, naît au Louvre le . La mort de Catherine, le , convainc le jeune homme de devenir capucin, le , sous le nom de Père Ange. Henri III se précipite au couvent des Capucins, et, découvrant son ancien favori « la tête rasée et les pieds nus, peu s'en fallut qu'il ne tombât pasmé à la renverse ». Le suivant deux de ses frères tombent à la bataille de Coutras.
Le père Ange rejoint la Ligue catholique : le , il quitte l'habit et se voit nommé lieutenant général de la province du Languedoc. Toutefois, sous l'influence de son frère François, il finit par négocier son ralliement à Henri IV en (édit de Folembray), qui le crée maréchal de France. De nouveau capucin à partir de 1599[2], Henri de Joyeuse (Père Ange) devient un prédicateur renommé et un mystique sujet à des extases. Il est un des premiers à remarquer la valeur de François Leclerc du Tremblay, en religion « Père Joseph », future éminence grise de Richelieu[3].
Il meurt le , au couvent des capucins de Rivoli en Italie. Son corps fut ramené à Paris et inhumé dans l'église du couvent des Capucins Saint-Honoré (ses ossements furent sans doute transférés vers les catacombes de Paris en 1804[4]).
Il avait fait don à son ordre d'une statuette de Notre Dame de Paix toujours visible à Paris dans la chapelle de la congrégation des Sacrés Cœurs de Marie et Jésus[5].
« »
Notes et références
- Jacques de Caillières, Histoire du duc de Joyeuse ou le Courtisan predestiné, , 456 p. (lire en ligne), p. 10.
- De Vaissière, Pierre, « La seconde profession de Frère Ange, capucin, duc de Joyeuse, pair et maréchal de France (1599-1608) », Revue d'histoire de l'Église de France, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 12, no 54, , p. 34-52 (DOI 10.3406/rhef.1926.2382, lire en ligne, consulté le ).
- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9771562k/f17.item.r=duch%C3%A9
- « Couvent des Capucines - extrait de : M. THIERY, Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, tome 1, Paris, Hardouin et Gattey, 1787, p. 129-130 » [archive du ], sur nicolaslefloch.fr (consulté le ) : « Qu’advint-il des ossements qui ceux qui s’étaient fait enterrer dans le couvent ? On lit dans la Description des catacombes de Paris : précédé d'un précis historique sur les catacombes de tous les peuples..., de Louis-Étienne-François Héricart de Thury (Rossange et Masson, 1815, p. 208) : « Les ossements de ce cloître et de l'église des Capucines furent portés aux catacombes, le 29 mars 1804, ainsi que l'annonce l'inscription qui a été placée au milieu de leur ossuaire particulier. » Selon Jacques Hillairet (Dictionnaire historique des rues de Paris, (Nouvelle édition mise à jour, avec le Supplément rédigé en collaboration avec Pascal Payen-Appenzeller inséré à la fin de chaque volume, Éditions de minuit, 1963), le caveau de Mme de Pompadour aurait été laissé sous la chaussée. ».
- « Notre-Dame de Paix » [archive du ], sur ssccpicpus.fr, congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie (consulté le ) : « “Notre Dame de Paix” se trouve à deux pas de la place de la Nation, dans la rue de Picpus, au numéro 37 (chapelle Notre-Dame de Paix, entrée du cimetière de Picpus, métro / RER Nation). Louis XIV lui doit sa guérison en 1658. Notre Dame de Paix était la madone la plus vénérée par les Parisiens avant la Révolution. La dévotion à Notre Dame de Paix s'est ensuite répandue dans le monde entier grâce à la congrégation des Sacré Cœurs (Picpus). ».
Voir aussi
Bibliographie
- Jean Cruppi, Le père Ange, duc de Joyeuse, maréchal de France et capucin, Paris, Librairie Plon, , 268 p. (lire en ligne).
- Christian Fantoni, « Aubigné et frère Ange de Joyeuse : derrière l’homme, la rhétorique », Albineana, Cahiers d'Aubigné, no 23 « Calomnie, rumeur et désinformation : l'Histoire du Père Henri, jésuite et sodomite », , p. 365-380 (lire en ligne).
- Nancy Oddo, « Le Duc Henri de Joyeuse devenu « frère Ange » : une héroïsation entre histoire et fiction », Seizième Siècle, no 4, , p. 237-253 (lire en ligne).
- Pierre de Vaissière, « La seconde profession de Frère Ange, capucin, duc de Joyeuse, pair et maréchal de France (1599-1608) », Revue d'histoire de l'Église de France, t. 12, no 54, , p. 34-52 (lire en ligne).
- Pierre de Vaissière, Messieurs de Joyeuse (1560-1615) : portraits et documents inédits, Paris, Albin Michel, coll. « Âmes et visages d'autrefois », , 351 p. (présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].