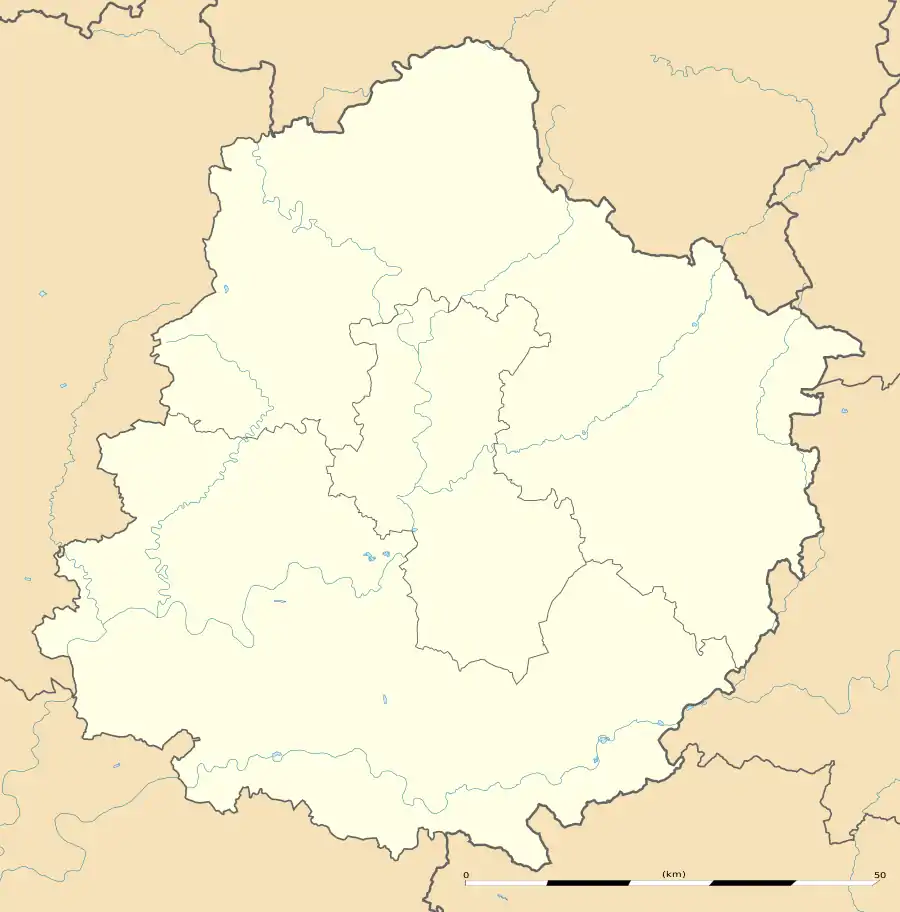Château de Montmirail (Sarthe)
Le château de Montmirail, situé dans le Perche-Gouët (dans l'est de la Sarthe), culminant à 320 mètres, surplombe le village de Montmirail.
| Château de Montmirail | |

| |
| Début construction | XIe siècle |
|---|---|
| Fin construction | XIXe siècle |
| Protection | |
| Coordonnées | 48° 06′ 11″ nord, 0° 47′ 25″ est |
| Pays | |
| Région historique | Pays de la Loire |
| Département | Sarthe |
| Commune | Montmirail |
Historique
Les grands événements
Le château est bâti sur une motte castrale (ou une tour de bois sur un mont). C'est au IXe siècle que ce que l'on nomme un « château fort » est attesté à Montmirail. Durant cette période ont lieu les invasions normandes (vikings). Une résistance se met en place autour des possessions de l'évêché de Chartres, dont font partie les terres de Montmirail. Pour « service rendu », l'évêque de Chartres fait don des terres du château à la famille Gouët, qui reste en possession des terres pendant près de 600 ans. Cette petite province du Perche est nommée « Perche Gouët » ; elle est constituée de 35 paroisses et cinq baronnies : Alluye-La-Belle, Montmirail-La-Superbe, la Bazoche-La-Gaillarde, Brou-La-Riche et Authon-La-Pouilleuse.
C'est sous l'un des descendants de Guillaume Gouët, en 1169, que le château accueille la rencontre entre le roi de France Louis VII le Jeune, Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre et Thomas Becket, archevêque de Canterbury[1]. Les deux rois ont en commun la même épouse : en premières noces, Aliénor d'Aquitaine avait épousé le roi de France puis avait rompu ses noces pour se remarier avec Henri II Plantagenêt le roi d'Angleterre. Le royaume de France n'est alors plus qu'une enclave dans le royaume anglais. Le site de Montmirail est, de ce fait, idéalement situé pour accueillir les deux souverains, puisqu'il est à la frontière entre les deux territoires.
Deux raisons ont motivé cette entrevue :
- le roi d'Angleterre et ses deux fils (Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre) devaient rendre hommage au roi de France ;
- le roi de France espérait réconcilier Thomas Becket et le roi d'Angleterre.
Thomas Beckett était l'archevêque de Canterbury. À l'origine de la discorde, la place d'archevêque de Beckett. En effet, Henri II l'avait nommé archevêque dans l'espoir de pouvoir garder une mainmise sur la religion de son royaume. Mais Thomas Beckett a menacé d'excommunication le roi d'Angleterre. Ainsi, il se voit obligé de venir sous la protection du roi de France, qui souhaite réconcilier les deux hommes.

Cette rencontre ne va aboutir qu'à l'assassinat de Thomas Becket, dans sa cathédrale de Canterbury, par deux chevaliers, armés de la main du roi d'Angleterre.
Au début du XIVe siècle, au cours d'un grand itinéraire le menant à travers tout le royaume, le roi Philippe IV le Bel s'arrêta au château de Montmirail, le .
Au cours des nombreux conflits illustrant la Guerre de Cent Ans, le château de Montmirail lors de la bataille de Baugé exposé aux assauts des Anglo-Bourguignons connu en un fait majeur à la suite de la mort de Thomas de Lancastre (1er duc de Clarence) . Voici selon les chroniques rendues par l'historien parisien Nicole Gilles, l'évocation de cet important fait historique qui vit la délivrance du château de Montmirail par l'armée franco-écossaise commandée par Gilbert Motier de La Fayette et John Stuart de Buchan : « Puis s'en alla mondit seigneur le dauphin (Charles VII) régent au Mans et prindrent les françois, le chastel de Montmiral et la ville de Galardo (Gallardon) sur les bourguignons qui estoient alliez aux anglois. Et après s'en retourna mondit seigneur le dauphin à Amboise ». Dans sa Chronique de Charles VII, l'historien Jean Chartier confirma également à l'identique cette prise du château de Montmirail.
Au début du XVIe siècle, le château arriva en 1505 dans l'héritage de dame Marie de Melun d'Épinoy, descendante du connétable Louis de Luxembourg-Saint-Pol, à qui appartint cette baronnie du Perche-Gouêt. Revenue de son mariage en Flandre en 1505 avec Jean V de Bruges, Marie de Melun et son premier époux apportèrent quelques transformations, dont le fameux pignon flamand à degrés (Pignon à gradins) du château, directement inspiré de l'architecture brugeoise. L'église paroissiale de Montmirail conserve à cet effet un témoin inestimable de ce mariage fait en 1505 : le vitrail (début XVIe siècle) du mariage de Marie de Melun et de Jean de La Gruthuse, parfois appelé le retable, épargné pendant les guerres de religion des déprédations des iconoclastes. Arrivée toute jeune du pays de Tournai, Marie de Melun n'eut en Perche-Gouêt qu'un seul parent, Philippe de Luxembourg dit Le Cardinal du Mans. Devenue veuve en 1512 de Jean V de Bruges de La Gruthuse, Marie de Melun baronne de Montmirail après l'organisation de somptueuses funérailles rendues à son premier époux à l'abbaye de Saint-Riquier, se remaria en 1513 au célèbre maréchal de la Palice. Le légendaire compagnon d'armes de François Ier et du chevalier Pierre Terrail de Bayard, Jacques II de Chabannes et Marie de Melun commencèrent vers cette époque la première édification du castelet en style Renaissance.
L'édifice passe ensuite aux mains de Louis-Armand de Condé, prince de Conti[1]. Celui-ci a épousé la fille illégitime de Louis XIV : Marie-Anne de Bourbon, la princesse de Conti[2]. Cette-dernière hérite du château à la mort de son époux en 1685. Elle vend le château au marquis de Neuilly en 1719. À partir de ce jour, le château ne sera hérité que par les femmes, d'où les changements de nom successifs sans pour autant que le monument ne change de mains.
Les grandes figures du château
- Guillaume Ier Gouët (1005-1060).
- Guillaume III Gouët (1079-1140).
- Louis VII le Jeune (1120-1180).
- Henri II Plantagenêt (1133-1189).
- Thomas Becket (1118-1170).
- Charles IV d'Anjou, comte du Maine.
- Jeanne de Bretagne (1296-1364) reçu en 1323, comme douaire , la seigneurie de Montmirail en Perche-Gouet.
- Louis de Luxembourg-Saint-Pol (1418-1475), connétable de France.
- Marie de Melun d'Épinoy (1465-1553), fille d'Isabelle de Luxembourg (nièce du Connétable de Saint-Pol, cité ci-dessus), née en Tournaisis en 1465 au château d'Antoing, anciens Pays-Bas espagnol au XVIe siècle et actuellement en Belgique.
- Jean V de Bruges (1453-1512), seigneur de La Gruthuse, sénéchal royal d'Anjou, capitaine du Louvre et gouverneur de la Picardie.
- Jacques II de Chabanne, maréchal de la Palice (1470-1525), second époux en 1514 de Marie de Melun, dame de Montmirail.
- Charles de Chabannes, reçoit en héritage le (ou 1550), la baronnie de Montmirail, selon le testament fait au château de Montmirail par ladite dame Marie de Melun sa mère, veuve en 1525 de M. de La Palice.
- René de Bruges de La Gruthuse, prince de Stennhuyse et Béatrix de La Chambre, demoiselle d'honneur de la reine Catherine de Médicis.
- Catherine de Bruges de La Gruthuse et Louis de La Baume, comte de Saint-Amour, chevalier en 1576 de l'ordre de l'Annonciade.
- Emmanuel Philibert de La Baume, comte de Saint-Amour, marquis de Saint-Genis et Yenne. Ce fils aîné de Catherine de Bruges épousa en 1599 Hélène Perrenot de Granvelle, nièce du chancelier Antoine Perrenot de Granvelle.
- Jacques Nicolas de La Baume, comte de Saint-Amour, marquis d'Yenne, gouverneur de Namur et de Dole. À la mort de son père Emmanuel-Philibert de La Baume survenue en 1622, il reçut de celui-ci en héritage les trois baronnies du Perche-Gouet : Montmirail, La Bazoche et Authon. Peu avant sa mort le , Jacques Nicolas de La Baume Saint-Amour vend la seigneurie de Montmirail à Jean Perrault de Montrevault.
- Jean Perrault de Montrevault, président de la Chambre des comptes de Paris.
- Louis-Armand de Condé, prince de Conti (1661-1685).
- Pierre Le Pesant de Boisguilbert (1646-1714).
- Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti (1666-1739).
- Le marquis de Neuilly.
Architecture
Les parcs et les dépendances
L’aspect extérieur du château porte les témoignages de plusieurs siècles d’architecture. Entre château d'habitation et château fort, le site de Montmirail est exceptionnel : toutes les époques de construction sont représentées. Le soubassement (cachots et salles d'armes) date des XIIe et XVe siècles. Les façades, bien que remaniées, et une des portes datent de la Renaissance (XVIe siècle). La grande Tour (ou observatoire) a été construite au XIXe siècle et s'élève à une trentaine de mètres au-dessus du sol. Depuis la terrasse du parc, la vue sur le Perche Sarthois est panoramique. Sont toujours debout les écuries, le pigeonnier, les métairies et le logement du jardinier. Enfin, une glacière — la plus grande du département —, permettait encore au début du siècle dernier de conserver les aliments.
Intérieur
Dans le château, la même superposition d'époques se retrouve. Les salles d'armes et l’un des cachots datent du XVe siècle. Les deux autres cachots, plus profonds, datent du XIIe siècle. À l'étage, le château d'habitation prend le dessus sur l'édifice médiéval : la salle à manger date du XVIIIe siècle et est garnie d'un poêle hollandais, d'un lustre et de porcelaines diverses datant de la même époque. Les pièces voisines sont des salons datant des XVIIe – XVIIIe siècles. L'un d'eux (le Grand Salon) est classé, ainsi que ses fauteuils, consoles en marbre et boiseries. Enfin, le tableau du portrait de la princesse de Conti est toujours en place dans le château.
Le château au XXIe siècle
Un château classé
.jpg.webp)
Le château a fait l'objet de plusieurs inscriptions au titre des monuments historiques[3] :
- depuis le pour les façades et les toitures ainsi que deux pièces du XVIIIe siècle ornées de boiseries ;
- depuis le pour l'ensemble du bâtiment ainsi que le parc et le jardin ;
- depuis le pour des bâtiments annexes (logement du jardinier, métairie).
Restaurations successives
Le château est bien conservé et a toujours été habité. Les salles d'armes et les cachots ont été restaurés il y a 20 ans. Le sol en terre battue a été déblayé et refait en dur et les murs ont été nettoyés. Rien n'a été re-sculpté ou rebouché mis à part les endroits où l'électricité a été installée. À l'étage, le grand salon a été nettoyé dans les années 1970, surtout les boiseries classées.
Actuellement, le château est de nouveau en cours de rénovation à la suite du changement de propriétaire intervenu fin 2015. Il est ouvert au public.
Notes et références
- « CHÂTEAU DE MONTMIRAIL », sur Sarthe Tourisme (consulté en )
- « Château de Montmirail », sur Ilatou Sarthe (consulté en )
- « Château », notice no PA00109885, base Mérimée, ministère français de la Culture
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à l'architecture :