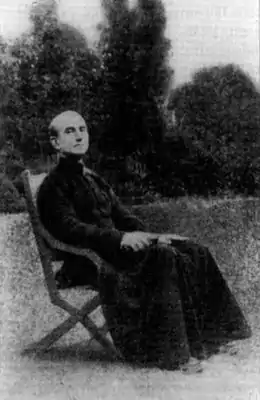Abbé Chaupitre
Jean-Marie-Victor Chaupitre, dit l’abbé Chaupitre, né le à Gennes-sur-Seiche et mort le à Naples, est un prêtre catholique et homéopathe français.
L’homéopathie
Pressentie par Hippocrate, développée par Samuel Hahnemann au début du XIXe siècle, la pseudoscience de l’homéopathie commence à trouver un écho favorable dans la France d’alors. Elle doit en partie sa réputation à plusieurs guérisons intervenues dans l’entourage proche de l’empereur Napoléon III. Elle était jusqu’ici inconnue de l’abbé. Chauvel gagne un disciple fervent auquel il fait partager sa passion. L’abbé planche sur les principes de l’homéopathie. Il se met à préparer des "remèdes". Le mystère persiste sur sa façon de procéder : ramassait-il lui-même les plantes médicinales ? Exécutait-il les macérations, les dilutions ou se procurait-il les produits finis ?
Les procès
Au tout début de 1908, l’abbé Chaupitre diffuse gratuitement ses préparations. (Controverse suivant les sources : Elles ne suscitent pas, au départ, un intérêt particulier de la part de la population) Le coup de pouce va venir de la guérison d’une enfant du voisinage, que l’on dit condamnée par une méningite. La nouvelle fait grand bruit. Alcide Liorit, secrétaire et comptable de Chaupitre, qualifie ce retournement de « sensationnel ». L’assistant avait lui-même été soigné par l’abbé, à l’approche de son mariage, pour un douloureux abcès dentaire. L’infection régresse et l’épouse pourra finalement arborer un joli sourire, ce que l'assistant attribue à l'effet du traitement. Ceci vaut à l'abbé sa première comparution devant un tribunal en , sur plainte du syndicat des médecins d’Ille-et-Vilaine et de celui des pharmaciens. Accusé d’exercer illégalement la médecine puisqu’il ne possède aucun diplôme, l’abbé répond que ce n’est pas le diplôme qui guérit, ni même le médecin, mais le médicament. Il accuse ses détracteurs d’incompétence et de s’enrichir sur le dos des patients. L’abbé est aussi rappelé à l’ordre par sa hiérarchie. Un paroissien rapporte que Chaupitre aurait un jour conseillé à une femme stérile de changer de conjoint si elle n’avait pas de résultat, malgré la prise de l’une de ses formules. En 1920, la tension monte encore d’un cran entre l’abbé et le monde de la santé. Chaupitre fait placarder des affiches intitulées « Un mensonge universel ». Il s’attaque directement à la médecine. Procès et condamnations s’enchaînent, jusqu’à conduire Chaupitre en prison en 1923 et 1925, à chaque fois pendant 3 mois. Sa santé est altérée, mais manifestations et pétitions en sa faveur se succèdent. Ses meubles, qu’il est contraint de vendre à plusieurs reprises, sont rachetés par ses partisans et lui sont restitués.
En 1924, le Dr Emmanuel Porteu de la Morandière, qui exerce aussi comme pharmacien, tombe en septicémie. Les soins prodigués par l’abbé lui auraient permis de quitter cet état critique en quelques jours. Cette fois encore, on peut s’interroger sur la totale exactitude des faits rapportés qui ont forgé la « légende » Chaupitre. À son tour, Porteu de la Morandière est convaincu que l’homéopathie peut intervenir comme une solution alternative à la médecine traditionnelle. Il va lui aussi la pratiquer, dans son cabinet médical ou en donnant des consultations à travers tout le pays.
À l’occasion d'une nouvelle condamnation, en 1926, Chaupitre défie la justice en faisant placarder une affiche avec l’inscription « Il n’ira pas en prison ». Cela lui vaudra un alourdissement de sa peine. Aussi, à la veille de son arrestation, il prend la fuite et le chemin de l’exil. En 1928, fatigué d’avoir à se battre contre le pouvoir médical en place et éprouvé par les mois d’emprisonnement, l’abbé évite de peu une nouvelle arrestation et choisit de s’exiler en Belgique.
Naissance d’un laboratoire officiel
Un troisième personnage clé va permettre la montée en puissance des "remèdes" de Chaupitre, le pharmacien Louis Maupy. Son officine, située boulevard Haussmann à Paris, va devenir le siège du laboratoire de l'abbé. La fabrication des « petites bouteilles », selon la propre expression de l’abbé, lui est confiée. Les flacons sont bientôt produits sur une grande échelle et doivent alors revêtir une étiquette avec le portrait et la signature de l’abbé de façonque les malades ne soient pas trompés par les imitations. En , la marque Abbé Chaupitre est déposée et le Laboratoire des Médicaments Homéopathiques du même nom est créé. Cette association offre un statut plus légitime à l'activité de Chaupitre. Celui-ci aura ferraillé pendant une vingtaine d'années, à coups de déclarations parfois jugées injurieuses, pour faire face aux accusations des deux professions de santé.
Liorit, Maupy et Porteu de la Morandière prennent le relais de l'ecclésiastique, qui leur confie l'exploitation de son activité. Une nouvelle usine de fabrication est ouverte en 1931 à Boulogne-Billancourt. Las d'en découdre avec ses détracteurs et menacé d'emprisonnement, l'abbé décide de jeter l'éponge. Il s'enfuit, parcourant l'Europe et le Proche-Orient. Chaupitre se rend ainsi en Belgique, en Grèce, en Autriche et en Italie. Dans ce pays, il visite Venise, Rome, Naples et l'Etna. Il s'installe même quelque temps à San Remo. Également au programme de son périple, l'Égypte et la Palestine. Le , à Naples, à la sortie d'une église où il venait de célébrer la messe, l'abbé Chaupitre est victime d'un malaise. Il décédera dans sa chambre d'hôtel, «son chapelet dans les mains», témoigne le Dr Porteu, son acolyte. Les funérailles ont lieu en mai dans son village natal, en Bretagne, où la foule est nombreuse à venir lui rendre hommage. Sur sa tombe, cette épitaphe : « A la mémoire de M. l'Abbé Chaupitre (1859-1934). Il mit tout son cœur de prêtre et sa science médicale à soulager les maladies humaines qui de partout se présentaient à lui. »
De l'almanach aux vitrines des officines
Le laboratoire de l'abbé Chaupitre se lance dès 1933 dans la publication d'almanachs. Alors très en vogue, ces calendriers sont utilisés par les colporteurs. Ils peuvent contenir jusqu'à 200 pages de conseils pratiques, recettes de cuisine, jeux, mais aussi récits de voyage. Les collaborateurs de Chaupitre y joignent une liste des maladies ciblées par l'homéopathie. Figurent également les précieux témoignages de patients guéris par la science hahnemannienne, ainsi qu'une mise en garde contre les imitations. Le Dr Porteu, qui a hérité du laboratoire Chaupitre, y glisse même un bon de consultation. Celui-ci est à valoir dans plusieurs grandes villes de France. En 1934, année du décès de l'abbé, ce dernier évoquait dans l'almanach les voyages effectués à la fin de sa vie. L'édition de 1935 est l'occasion de rendre hommage à Chaupitre et le nouveau flacon de la gamme est dévoilé l'année suivante. En 4 ans, le tirage du calendrier passe de 50 000 à 200 000 exemplaires. Puis l'almanach va s'inscrire plus encore dans son temps. En 1938, la couverture présente l'Exposition internationale des arts et techniques qui s'est tenue l'année précédente à Paris. En 1940, le ton est plus grave : l'ordre de mobilisation générale s'affiche en première page. Les soldats sont encouragés à emporter certaines formules qui favoriseront leur guérison et leur convalescence. Ce sera le dernier calendrier édité par le laboratoire Chaupitre. Restent les brochures, traduites dans plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand, le grec, l'italien et l'arabe. Elles feront connaître la marque bien au-delà des frontières de la Bretagne, son berceau. Brochures, plaquettes et almanachs sont publiés à Dinard, dans une imprimerie qui devait appartenir à la famille Liorit, proche de Chaupitre. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, murs et vitrines des pharmacies se couvrent de panneaux réalisés en émail ou en bois. Le laboratoire se dote alors d'une force commerciale conséquente qui comptera le père de l'écrivain Boris Vian. Après la guerre et l'obtention des visas de commercialisation, la communication sur la marque deviendra plus encadrée.
Le début de l'aventure commerciale
L'abbé n'est plus de ce monde lorsque débute véritablement l'aventure commerciale des remèdes qui portent encore son nom. En 1937, la production journalière passe à 5 000 flacons, contre seulement 300 de son vivant. Les préparations du laboratoire bénéficient d'une communication très active. C'est là tout un art que les successeurs de l'abbé maîtrisent aussi bien que lui, excellant dans l'écriture et la prise de parole en public. Plusieurs éditions de la « Méthode homéopathique de M. l'Abbé Chaupitre » sont publiées. Elles comportent des recommandations pour améliorer l'hygiène et un répertoire des maladies. Pour chacune d'elles, il est préconisé un complexe homéopathique, auquel est attribué un numéro.
Conformément à la réglementation entrée en vigueur à partir de 1942, le laboratoire doit obtenir des visas pour continuer à exploiter ses formules. À cause du coût, seulement 45 visas sur les 97 présentations existantes seront demandés et finalement attribués. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise se fixe officiellement à Boulogne-Billancourt. Au début des années 1950, elle devient le Laboratoire d'Homéopathie Complexe (LHC). Au fil du temps, plusieurs formules sont abandonnées, notamment pour raison règlementaire : certaines indications thérapeutiques deviennent impossibles à justifier. Pour celles qui subsistent, le taux d'alcool est modifié, de même que le volume des flacons, qui passe à 20 ml. Des dilutions sont modifiées, certaines souches sont supprimées ou ajoutées en fonction de l'évolution des connaissances et des problèmes d'approvisionnement ou de fabrication.
Après son acquisition par le groupe Arkopharma, en 1996, l'activité est transférée à Carros, dans les Alpes-Maritimes. L'entité Chaupitre complète ainsi l'offre du laboratoire homéopathique Ferrier. La marque est devenue l'une des bannières du géant français de la phytothérapie, les laboratoires Arkopharma.
Voir aussi
Articles connexes
Sources
- Les fameuses formules de l’abbé Chaupitre, Eric FOUASSIER ()
ordre.pharmacien.fr pagesperso-orange.fr
- Le Quotidien du Pharmacien, article de Matthieu VANDENDRIESSCHE du 15/05/2008
Bibliographie
- Bernard Lebeau, L’abbé Chaupitre, un pionnier de l’homéopathie en Bretagne, Mémoires de la Société Archéologique Ille-et-Vilaine, no 90, 1988.