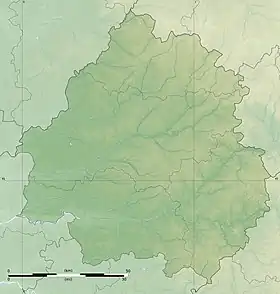La Ferrassie
La Ferrassie est un site préhistorique français qui se situe sur la commune de Savignac-de-Miremont, dans le département de la Dordogne. Il comporte trois gisements dont une grotte, un petit abri et le « grand abri de la Ferrassie » qui est le plus important. La Ferrassie fait partie des sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère. Il a livré de rares vestiges de huit individus datant du Châtelperronien, trouvés dans un riche enregistrement archéologique[1] - [2], source d'informations nouvelles sur une longue période de temps où se sont succédé des Néandertaliens et des Homo sapiens. Récemment les collections de plusieurs institutions ainsi que des archives du site ont fait l'objet de nouvelles études, parallèlement à de nouvelles fouilles ainsi qu'à des analyses nouvelles ont notamment permis d'en savoir plus sur « l'enfant La Ferrassie »[3].
| La Ferrassie | ||||
 Coupe sagittale témoin du Grand abri de La Ferrassie en 2005 | ||||
| Localisation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Nouvelle-Aquitaine | |||
| Département | Dordogne | |||
| Commune | Savignac-de-Miremont | |||
| Type | grotte et abris | |||
| Protection | ||||
| Coordonnées | 44° 57′ 07″ nord, 0° 56′ 17″ est | |||
| Géolocalisation sur la carte : Dordogne
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
Géolocalisation sur la carte : France
| ||||
| Histoire | ||||
| Époque | Châtelperronien | |||
Situation
La Ferrassie se trouve près de la route D32E5 reliant Savignac-de-Miremont (2,3 km au nord à vol d'oiseau) et Le Bugue (4 km au sud)[4] .

Le site de La Ferrassie au bord de la D32E5
Historique

Crâne d'Homo neanderthalensis,
La Ferrassie.
Les premières fouilles y sont réalisées en 1896 par Denis Peyrony et Louis Capitan jusqu'en 1929, puis par Henri Delporte de 1968 à 1973[5].
Le site est classé au titre des monuments historiques par arrêté du [6].
Le , la vallée de la Vézère est classée par décret grand site d'Aquitaine. Ce classement intègre également le site de la Ferrassie et la grotte de Rouffignac[7].
Le site fait l'objet d'une nouvelle campagne de fouilles de trois ans à partir de 2015[8]. Les niveaux aurignaciens ont notamment révélé, sous les déblais des fouilles précédentes, « des outils en silex et en os, des ossements, essentiellement de rennes »[8], et des blocs gravés de figurations schématiques[9].
Stratigraphie

La Ferrassie.
La séquence stratigraphique du grand abri de La Ferrassie, haute de près de 10 m, comporte une succession de couches des Paléolithique moyen et supérieur. Elle a joué un rôle majeur lors de la définition de la succession chronologique des industries de cette dernière période.
La base du dépôt a livré des industries ayant donné leur nom à l'un des faciès du Paléolithique moyen, le « Moustérien de type Ferrassie » (débitage Levallois, nombreux racloirs et pointes, rares denticulés, bifaces absents). Les couches moustériennes ont également livré les restes de huit Néandertaliens[2], dont deux adultes, quatre enfants (de 2, 3 et 10 ans environ), un nourrisson et un fœtus n'ayant sans doute vécu que quelques heures. Le crâne de l'un des adultes est particulièrement complet et bien conservé. Les individus juvéniles découverts par Peyrony reposaient apparemment dans des fosses correspondant à des sépultures. L'une des fosses était couverte par une dalle. Le fœtus se trouvait dans un monticule et était accompagné de beaux outils de silex, considérés comme un dépôt funéraire lors de leur découverte. L'ancienneté des fouilles et l'absence d'enregistrement précis limitent toutefois les interprétations.
La séquence comporte ensuite quelques niveaux attribués au Châtelperronien, marqué par une association lithique faite de formes moustériennes, de pointes du type de Châtelperron, de « lames à gorges » et de grattoirs du « type de Tarté ». Cette association a également été rencontrée à Châtelperron (Allier), Germolles (Mellecey, Saône-et-Loire), la Roche-au-Loup (Merry-sur-Yonne, Yonne), Haurets (Ladaux, Gironde) et Gargas (Aventignan, Hautes-Pyrénées)[10] - [11].
Le sommet de la séquence comprend différentes couches attribuées par Denis Peyrony au Périgordien supérieur, aujourd'hui appelé Gravettien.
Sépultures
Les sépultures incluent huit individus[2] identifiés de LF1 à LF8 :
- La Ferrassie 1 (1909) : un homme adulte, d'une quarantaine d'années, la tête orientée à l'ouest ;
- La Ferrassie 2 (1910) : une femme adulte, de 25-35 ans, la tête orientée à l'est, placée dans le même alignement que LF1, tête contre tête ;
- La Ferrassie 3 (1912) : un enfant d'une dizaine d'années, dans une fosse ;
- La Ferrassie 4 et 4 bis (1912) : un nouveau-né de moins d'un mois et un fœtus parvenu à terme, dans une même fosse ;
- La Ferrassie 5 (1920) : un fœtus de 7 mois, accompagné de deux racloirs et d'une pointe ;
- La Ferrassie 6 (1921) : un enfant de 3 à 5 ans, sous une dalle calcaire marquée de cupules. Le crâne était séparé du corps de plus d'un mètre ;
- La Ferrassie 8 (1969) : un enfant de 2 ans juste au-dessus de LF5, près de la paroi de l'abri[2].

Le Grand abri. Sous les tamis à gauche, le site de LF1.
Notes et références
- J.-J. Hublin, vidéo conférence 2021, 49'03 - 49'54.
- La Ferrassie, sur hominides.com.
- « Comment se comportaient les Néandertaliens ? Conférence du paléoanthropologue Antoine Balzeau », (consulté le )
- « La Ferrassie » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques » et « Limites administratives » activées. Vous pouvez bouger la carte, zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette sous l'onglet "sélection de couches").
- Delporte et al. 1977
- « Gisement préhistorique de la Ferrassie », notice no PA00082992, base Mérimée, ministère français de la Culture.
- Léa Sanchez, « Le plus grand site classé d'Aquitaine », Sud Ouest, édition Périgueux, (consulté le ), p. 17.
- Hervé Chassain, « Dordogne : des fouilles relancées sur le site préhistorique de La Ferrassie », interview de Laurent Chiotti, Sud Ouest édition Dordogne, (consulté en ), p. 13.
- « Gisement de La Ferrassie », sur musee-prehistoire-eyzies.fr, Musée national de Préhistoire, Les Eyzies (consulté le ).
- [Peyrony 1922] Denis Peyrony, « Nouvelles observations sur le Moustérien final et l'Aurignacien inférieur », Compte-rendu de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences, . Cité dans Pesesse 2018, paragr. 15.
- [Pesesse 2018] Damien Pesesse, « Le Périgordien, quelle erreur ! », Paléo, no 29, , p. 179-199 (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté en ), paragr. 15.
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
- [Delporte & al. 1977] Henri Delporte, Guy Mazière et François Djindjian, « L'Aurignacien de La Ferrassie. Observations préliminaires à la suite de fouilles récentes », Bulletin de la Société préhistorique française. Études et travaux, vol. 74, no 1, , p. 343-361 (DOI 10.3406/bspf.1977.8457, lire en ligne [sur persee]).

- [Delporte & al. 1984] Henri Delporte, Le grand abri de la Ferrassie : fouilles 1968-1973, Paris, Laboratoire de paléontologie humaine et de préhistoire, .
- [Goldberg et al.] (en) Paul Goldberg, Vera Aldeias, Laurent Bruxelles, Guillaume Guérin, Jean-Jacques Hublin, Shannon McPherron, Alain Turq, Isabelle Crevecoeur, Harold L. Dibble et al., « On the context of the Neanderthal Skeletons at La Ferrassie: New evidence on old data », sur academia.edu.
- [Maureille et al. 2004] Bruno Maureille et al. (préf. Roland Schaer), Les premières sépultures (série « Les origines de la culture »), éd. Le Pommier / Cité des sciences et de l'industrie, coll. « Le Collège De La Cité » (no 11), (réimpr. 2013), 144 p. (ISBN 2-7465-0203-8, 2-7465-0203-8 et 2746506742, présentation en ligne). (Ce livre fait suite à une conférence tenue à la Cité des sciences et de l'industrie (Paris, 19e arrond.) le 18 octobre 2003.)
- [Maureille & Van Peer 1998] Bruno Maureille et Philip Van Peer, « Une donnée peu connue sur la sépulture du premier adulte de La Ferrassie (Savignac-de-Miremont, Dordogne) », Paléo, no 10, , p. 291-301 (lire en ligne [sur persee]).
- Denis Peyrony (1934), « La Ferrassie : Moustérien-Périgordien-Aurignacien », Préhistoire, p. 1-143n éd. Leroux, Paris.
- [Vidéo conférence 2021] Claudine Cohen, José Braga, Céline Bon et Jean-Jacques Hublin, « Qui sont les nouveaux hommes fossiles ? », visio-conférence, 1h 56' 55, sur youtube.com, Bibliothèque publique d'information.

Vidéographie
Liens externes
- « La Ferrassie », sur hominides.com.

- « La Ferrassie », sur perigord.tm.fr, Conseil général de Dordogne.
- « La Ferrassie, historique des recherches et aperçu du site », sur pole-prehistoire.com.
- « La Ferrassie fête ses 100 ans », sur albuga.info (consulté le ).
- « À la Ferrassie, le bonheur c'est simple comme un coup de pelle ! », sur albuga.info.