Guerre des Goths (461 - 476)
La guerre des Goths (461-476) fut la dernière guerre que mena l’Empire romain d’Occident contre les Wisigoths avant sa disparition en 476.

Les dernières décennies de l’Empire romain d’Occident devaient se révéler une période trouble qui vit se succéder nombre d’empereurs fantoches obéissant à des généraux, véritables maitres du gouvernement, qui n’exerçaient plus guère leur autorité que sur l’Italie et les territoires dont ils avaient nommé les gouverneurs. À l’extérieur, les généraux romains étaient souvent en lutte les uns contre les autres appuyés par des contingents barbares qui n’hésitaient pas à s’allier avec les uns ou avec les autres pour autant que ces alliances leur permettent d’affirmer l’autonomie de leurs royaumes.
Cette guerre fit suite à celle entreprise en 458 qui avait vu l’empereur Majorien, désireux de rétablir le contrôle de Rome sur les royaumes barbares qui affirmaient de plus en plus leur autonomie, défaire le roi wisigoth Théodoric II lors de la bataille d’Arlate (aujourd’hui Arles). De là Majorien voulut se servir de l’Espagne comme base d’une reconquête de l’Afrique du Nord. Cette tentative échoua lorsque le roi vandale Genséric anéantit la flotte qui devait le transporter avec son armée en Afrique. Après avoir licencié celle-ci devenue inutile l’empereur, en 461, rentra en Italie accompagné d’un petit régiment, mais dut dès son arrivée affronter le général Ricimer. Ce dernier captura Majorien et le remplaça par le sénateur Libius Severus. Celui-ci ne fut toutefois pas reconnu par l’empereur d’Orient, Léon Ier, lequel désirait en utilisant les forces conjointes des empires d’Orient et d’Occident reconquérir l’Afrique du Nord. Cette expédition devait tourner au désastre et engloutir les dernières forces de l’Empire d’Occident.
De son côté, Théodoric II (r. 453-466) ne tarda pas à se ressaisir après la défaite d’Arlate et, dès 461 reprit ses avancées à la fois en Gaule et en Hispanie où en 462, il s’allia aux Suèves. Il devait être assassiné en 464 par son jeune frère Euric qui s’empressa de déclarer sa totale indépendance des Romains. Après avoir établi sa domination sur d’autres roitelets goths en Gaule, il pouvait espérer réunir sous sa gouverne tout le pays entre l’Atlantique, la Loire et le Rhône, pendant qu’en Hispanie toute résistance ibéro-romaine avait cessé en 475. Lorsque Odoacre mit fin au règne du dernier empereur romain en 476, les troupes d’Euric traversèrent le Rhône et occupèrent toute la région jusqu’aux Alpes.
Contexte historique

Lorsque l’empereur Majorien (r. 457-461) prend le pouvoir après avoir déposé l’année précédente son prédécesseur Avitus, les Wisigoths sont déjà maitres d’une grande partie de la Gaule et de l’Espagne. Ailleurs sur le même territoire, l’aristocratie gallo-romaine bat en brèche l’autorité de Rome et les peuples barbares, alliés de Rome en théorie, se conduisent de manière de plus en plus autonome. La situation est similaire dans les Balkans pendant qu’en Afrique du nord les Vandales font la loi [1].
Militaire de profession, Majorien connait bien la Gaule où il avait commencé sa carrière sous les ordres du général Aetius [2]. Par la suite, il occupera le poste de commandant de la garde impériale sous les empereurs Valentinien III (r. 425-455), Pétrone Maxime (r. mars-mai 455) et Avitus (r. 455-456). Arrivé au pouvoir son premier objectif sera de rétablir l’autorité de Rome sur l’ensemble de l’empire d’Occident qui, pour l’instant, se limite à l’Italie, au sud de la Gaule et au sud de l’Espagne[1]. Ne pouvant compter sur son collègue le patrice Ricimer, lequel appartient par son père à la famille royale des Suèves d’Espagne et par sa mère à celle des Wisigoths de Gaule, Majorien confie à l’un de ses amis, Aegidius, nommé en 456 magister militum per Gallias (général de l’armée des Gaules), le soin de rétablir l’ordre en Gaule, de mettre au pas l’aristocratie gallo-romaine et de chasser les Burgondes[1].
Le moment est favorable puisque Théodoric II et son frère Frédéric mènent campagne en Espagne. Après avoir vaincu à l’été 457 un groupe de Vandales qui avaient débarqué en Campanie sous les ordres d’un beau-frère de leur roi Genséric[3], Majorien se dirigea vers la Gaule avec son armée renforcée de nombreux contingents barbares[4], première étape d’une reconquête de l’Afrique du nord. Il devait affronter Théodoric II près d’Arelate. Avec l’aide de ses généraux Aegidius et Nepotianus, il tailla les Goths en pièces. Théodoric II dut fuir Arles. Toutefois Majorien, voulant continuer sa politique de conquête sans avoir à se préoccuper de Théodoric en Gaule, lui imposa un traité par lequel les Wisigoths renonçaient à la Septimanie[N 1], rendaient leurs possessions en Espagne à l’autorité romaine et redevenaient des « fédérés » de Rome [5].
Fin de l’Empire romain d’Orient
Majorien

Majorien s’installe alors à Arles; ce sera son dernier grand succès. Pour mener lui-même ses troupes à la guerre, il a laissé Ricimer, son rival, en charge de l’Italie. Il laisse également en Gaule son compagnon de toujours, le général Aegidius et envoie des messagers en Espagne annoncer sa victoire sur les Wisigoths et son traité avec Théodoric II[6]. Avec l’aide de ses nouveaux « fédérés », Majorien entre dans la vallée du Rhône [7], conquiert les Burgondes et prend d’assaut la ville de Lyon; les Bagaudes vaincus sont forcés de reconnaitre la souveraineté de l’empire [8].
Ayant ainsi « pacifié » la Gaule, Majorien peut se tourner vers l’Espagne, riche province qui fournit une bonne partie de l’approvisionnement en blé de Rome, dont il espère se servir comme base pour la conquête de l’Afrique. À cette fin, il rassemble une flotte de trois cents navires avec lesquels il compte traverser le détroit de Gibraltar pour se rendre en Afrique[7] - [9]. Une première campagne de conquête du pays suève dans le nord-ouest de l’Hispanie dura toute l’année 459, conduite par le magister militiae (général d’infanterie) Nepotianus et le comes (comte, membre permanent de l’entourage de l’empereur) goth Sunieric. Alarmé par la perspective d’une invasion, Genséric tenta de négocier la paix, mais en vain. Il prit alors la décision de dévaster la Maurétanie, son propre territoire, et fit préparer sa flotte pour repousser tout invasion maritime sur cette côte où Majorien aborderait probablement[7].
Pendant que Nepotianus et Sunieric battaient les Suèves à Lucus Augusti (aujourd’hui Lugo en Espagne) et conquéraient Scallabis en Lusitanie (aujourd’hui Santarém au Portugal), l’empereur marchait sur Caesaraugusta (aujourd’hui Saragosse en Espagne) où il fit une entrée triomphale[10]. Finalement, il rejoignit Carthago Nova, capitale de la province de Carthaginienis où sa flotte, en rade à Portus Illicitanus (aujourd’hui Santa Pola en Espagne) fut détruite par des traitres au service des Vandales [11] - [12]. Ainsi privé de la flotte nécessaire Majorien abandonna l’idée d’une invasion de l’Afrique du nord.
Il reçut alors les ambassadeurs de Genséric avec qui il négocia une paix qui comprenait probablement la reconnaissance de l’occupation de la Maurétanie par les Vandales, puis, ayant dissout son armée, il retourna à Arlate où il licencia les régiments barbares, laissa le reste de l’armée sous le commandement d’Aegidius et repartit pour Rome en 461 accompagné seulement d’une garde réduite[11].
Mais pendant qu’il faisait campagne à l’étranger, un complot s’organisait en Italie conduit par Ricimer et regroupant les membres de l’aristocratie qui sentaient leurs privilèges sérieusement menacés par la législation sociale et les réformes monétaires de Majorien[8] - [13]. Ricimer se porta à la rencontre de Majorien avec un détachement militaire. Les deux hommes se firent face à Tortona (non loin de Placenza où Avitus avait été tué), Majorien fut arrêté, déposé (3 aout) et exécuté quatre jours plus tard[14]. Procope[15] ne mentionne pas le retour d’Espagne, disant plutôt que l’empereur mourut de dysenterie, peut-être une fausse nouvelle suggérée par Ricimer[16]. Victor de Tonnena soutient que Majorien aurait rejoint Rome où il aurait été assassiné et situe le fait en 463 [17].
Ricimer
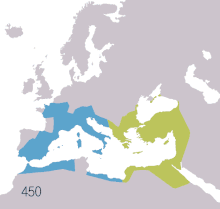
Fils du roi suève de Galice (Espagne) Rechila par son père et du roi des Wisigoths, Wallia par sa mère, arien de surcroit, Ricimer ne pouvait lui-même prétendre au trône impérial. Il se contenta de mettre sur le trône des empereurs-fantoches tout en demeurant le véritable maitre de Rome jusqu’à sa mort en 472[18]. Pendant ses années au pouvoir, la lutte contre les Wisigoths qui continuaient à étendre leurs domaines et à se comporter de façon autonome passera au second plan, lui-même étant trop préoccupé par la situation intérieure de l’Empire romain d’Occident, ses relations avec l’empereur d’Orient Léon Ier et leurs relations conjointes avec le royaume vandale de Genséric.
Escomptant peut-être que l’empereur d’Orient nommerait rapidement un successeur à Majorien[N 2], Ricimer attendit trois mois avant de faire nommer par le Sénat un nouvel empereur en la personne de Libius Severus (r. 461-465), obscur sénateur que ne redouterait pas l’aristocratie sénatoriale italienne et qu’il pourrait manipuler à sa guise. Mais celui-ci ne fut reconnu ni par Léon Ier à Constantinople, ni par aucun des généraux ayant servi sous Majorien, lesquels gouvernaient leurs provinces de façon pratiquement autonome : Aegidius en Gaule, lequel se rebella immédiatement, Marcellinus en Sicile et en Illyricum, Nepotianus en Hispanie[19] - [8].
Léon se refusant absolument à reconnaître Severus, celui-ci en dépit de sa nature docile, devenait donc un obstacle pour le pouvoir de Ricimer; coïncidence ? le nouvel empereur mourut après un bref règne[N 3] - [20], à la suite de quoi Ricimer continua à gouverner seul l’empire pendant dix-sept mois, le plus long intervalle jusque-là, en attendant que Léon nomme un successeur[21].
Les Vandales profitèrent de la vacance du trône en s’immisçant dans la politique domestique de l’Empire romain d’Occident et en appuyant la candidature d’Olybrius qu’unissaient des liens matrimoniaux avec celle de Genséric comme empereur. Ils accentuèrent également leurs attaques sur la Sicile et l’Italie, ainsi que sur des territoires de l’Empire d’Orient comme l’Illyricum, le Péloponnèse et d’autres parties de la Grèce[22] - [23].
Face à ce danger, Léon Ier nomma en 467 le commandant de l’armée d’Illyricum, Anthémius, empereur en Occident avec comme mission d’assurer le trône et de reprendre l’Afrique du Nord. L’année suivante il organisa une vaste expédition contre les Vandales à laquelle devaient prendre part les armées d’Orient et d’Occident. Celle-ci se termina par un désastre lors de la bataille du Cap Bon. Une grande partie de la flotte conjointe fut détruite et Marcellinus, le commandant en chef des forces, fut assassiné par ses propres soldats en Sicile, peut-être à l’instigation de Ricimer [24].
Non seulement ce désastre laissait-il les deux empires avec des forces militaires sensiblement réduites, mais son organisation avait couté cher au Trésor impérial[25] - [N 4]. Les Vandales en profitèrent pour reprendre leurs raids sur l’Italie.
Pendant ce temps les Wisigoths, profitant du fait que l’attention s’était déplacée vers l’Afrique du nord, avaient repris leur politique d’expansion en Gaule et en Espagne.
Création du royaume wisigoth
Théodoric II

La bataille d’Arelate ne devait pas décourager les Wisigoths de Théodoric II qui reprirent bientôt les armes.
Après l’assassinat de l’empereur Majorien en 461 et la nomination par le Sénat de Libius Severus, le général Aegidius, resté en Gaule, refusa de reconnaitre le nouvel empereur[26]. À la même période, un conflit de frontières avait éclaté entre Aegidius et les Wisigoths. Ceci faisait des Wisigoths des alliés de fait de Ricimer; celui-ci leur céda Narbonne et l’ensemble de la Gaule narbonnaise en échange d’une alliance[27] - [28]. Ceci donnait aux Wisigoths à la fois un débouché sur la mer et un lien avec la péninsule ibérique, objectif qu’ils cherchaient à réaliser depuis longtemps. En même temps ceci faisait des Wisigoths une menace pour Aegidius qui consolidait son pouvoir sur le nord de la Gaule, possiblement grâce à une alliance avec les Francs saliens de Childéric Ier[N 5]. En 463, les Wisigoths sous le commandement de Frédéric, le frère de Théodoric, tentèrent d’envahir le territoire que gouvernait Aegidius. Avec l’aide des Francs ce dernier réussit à repousser leur offensive et, à la bataille d’Orléans, défit Frédéric qui y perdit la vie[29]. On sait qu’il remporta une autre victoire, modeste celle-là, contre les Wisigoths près de Chinon à une date inconnue[30]. Toutefois, il s’abstint d’aller attaquer leurs positions en Aquitaine, soit faute de ressources[31], soit qu’il se soit senti menacé par les généraux romains Arbogast (en fait un Franc qui gouvernait les environs de Trêves) et Agrippinus (le général qui avait remis Narbonne aux Wisigoths).
Pendant que son frère combattait en Gaule, Théodoric II avait licencié le commandant impérial Nepotianus qu’il avait remplacé par Arborius. Au cours de cette même période la succession du roi Rechiaire, dernier des successeurs d’Hermeric, continuait à être disputée parmi les prétendants au trône des Suèves. Les deux principaux candidats étaient d’une part Réchimond ou Rémismon (en espagnol Requimundo), depuis 459, roi de la partie nord du royaume suève (Galicie), et d’autre part Frumaire (en espagnol Frumario) roi du sud du même royaume[32].
Theodoric II se déclara en faveur de Réchimond à qui il envoya de nombreux présents incluant des armes et une princesse goth comme épouse[33] - [34]. Le décès de son rival Frumaire en 464 lui permit de rétablir l’unité des Suèves et de confirmer son alliance avec Theodoric II, alliance qui échappait à tout contrôle des autorités romaines. La conclusion de cette entente avec les Suèves permit à Théodoric de retirer ses troupes d’Espagne pour les ramener en Gaule et renforcer les troupes qui combattaient toujours Aegidius. Ce dernier aurait envoyé une ambassade à Théodoric en mai 464 dont on ne connait pas le résultat [35]. Aegidius devait mourir vraisemblablement de causes naturelles à l’automne 465[N 6] - [35] - [36]. Son fils Syagrius le remplaça et déplaça le siège du gouvernement à Soisson, créant ce qu’il est convenu d’appeler « le royaume de Soisson »[37] - [35], éphémère royaume qui devait être conquis par les Francs dans les années 480[38].
Theodoric II devait être assassiné en 466 par son frère Euric, arien convaincu qui lui reprochait d’être trop romanisé et trop conciliant avec les nicéens[39].
Euric
.jpg.webp)
Après son avènement, Euric défit plusieurs autres roitelets wisigoths en une série de guerres civiles qui lui permit d’unifier la nation wisigothe[40]. En 469, il étendit sa domination jusqu’à la Loire après la bataille de Déols où il défit les Bretons[41]. Il installa alors le duc Victor en Auvergne. Ce dernier conduisit les opérations militaires autour de Clermont qui tomba après un long siège en 475 : l’Aquitaine première devint alors entièrement gothe.
Profitant des problèmes et tentatives d’usurpation qui affectèrent l’Empire romain d’Occident pendant cette période, Euric étendit sa domination sur l’Espagne faisant reculer les Suèves vers le nord-ouest de la péninsule[40]. Et alors que ses prédécesseurs avaient régné en tant que fédérés ou légats de l’empereur romain, Euric fut le premier à affirmer son indépendance absolue, forçant l’empereur Julius Nepos (r. 474-480) à reconnaitre son autorité sur toute l’Espagne wisigothe et sur toute la Gaule, des Pyrénées à la Loire et au Rhône en échange du retour de la Provence à Rome [42] - [43].
Cet abandon provoquera la fureur du Sénat de Rome qui fit renverser Julius Nepos par le général en chef des armées, Oreste, en aout 475. Celui-ci installa alors son fils, Romulus Augustulus, sur le trône, lequel sera lui-même détrôné par Odoacre qui prononcera sa déchéance en 476 et renverra les attributs impériaux à l’empereur romain d’Orient[44]. Euric en profita pour envoyer ses troupes franchir le Rhône et occuper l’ensemble de la région jusqu’aux Alpes[40]. La Provence était ainsi reconquise.
Euric gouverne alors le plus vaste État successeur de l’Empire romain d’Occident : il règne sur un royaume comprenant environ 10 millions d’habitants s’étendant sur une superficie équivalent à six fois celle du précédent État fédéré et dans lequel le territoire au sud des Pyrénées ne sera pas une zone de colonisation, mais une source de richesses et de sécurité, fournissant une zone de retraite en cas de débâcle militaire. Euric mourra en 484 sans avoir donné à son royaume la structure ecclésiastique et juridique qui en aurait fait l’empire dont avait pu rêver Athaulf au début du siècle; cette tâche reviendra à son fils, Alaric II (r. 484-507)[45].
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Majorian » (voir la liste des auteurs).
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ricimer » (voir la liste des auteurs).
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Theoderich II. » (voir la liste des auteurs).
Notes
- La Septimanie, ou province de Narbonne, est une région qui correspond approximativement à la partie occidentale de l'ancienne province romaine de la Gaule narbonnaise.
- La tradition voulait que lors du décès de l’un des deux empereurs, le survivant prenait le contrôle des deux parties de l’empire; il lui appartenait de nommer un remplaçant au disparu qui devenait alors l’empereur junior.
- Selon Cassiodore il aurait été empoisonné par Ricimer (Oost (1970), p. 229, alors que Sidonius affirme plutôt qu’il serait mort de causes naturelles.
- La flotte impériale comptait 1113 navires, les troupes plus de 100 000 hommes, les frais de l’entreprise dépassaient les 9 000 000 nomismata (Procope, Guerre contre les Vandales, I, 6.) chiffres nettement exagérés mais démontrant l’ampleur de l’entreprise.
- Selon les auteurs de l’époque, Grégoire de Tours et Fredegar; les historiens modernes comme Ernst Stein et Michael Kulikowski offrent des versions différentes.
- Certaines sources mentionnent plutôt fin 464 (voir MacGeorge [2002])
Références
- Zosso et Zing (2009) « Majorien », p. 381-383
- Sidoine Apollinaire, Carmina, V. 198-200
- Sidoine Apollinaire, Carmina, V. 385-440
- Sidoine Apollinaire, Carmina, V. 474-477
- Bunson (1994) p. 6
- Hydace, 197, s.a. 459; Grégoire de Tours, Historia Francorum, II.11.
- Priscus, fragment 27.
- Mathisen, "Julius Valerius Maiorianus » (in) De Imperatoribus Romanis
- Procope, Bellum Vandalicum 7.4-13
- Collins (2004) p. 32
- Chronica gallica anno 511 pp. 85-100
- Hydace, 200, s.a. 460
- Hydace, 210
- Jean d’Antioche, fragment 203; Marcellinus, s.a. 461
- Procope VII.14-15
- Fik Meijer, Emperors Do not Die in Bed, Routledge, 2004, p. 155
- Hydace, Chronica, s.a. 463
- Jones (1990), p. 241
- Martin Jones (1986) p. 241
- Mathiesen, « Libius Severus », p. 4
- Heather (2005), p. 393
- Bury, "A note on the Emperor Olybrius", English Historical Review 1 (1886), pp. 507‑509
- Gordon (1966), p. 120 note
- Ostrogorsky (1983) p. 91
- Bury (1958), p. 337
- MacGeorge (2002), p. 14
- Hydace, Chronica minora 217 (dans) MGH AA, p. 33
- Anderson (2012), p. xxv
- MacGeorge (2002), pp. 65, 94, & 115
- MacGeorge (2002), p. 115
- MacGeorge (2002), p. 117
- Thompson, (1982) p. 167. Selon Hydace : Inter Frumarium et Rechimundum oritur de regni potestate dissensio ("La discorde se mit entre Frumar et Réchimond concernant l’autorité sur le royaume")
- Thompson, (1982) p. 168
- Hydace, Chronica miniora, 219f; 223; 226; 230 (dans) MGH AA p. 33
- Jones, Martindale & Morris (1980), p. 12
- MacGeorge 2002, pp. 65 & 120
- MacGeorge (2002), p. 65 & 120
- Mitchell (2007), p. 211
- Wood (1994) p. 16
- Wolfram (1997) p. 153
- Grégoire de Tours, Dix livres d'histoire, II, 18
- Zosso & Zingg (2009) « Julius Nepos » pp. 405-406
- Wolfram (1997) p. 154
- Zosso & Zingg (2009) « Romulus Auguste », pp. 411-412
- Wolfram (1997) pp. 154-155
Bibliographie
Sources primaires
- Chronica gallica anno 511. (Voir Burgess, R. "The Gallic Chronicle of 511: A New Critical Edition with a Brief Introduction." Society and Culture in Late Antique Gaul: Revisiting the Sources. edd. R. W. Mathisen and D. Shantzer. Aldershot, 2001.)
- Edictum Theodorici regis, éd. F. Blühme, M.G.H. Leges t. V.
- Sidoine Apollinaire. Panégyrique prononcé en l'honneur de Julius Valerius Majorianus Augustus [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/sidoine/poesies5.htm.
- Hydace de Chaves. Chronica Minora, Monumenta Germaniae historica. Auctorum antiquissimorum (dans les références, MGH AA), vol.XI, éd. Th. Mommsen, 1894
- Jean d'Antioche. « Fragment 295 », (dans) Fragmenta Historicorum Graecorum, Karl Müller (éd.) 1876-1959 à Berlin, 1923-aujourd’hui à Leyde
- Jordanès. Histoire des Goths, traduction en français d'Olivier Devillers, Les Belles Lettres, Paris, 1995 (ISBN 2-251339-27-2)
- Procope de Césarée, La Guerre contre les Vandales (Guerres de Justinien, livres III et IV), traduit et commenté par Denis Roques, Paris, Les Belles Lettres, 1990
Sources secondaires
- (en) Anderson, W.B. Sidonius: Poems and Letters, Vol. I: Poems, Letters, Book I-II. Cambridge, Harvard University Press, 2012 [1936] (ISBN 978-0-674-99327-3)
- (en) Bunson, Matthew. Encyclopedia of the Roman Empire. New York, Facts on File, 1994 (ISBN 978-0-816-02135-2)
- (en) Bury, John Bagnell. History of the Later Roman Empire: from the death of Theodosius I to the death of Justinian. Dover books. Vol. 1. Dover Publications, 1958 (ISBN 978-0-486-20398-0)
- Chastagnol, André. La fin du monde antique. Nouvelles éditions latines, 1976; Nel 2008 (ISBN 978-2-723-30526-6)
- (en) Collins, Roger. Visigothic Spain, 409–711, Blackwell Publishing, 2004 (ISBN 0-631-18185-7)
- Coulon, David. Aetius, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2000, 350 p. (ISBN 2-284-03464-0). Thèse de doctorat sous la direction de Michel Rouche
- (en) Gordon, Colin D. The Age of Attila: Fifth Century Byzantium and the Barbarians. Ann Arbor, MI, University of Michigan Press, 1966 (ISBN 978-0-472-03578-6)
- (en) Heather, Peter. The Fall of the Roman Empire, A New History. London, Pan Macmillan, 2005 ( (ISBN 978-0-330-49136-5)
- Jaeghere, Michel de. Les derniers jours : La fin de l'empire romain d'Occident, Paris, Les Belles Lettres, 2015, 656 p. (ISBN 978-2-251-44501-4)
- (en) Jones, Arnold Hugh Martin; Martindale, J. R.; Morris, J. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume 2, AD 395–527. Cambridge, Cambridge University Press, 1980 (ISBN 978-0-521-20159-9)
- (en) Jones, A.H.M. The Later Roman Empire (284-602), vol. 1. Baltimore (Maryland), Johns Hopkins University Press, 1986, 1990 (ISBN 978-0-801-83285-7)
- (en) Kulikowski, Michael. Imperial Tragedy: From Constantine’s Empire to the Destruction of Roman Italy AD 363-568 (The Profile History of the Ancient World Series). New York, Profile Books, 2019 (ISBN 978-0-000-07873-5)
- (en) MacGeorge, Penny. Late Roman Warlords. Oxford, Oxford University Press, 2002 (ISBN 978-0-199-25244-2)
- (en) Martin Jones, Arnold Hugh. The Later Roman Empire, 284–602, JHU Press, 1986 (ISBN 0-8018-3353-1)
- (en) Mathisen, Ralph W. "Julius Valerius Maiorianus (18 February/28 December 457 – 2/7 August 461)", (in) De Imperatoribus Romanis [en ligne] http://www.roman-emperors.org/major.htm
- Mussot-Goulard, Renée. Les Goths. Biarritz, Éd. Atlantica, 2001 [1974] (ISBN 978-2-843-94140-5)
- (en) Oost, Stewart Irvin. D.N. "Libius Severus P.F. AVG". [in] Chicago Journals, vol. 65, no 4, oct. 1970. [on line] https://www.jstor.org/discover/10.2307/268600?uid=3739464&uid=2&uid=3737720&uid=4&sid=21101419718211 [archive]
- Ostrogorsky, Georges. Histoire de l’État byzantin. Paris, Payot, 1983 [1956] (ISBN 2-228-07061-0)
- Schmidt, Joël. Le royaume wisigoth d'Occitanie, Perrin, coll. « Tempus », 2008, 195 p. (ISBN 978-2-262-02765-0)
- Sincyr, Gilbert. L'Épopée d'Aetius, dernier général de la Rome antique. Dualpha, coll. « Vérités pour l'histoire », Coulommiers, 2006, 318 p. (ISBN 2-915461-89-9)
- Roberto, Umberto. Rome face aux barbares : une histoire des sacs de la Ville, Paris, Le Seuil, 2015, 430 p. (ISBN 978-2-02-116222-6)
- (en) Thompson, E. A. Romans and Barbarians: The Decline of the Western Empire. Madison, University of Wisconsin Press, 1982 (ISBN 0-299-08700-X)
- Wolfram, Herwig. Histoire des Goths. Paris, Albin Michel, 1991 (ISBN 978-2-226-04913-1)
- (en) Wolfram, Herwig. The Roman Empire and Its Germanic Peoples. Berkeley, University of California Press, 1997 (ISBN 978-0-520-24490-0)
- (en) Wood, Ian N. The Merovingians Kingdoms: 450-751. Routledge, 2016 (ISBN 978-0-582-49372-8)
- Zosso, François & Christian Zingg. Les empereurs romains, 27 av. J.-C. - 476 ap. J.-C. Éditions Errance, 2009 (ISBN 978-2-877-72390-9)
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- « Les Wisigoths, barbares comme les autres ? », Carbone 14, le magazine de l'archéologie, France Culture, .