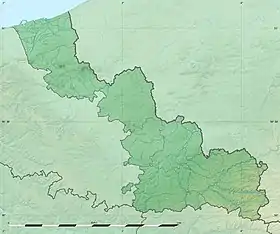Fosse Chabaud-Latour (Denain)
La fosse François de Chabaud-Latour ou Chabaud-Latour de la Compagnie des mines d'Anzin est un ancien charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Denain. Commencée en 1842, elle commence à extraire en 1847, mais est abandonnée en 1853 après une venue d'eau qu'il n'a pas été possible d'épuiser, alors qu'elle n'avait extrait que 595 tonnes, sans extraire de 1849 à 1952. La cité Chabaud-Latour Ancienne est construite en 1870 et agrandie en 1875, elle est essentiellement composée de corons. Les installations de surface sont détruites en 1877 et les puits remblayés. La cité Chabaud-Latour Nouvelle est construite en 1924 à l'est du carreau de fosse, elle est composée d'habitations groupées par deux ou par quatre, et loge les mineurs des fosses environnantes.
| Fosse François de Chabaud-Latour | |
.JPG.webp) Le carreau de fosse en 2011. Au premier-plan, le puits no 57. | |
| Puits Chabaud-Latour 57 | |
|---|---|
| Coordonnées | 50,334452, 3,399544[BRGM 1] |
| Début du fonçage | 1842 |
| Mise en service | 1847 |
| Arrêt | 1853 (extraction) |
| Remblaiement ou serrement | 1877 |
| Puits Chabaud-Latour 58 | |
| Coordonnées | 50,334683, 3,399788[BRGM 2] |
| Début du fonçage | 1842 |
| Mise en service | 1847 |
| Profondeur | 210 mètres |
| Arrêt | 1853 (extraction) |
| Remblaiement ou serrement | 1877 |
| Administration | |
| Pays | France |
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Commune | Denain |
| Caractéristiques | |
| Compagnie | Compagnie des mines d'Anzin |
| Ressources | Houille |
| Protection | |
Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits Chabaud-Latour, localisées sur un espace vert. Les cités Chabaud-Latour Ancienne et Chabaud-Latour Nouvelle ont été inscrites le sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
La fosse
Fonçage
Le fonçage des puits nos 57 et 58 de la fosse Chabaud-Latour est commencé en 1842 par la Compagnie des mines d'Anzin[TH 1], à 610 mètres au nord-est[note 2] de la fosse Joseph Périer, commencée l'année précédente[TH 2], et à 1 370 mètres dans la même direction[note 2] de la fosse Villars, première fosse ouverte dans la commune, en 1826[A 1].
.jpg.webp)
Le puits 58 est situé à 30 mètres au nord-est du puits 57[note 2]. Les puits sont entrepris à l'altitude de 39 mètres et le terrain houiller est atteint à la profondeur de 77 mètres[JD 1].
Exploitation
La fosse commence à extraire en 1847, elle produit cette année-là 25 tonnes de houille[TH 3]. Elle en produit 384 tonnes en 1848, rien de 1849 à 1852, puis 186 tonnes en 1853, date à laquelle elle cesse définitivement de produire, après avoir extrait seulement 595 tonnes, à la suite d'une venue d'eau si importante qu'elle n'a pas pu être maîtrisée[TH 3].
En 1877, les installations de surface sont détruites et les puits sont remblayés[TH 3].
Reconversion
Un espace vert a pris la place du carreau de fosse. Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits Chabaud-Latour. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[1].
.JPG.webp) « Puits Chabaud-Latour 57, 1842-1877 ».
« Puits Chabaud-Latour 57, 1842-1877 »..JPG.webp) Le puits 57 dans son environnement.
Le puits 57 dans son environnement..JPG.webp) Le puits 57 dans son environnement.
Le puits 57 dans son environnement..JPG.webp) « Puits Chabaud-Latour 58, 1842-1877 ».
« Puits Chabaud-Latour 58, 1842-1877 »..JPG.webp) Le puits 58 dans son environnement.
Le puits 58 dans son environnement..JPG.webp) Le puits 58 dans son environnement.
Le puits 58 dans son environnement.
Les cités
Deux cités ont été bâties de part et d'autre du carreau de fosse[2]. Bien qu'il y a des similitudes avec les cités de la fosse Bellevue, ces dernières n'ont pas été rattrapées par l'urbanisation du centre-ville[TH 4]. Les cités Chabaud-Latour Ancienne et Chabaud-Latour Nouvelle font partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été inscrits le sur la liste patrimoine mondial de l'Unesco. Elles constituent le site no 16[3].
Cité Chabaud-Latour Ancienne
En 1870, alors que le carreau de fosse existe toujours, les premiers corons sont construits. Ils sont de type « 1867 en ligne », et forment huit lignes de corons, représentant 188 logements[TH 3]. Chaque ligne dispose de son four à pain et de sa pompe à eau. En 1875, la Compagnie d'Anzin rajoute trois lignes de six et quatre logements, chaque maison regroupant deux familles[TH 3].
.JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Ancienne.
La cité Chabaud-Latour Ancienne..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Ancienne.
La cité Chabaud-Latour Ancienne..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Ancienne.
La cité Chabaud-Latour Ancienne..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Ancienne.
La cité Chabaud-Latour Ancienne..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Ancienne.
La cité Chabaud-Latour Ancienne..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Ancienne.
La cité Chabaud-Latour Ancienne.
Cité Chabaud-Latour Nouvelle
En 1924, de l'autre côté de la rue Pierre Nève, la Compagnie des mines d'Anzin construit la cité Chabaud-Latour Nouvelle. Elle est constituée de quinze maisons de deux logements et de dix-neuf maisons de quatre logements. Ces maisons sont de type « 1922 modèle 23 »[TH 3].
.JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Nouvelle.
La cité Chabaud-Latour Nouvelle..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Nouvelle.
La cité Chabaud-Latour Nouvelle..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Nouvelle.
La cité Chabaud-Latour Nouvelle..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Nouvelle.
La cité Chabaud-Latour Nouvelle..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Nouvelle.
La cité Chabaud-Latour Nouvelle..JPG.webp) La cité Chabaud-Latour Nouvelle.
La cité Chabaud-Latour Nouvelle.
Notes et références
- Notes
- L'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco concerne les cités Chabaud-Latour Ancienne et Chabaud-Latour Nouvelle.
- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits matérialisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.
- Références
- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », sur http://dpsm.brgm.fr/Pages/Default.aspx,
- « Le périmètre du bien inscrit », sur http://www.missionbassinminier.org/, Mission Bassin Minier
- « Bassin Minier Nord-Pas de Calais », sur https://whc.unesco.org/, Unesco
- Références aux fiches du BRGM
- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,
- Dubois et Minot 1991, p. 20
- Références à Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Valenciennes, vol. IV, Imprimerie nationale, Paris,
- Gosselet 1913, p. 160
- Références à Collectif, Denain, la ville du charbon : L'évolution du patrimoine minier des débuts à nos jours, ENTE,
- Collectif 2005, p. 25
- Collectif 2005, p. 16
- Collectif 2005, p. 26
- Collectif 2005, p. 27
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr) « Fiche du puits 57 de la fosse Chabaud-Latour », sur http://infoterre.brgm.fr/, BRGM
- (fr) « Fiche du puits 58 de la fosse Chabaud-Latour », sur http://infoterre.brgm.fr/, BRGM
- (fr) Bernard Zurecki, « Les fosses ouvertes à Denain par la Compagnie des mines d'Anzin », sur http://bjz.perso.sfr.fr/denain/index.htm
Bibliographie
![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, , 176 p., p. 20.

- Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Valenciennes, vol. IV, Imprimerie nationale, Paris, , p. 160.

- Collectif, Denain, la ville du charbon : L'évolution du patrimoine minier des débuts à nos jours, Valenciennes, École nationale des techniciens de l'équipement, Valenciennes, , 80 p. (ISBN 2-11-095466-3), p. 16, 25-27.