Frédéric Angleviel
Frédéric Angleviel, né le à Nouméa, est un historien français spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Il a soutenu une thèse Nouveau régime d’histoire contemporaine sur Wallis-et-Futuna en 1989 et une habilitation à diriger des recherches sur l’historiographie de la Nouvelle-Calédonie en 2002. Vacataire depuis 1988, puis Maître de conférences puis Professeur des universités en section 22 à l'université de la Nouvelle-Calédonie il travaille comme historien libéral depuis 2008. Le 19 juillet 2021, il est mis en retraite anticipée.
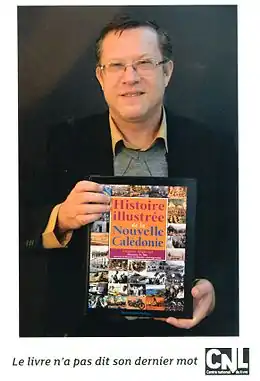
| Naissance | |
|---|---|
| Nationalité | |
| Activité |
| Directeur de thèse |
Jules Maurin (d) |
|---|
Biographie
Carrière universitaire
Certifié en 1985, il fut volontaire à l'aide technique (VAT) en 1986 à Thio puis professeur d’histoire à l’école normale de Nouvelle-Calédonie de 1987 à 1990, directeur du Centre territorial de recherche et de documentation pédagogiques (CTRDP) de Nouvelle-Calédonie de 1991 à 1994. Vacataire à partir de l'ouverture de l’Université française du Pacifique en 1988 (ce qui en fait aujourd'hui le plus ancien ancien enseignant de l'UNC), il devient le premier maître de conférences de la filière histoire en 1993. Il y est élu professeur des universités en 2004. Depuis 2009, il est historien libéral[1].
Activités éditoriales
En 2010 il a publié un ouvrage de science-fiction intitulé La menace pourpre et un roman biographique sur l'un de ses aïeux transporté puis libéré, De la vendetta à la Nouvelle-Calédonie. Paul Louis Mariotti, matricule 10318[2]. Il a reçu en le prix de l'aide à la réalisation de la Société Le Nickel (SLN) pour réaliser un court-métrage intitulé À la poursuite de l'or vert. Ce court-métrage a été présenté au festival de film océanien de Rocherfort en 2015. Sa version courte, Vies métisses, a reçu le premier prix du concours "Destin commun" en 2011.
Après avoir finalisé en 2013 une Histoire illustrée de la Nouvelle-Calédonie, il a dirigé un ouvrage collectif sur l'histoire de Wallis et Futuna. Il publie fin 2014 un ouvrage sur les maisons coloniales nouméennes et début 2015 le premier ouvrage historique sur la prise d'otages d'Ouvéa, ouvrage lancé par son éditeur parisien lors du salon du livre de Paris. Cet ouvrage a reçu le prix "sciences" du salon du livre insulaire de Ouessant 2015[3] - [4]. En 2016, il présente l'histoire de la plus ancienne maison commerciale calédonienne, "la maison Ballande", à travers cinq générations de bâtisseurs et il publie un ouvrage de poésies libres et de prose. En 2017 il finalise un ouvrage sur les "Photographies calédoniennes d'antan" et un recueil de nouvelles : "Le premier cycle du Graal". En 2018, il publie "Comprendre les référendums de 2018-2022 en Nouvelle-Calédonie" (464 p, Edilivre) et "La France aux antipodes. Histoire de la Nouvelle-Calédonie" (Vendémiaire). En 2019 il publie un second essai et Entre mer et montagnes. Boulouparis 1857-1879-2019. Début 2020, il publie un ouvrage sur le bagne de Poulo Condore, l'archipel indochinois dont on ne revient pas[5].
Il a participé à plusieurs ouvrages collectifs ou travaux d'équipe sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ou du Pacifique. Il a ainsi codirigé en 1992 le manuel d’histoire de la Nouvelle-Calédonie pour les classes de CM 1 et 2, et en 1999 un ouvrage portant sur Wallis-et-Futuna. En 2004, il a coordonné un numéro spécial du Journal of Pacific Studies (Suva) et les actes d’un séminaire universitaire sur les violences océaniennes. En 2006, il coordonne les actes de la XVIe conférence de la Pacific History Association et les Mélanges en l'honneur du Pr. Jean Martin. Comme auteur, il a publié trente deux ouvrages, co-rédigé quinze livres, dirigé quatorze publications, participé à quatorze ouvrages collectifs et publié seize articles de rang A ainsi que dix articles en langue anglaise et deux articles en langue italienne.
En 2008, il a dirigé avec le politologue Stephen Levine l'ouvrage New Zealand - New Caledonia, Neighbours, Friends, Partners, publié à la Wellington university press, puis avec le géographe Jean-Michel Lebigre, De la Nouvelle-Calédonie au Pacifique aux éditions L'Harmattan. En 2011, il a finalisé avec Marcellin Abong, Darrell Tryon et Christiane Terrier l'ouvrage 101 mots pour comprendre le Vanuatu qui a été offert à 400 exemplaires via l'Alliance française[6] aux écoles du pays qui se tient debout. En 2014-2015, il a co-rédigé avec le premier docteur originaire de Lifou, Paul Magulue Fizin, un ouvrage sur les parlements de la Mélanésie.
Sur le plan de l'édition, il a créé en 1997 la collection « 101 mots pour comprendre » aux éditions nouméennes Île de lumière puis au Centre de Documentation Pédagogique de la Nouvelle-Calédonie, (treize titres), en 1999 la collection « Fac-similés océaniens » (dix titres)[7] et en 2005 la collection « Portes océanes » aux éditions L'Harmattan (cinquante cinq titres en mars 2021[8]). En 2004, il fonde les Annales d’histoire calédonienne aux éditions Les Indes savantes (2 titres)[9]. Il préside l'association GRHOC (Groupe de recherche en histoire océanienne contemporaine) qui a publié dix-neuf ouvrages et participé à de nombreuses coéditions. Il a obtenu en 1995 le prix Auguste Pavie de l’Académie des sciences d'outre-mer pour son premier ouvrage, Les Missions à Wallis et Futuna au XIXe siècle[10].
En tant que secrétaire général adjoint de la Maison de la Mélanésie et secrétaire de rédaction, il tente de lancer en 2012 deux publications annuelles : Les outremers français. Actualités et Etudes et La Mélanésie. Actualités et Etudes. Le deuxième projet collectif bénévole a réussi temporairement l'épreuve du temps grâce à l'organisation d'un colloque consacré aux problématiques mélanésiennes. Ces deux projets s'avèrent des échecs éditoriaux.
Axes de recherche
Sa recherche est centrée sur la Franconésie (et plus particulièrement la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, le Vanuatu) et l'histoire des outre-mers francophones (et plus particulièrement Indochine-Vietnam et la Guyane) ainsi que sur l’histoire religieuse et l’histoire ultramarine.
- Perception du christianisme en Océanie : acculturation ou inculturation ;
- Identité et histoire des vagues de peuplement ;
- Les sources historiques : oralité, image et archéologie industrielle ;
- l’histoire politique contemporaine du Pacifique sud
- L'histoire des mondes carcéraux coloniaux (transportés, mais aussi des déportés politiques et des relégués ou petits récidivistes)
- Un intérêt sentimental pour le Vietnam au temps de la colonisation (Indochine française)
Il considère que la recherche fondamentale doit se nourrir d'aller-retour avec la recherche appliquée. Conscient que les enseignants et le grand public méritent des ouvrages de qualité, il participe à la valorisation, à la vulgarisation et à la synthétisation de la recherche. Il participe ainsi à plusieurs émissions patrimoniales "Sur les traces du passé"[11] de NCTV (ancêtre de Calédonia TV) . Cf. par exemple le 313ème portrait du jour du site Criminocorpus[12]. De 2008 à 2019, son statut d'historien libéral l'amène à s'intéresser à l'histoire politique[13], économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie.
Militant associatif
Militant associatif, Frédéric Angleviel a créé en 1986 l’Association pour la diffusion des thèses sur le Pacifique francophone (THESE-PAC) et en 1997 le Groupe de recherche en histoire océanienne contemporaine (GRHOC). Il fut membre fondateur de l’Association des professeurs d’histoire-géographie de Nouvelle-Calédonie et de l’association Corail qui organisa un colloque par an de 1988 à 2008. Désormais, les colloques Corail sont plus espacés. Il reçoit en 2007 la médaille de chevalier des arts et des lettres. Secrétaire général de la Fédération des œuvres laïques (FOL) de Nouvelle-Calédonie de 1996 à 2003, il reçoit à ce titre les palmes académiques en 2005. Il est conseiller municipal Rassemblement-UMP de la ville de Nouméa de 2001 à 2008 et y a présidé le comité des villes jumelles. Frédéric Angleviel développe au début des années 2010 une politique de création de lithographies au service des artistes calédoniens et océaniens. Le milieu et le marché calédoniens restant restreints, il passe à une valorisation des productions patrimoniales calédoniennes à travers une série d'ouvrages présentant les titres anciens, puis les gravures, les photographies et une collection privée d'objets kanak. En 2019, un ouvrage publié par le GRHOC présente la les billets de banque de Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides (aujourd'hui Vanuatu).
Affaires judiciaires et condamnations
En 2007, Frédéric Angleviel est révoqué de l'Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) à la suite de rapports sexuels qu'il a eus au sein des locaux du campus de Magenta, dont des photos sont publiées sur internet. La sanction est finalement ramenée à une exclusion de cinq ans par le Conseil national de l'enseignement supérieur[14].
En 2009, il est condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel pour envoi d'images pédopornographiques[14]. « Là encore, l’UNC se prononce pour sa radiation, mais à Paris, une nouvelle fois, la sanction est commuée en cinq ans d’exclusion »[14].
En 2019, il est condamné à trois mois de prison avec sursis pour abus de faiblesse : il a servi d'intermédiaire pour détourner 11 millions de francs CFP auprès d'une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer[14]. Se considérant comme complice involontaire, il avait remboursé l'intégralité de cette somme dès 2018 et au vu de sa défense lors de sa comparution pour reconnaissance préalable de complicité, ses casiers judiciaires 2 et 3 sont vierges. La section disciplinaire du Conseil académique de l'Université de Nouvelle-Calédonie décide de le mettre à la retraite d'office[14] et il est radié de ses fonctions actives par le décret du 19 juillet 2021[15]. Il fait appel de la décision[14].
Principales publications
Ouvrages
- Réflexions surl'urgence climatique et les risques d'effondrement. 20 lettres écologiques à mes enfants et futurs petits-enfants. Essai humaniste face au déni, Edilivre, Paris, 2023.
"Photographies Cartes De Visite calédoniennes d'antan, Ed. du GRHOC, Nouméa, 2023, 116 p.
- Cartes Postales calédoniennes d'antan, Ed. du GRHOC, Nouméa, 2022, 200 p.
- Viva d'un peuple océanien en deuil. Réflexions désabusées d'un "sage en haillons" imaginaire kanak, Nouvelle-Calédonie (1774-1878), Edilivre, Paris, 2020, 122 p.
- Poulo Condore. Un bagne français en Indochine, Vendémiaire, Paris, 2020, 202 p. (ISBN 978-2363583406)[16]
- La France aux antipodes, Histoire de la nouvelle-Calédonie, Vendémiaire, Paris, 2018, 390 p.[17]
- Boulouparis, 1857-1879-2019. Entre mer et montagnes, Mairie de Boulouparis et GRHOC, Nouméa, 2019, 224 p.
- Manifeste pour un peuple calédonien. Ou la construction à venir d’une Nouvelle-Calédonie « Arc-en-ciel », « petite nation » dans la France ultramarine, Edilivre, Paris, 2019, 190 p.
- Comprendre les référendums de 2018-2022 en Nouvelle-Calédonie, Edilivre, Paris, 464 p.[18]
- Photographies calédoniennes d'antan, Footprint Pacifique, Nouméa, 2017, 210 p.[19]
- Le premier cycle du Graal. Nouvelles "historisées" d'une quête mythique revisitée, Edilivre, Paris, 2017, 190[20]
- Poésies historiques calédoniennes, Edilivre, Paris, 2016, 146 p.
- Les Ballande et l'appel du large, GRHOC & Groupe Ballande, Nouméa, 2016, 250 p.
- Gravures calédoniennes d'antan. Du temps des Austronésiens à la colonisation libre, Footprint Pacifique, Nouméa 2015, 210 p.
- Kaléidoscope kanak. 10 nouvelles calédoniennes, Edilivre, Paris, 2015, 154 p.
- Un drame de la colonisation. Ouvéa, Nouvelle-Calédonie, mai 1988, Vendémiaire, Paris, 2015, 320 p. Prix science du festival du livre insulaire d'Ouessant.
- Histoire du pays Kunié. De la terre de tous les exils à l'île la plus proche du paradis, Mairie de l'Île des Pins et GRHOC, Nouméa, 2015, 120 p.
- Maisons nouméennes, Patrimoine colonial d'hier et d'aujourd'hui, Footprint Pacifique, Nouméa, 2014, 192 p.
- Histoire illustrée de la Nouvelle-Calédonie, Footprint Pacifique, Nouméa, 2013, 216 p. (réédité en 2015 avec 50 pages de plus)[21]
- Le Paradou. De l'hôpital du Marais au centre hospitalier Albert Bousquet, GRHOC et CH A. Bousquet, Nouméa, 2013, 112 p.
- Farino, un siècle de convivialité, GRHOC et mairie de Farino, 2011, 100 p.
- De la vendetta à la Nouvelle-Calédonie : Paul Louis Mariotti, matricule 10318, roman historique, L’Harmattan, Paris, 2010, 252 p.
- avec Yann Bencivengo, La SLN. 130 ans au service d'une vision industrielle durable, Ed. SLN-Eramet, Nouméa, 2010, 168 p
- La menace pourpre. Tome 1. La parole perdue, Amalthée, Nantes, 2010, 356 p. (Science-fiction)
- Brève histoire politique de la Nouvelle-Calédonie (1945-2005), éditions GRHOC, Nouméa, 2006, 320 p.[22]
- Histoire de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelles approches, nouveaux objets, L’Harmattan, Paris, 2006, 350 p.
- Les fondements de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. Définition, périodisation, sources, Centre de Documentation Pédagogique, Col. Université, Nouméa, 2004, 201 p.
- Historiographie de la Nouvelle-Calédonie ou l’émergence tardive de deux écoles historiques antipodéennes, Publibook, Paris, 2003, 360 p.[23]
- Les missions à Wallis-et-Futuna au XIXe siècle, CRET-CEGET, Collection îles et archipels, N°18, université de Bordeaux III, Bordeaux, 1994, 243 p.[24]
- - Prix Auguste-Pavie 1994 de l'Académie des sciences d'outre-mer.
Ouvrages publiés au titre de seul éditeur
- (dir.) : Une parole méconnue : le préambule de l'accord de Nouméa, Edilivre, Paris, 2020, 300 p.
- (dir.) : Chroniques calédoniennes d'hier et d'aujourd'hui. Nouvelles historiques et paroles de Nouvelle-Calédonie, Edilivre, Paris, 2019, 212 p.
- (dir.) : Wallis et Futuna, 3500 ans d'histoire, GRHOC et Comité du cinquantenaire, Nouméa, 2014, 120 p.
- (dir.) : Chroniques calédoniennes d'hier et d'aujourd'hui. Nouvelles historiques et paroles de Nouvelle-Calédonie, Edilivre, Paris, 2019, 212 p.
- (dir.) : La Mélanésie. Actualités et études, volume 2, L'Harmattan, Coll. Portes Océanes, N°26, Paris, 2014, 416 p.
- (dir.) : La Mélanésie. Actualités et études, L'Harmattan, Coll. Portes Océanes, N°20, Paris, 2012, 290 p
- (dir.) : Les outre-mers français. Actualités et études, L'Harmattan, Coll. Portes Océanes, N°18, Paris, 2012, 336 p
- (dir.) : « « Grands hommes et petites îles » : acteurs et actrices de la christianisation de l’Océanie (1580-1966) dans numéro spécial revue Histoire et missions chrétiennes, N° 20, Paris, 2011, 100 p.[25]
- (dir.) : Rivalités coloniales et missionnaires en Océanie (1688-1902), numéro spécial revue histoire et missions chrétiennes, N°6, 2008, 242 p. [26]
- (dir.) Franconesia: Contemporary Aspects of Francophone Presence in Oceania, numéro spécial du Journal of Pacific Studies, Vol. 27, N°1, Suva, 2004, p 83 à 94.
- (dir.) Violences océaniennes, L’Harmattan, Paris, 2004, 234 p.
- (dir.) : Une histoire en cent histoires. L’histoire calédonienne à travers 100 destins hors du commun, Bambou éditions, Nouméa, 2004, 110 p.
- (dir.) : La Nouvelle-Calédonie. Terre de métissage, Annales d’histoire calédonienne, N°1, Les indes savantes, Paris, 2004, 274 p.
- (dir.) : Religion et sacré en Océanie, L’Harmattan-UNC, XIIè colloque Corail, Paris, 2000, 306 p.
- (dir.) : 101 mots pour comprendre l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, Ile de Lumière, Nouméa, 1997, 225 p. 15 notices.
- (dir.) : Du Caillou au nickel. L’archéologie industrielle de la province sud, Centre de Documentation Pédagogique de Nouvelle-Calédonie & Université Française du Pacifique, Coll. Université N°1, Nouméa, 1996, 280 p.
- (dir.) : Parole, Communication et symbole en Océanie, Corail, L’Harmattan-UFP, Paris, 1995, 382 p, p 335 à 363.
Ouvrages édités en collaboration
- & Boyer Sylvette,La congrégation des soeurs de Saint Joseph de Cluny en Nouvelle-Calédonie, Soeurs oubliés (1860-2015), Ed. du GRHOC, Nouméa, 2022, 200 p.
- & Gaüzère Richard, Les billets de banque de la Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles-hébrides et de Wallis et Futuna, 1848-2018, Ed du GRHOC, Nouméa, 2019, 128 p.
- & Costes William, Art kanak. Collection William Costes, Footprint Pacifique, Nouméa, 2018, 128 p.
- & Fizin Paul, Congrès et parlements de la Mélanésie, Congrès de la nouvelle-Calédonie, Nouméa, 2016, 200 p.
- & Gaüzère Richard, Nomenclature de la scriptophilie calédonienne et néo-hébridaise, GHROC, Nouméa, 2013, 180 p.
- & Laux Claire, Figures de l'évangélisation de l'Océanie, Histoire et missions Chrétiennes, Karthala, Paris, 2012, 180 p.
- & Lebigre Jean-Michel (dir.) : De la Nouvelle-Calédonie au Pacifique, L’Harmattan, Paris, 2009, 286 p.
- & Levine Stephen (dir.) : La Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Voisins, amis et partenaires, Victoria University Press, Wellington, 2008, 347 p.
- & Wadrawane Eddy : Les Kanaks et l’histoire, les indes savantes, Paris, 2008, 556 p.
- & Faessel Sonia : Si Nouméa m’était contée… Anthologie, Edition du GRHOC, N°1, Nouméa, 2000, 144 p.
- & Malau Atoloto, Takasi Atonio (dir.) : 101 mots pour comprendre Wallis-et-Futuna, Iles de Lumière, Nouméa, 1999, 258 p.[27]
- & Le Bourdiec Paul et Jost Christian : Géo-Pacifique des espaces francophones, Géo-Pacifique-CTRDP, Nouméa, 1994, 236 p. (Réédition 1996).
- & Coppell William et Charleux Michel : Bibliographie des thèses sur le Pacifique, CRET/CEGET/PUB, Bordeaux, 1991, 288 p.
Participations à des éditions scientifiques
- "Introduction historique et annotations" dans Jean Gilibert : Journal de Jean Gilibert (1818-1891). Missionnaire mariste chez les Kanaks de 1858 à 1891, CEPAC, Suva, 2007, 537 p. [28]
- « Biographie, Introduction et annotations » dans Lady Barker, Une femme du monde à la nouvelle-Zélande, L’harmattan, Paris, 2005, 304 p.[29]
- « Biographie, Introduction et annotations » dans Vieillard et Deplanche, Essai sur la Nouvelle-Calédonie, L’harmattan, Paris, 2001, 160 p. [30]
Ouvrages pédagogiques écrits en collaboration
- & Capecchi Bernard et Douyère Christiane (dir.), histoire de la Nouvelle-Calédonie, CM, Centre Territorial de Recherche et de Documentation Pédagogiques, Nouméa, 1992, 96 p.[31]
Participations à des ouvrages collectifs ou des colloques
- "L'homme et la mer à Wallis et Futuna" dans Les petites activités de pêche dans le Pacifique sud, IRP, Paris, 1999, pp. 83-92[32].
Principaux articles
(avec une priorité aux articles dont un pdf est disponible sur le net)
- Nouvelle-Calédonie
- Trois millénaires de migrations et de métissages en Nouvelle-Calédonie. Réalité biologique et déficit culturel » dans International Journal of Francophone Studies, N°11-4, 2008, pp. 523-537[33].
- "De Kanaka à Kanak : l'appropriation d'un terme générique au profit de la revendication identitaire" dans hermès, N°32-33, Paris, 2002, pp. 191-196[34].
- "Take one, take all!": Media coverage of the first Chinese boat people's case in New Caledonia" dans Asia Pacific Media Educator, N°6, University of Wollongong, 1999, pp. 40-48[35].
- Contribution à l'histoire de la franc-maçonnerie en Océanie. La loge Union Calédonienne, 1868-1940 dans Journal de la Société des océanistes, N°106, Paris, 1998. pp. 17-38[36].
- Wallis et Futuna
- Futuna ou « l’enfant perdu »… Un timide biculturalisme dans hermès, N°32-33, Paris, 2002, pp. 377-384[34].
- Wallis-et-Futuna (1942-1961) ou comment le fait migratoire transforma le protectorat en TOM, dans Journal de la Société des Océanistes, N°122-123, 2006, pp. 61-76[37].
- Wallis 1825-1858. Contacts, mutations, permanences dans Outre-Mers. Revue d'histoire, Paris, 1989, pp. 284-285[38].
- Océanie et autres archipels
- Le Pacifique français est-il toujours un atout pour la France métropolitaine ? dans Outre-Terre, N°33-34, 2012, pp. 657-669 [39]
- Environnement et anthropisation dans le Pacifique, dégradations et mutations dans Journal de la Société des Océanistes, N°126-127, 2008, pp. 113-126[40].
- Traditions religieuses des peuples de l’Océanie, numéro spécial revue Religions et Histoire, N° 9, Paris, 2006, 100 p.[41]
Annexes
Informations Bio-bibliographiques
- Patrick Cabanel, « Frédéric Angleviel », in Patrick Cabanel et André Encrevé (dir.), Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours, tome 1 : A-C, Les Éditions de Paris Max Chaleil, Paris, 2015, p. 67 (ISBN 978-2846211901)
- Fiche des auteurs et directeurs de collection de L'Harmattan[42].
Liens externes
- publications conservées à la BNF (BNF Data).
- site Bookin pour acquisition d'ouvrages publiés en Nouvelle-Calédonie.
- Blog personnel
- « FREDERIC ANGLEVIEL - Ecrivains de Nouvelle-Calédonie », sur ecrivains-nc.net (consulté le )
- https://criminocorpus.hypotheses.org/124462
- « Collections PORTES OCÉANES », sur editions-harmattan.fr (consulté le )
Notes et références
- Caroline Graille, Des Militants aux Professionnels de la Culture : les représentations de l’identité kanak en Nouvelle-Calédonie (1975-2015) (Thèse de doctorat en ethnologie), Université Paul-Valéry Montpellier 3, (lire en ligne), p. 144 (note 236)
- « DE LA VENDETTA À LA NOUVELLE-CALÉDONIE - Paul Louis Mariotti, matricule 10318 - Roman historique, Frédéric Angleviel - livre, ebook, epub - idée lecture », sur www.editions-harmattan.fr (consulté le )
- ecrivainducaillou.over-blog.com, « Un livre d'un Calédonien récompensé à Ouessant », sur Le blog de ecrivainducaillou.over-blog.com (consulté le )
- « Auteur Frédéric Angleviel », sur Les Editions de Paris (consulté le )
- https://criminocorpus.hypotheses.org/119590
- « 101 mots pour comprendre le Vanuatu - Alliance Française de Port-Vila », sur www.alliancefr.vu (consulté le )
- « Livres », sur www.editions-harmattan.fr (consulté le )
- « Collections PORTES OCÉANES », sur editions-harmattan.fr (consulté le ).
- https://www.lesindessavantes.com/ouvrages/24238
- « Prix Auguste PAVIE – Académie des sciences dʼoutre-mer » (consulté le )
- NCTV, « Sur les traces du Passé - L'Histoire du village de Thio », sur www.youtube.com (consulté le )
- https://criminocorpus.hypotheses.org/124462
- « France/Nouvelle-Calédonie: après le référendum, quel destin commun? - YouTube », sur www.youtube.com (consulté le )
- « Frédéric Angleviel mis à la retraite d'office de l'UNC après une nouvelle affaire judiciaire », sur Nouvelle-Calédonie la 1ère (consulté le )
- « Journal officiel électronique authentifié n° 0167 du 21/07/2021 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Frédéric Angleviel », sur data.bnf.fr (consulté le )
- Jean Martin, « La France aux antipodes : histoire de la Nouvelle-Calédonie », Bibliothèque de l’Académie des sciences d'outre-mer, (lire en ligne)
- Jean-Pierre Doumenge, « Angleviel Frédéric (2018). Comprendre les referendums de 2018-2022 en Nouvelle-Calédonie, La France ou l’indépendance : décryptages historiques, socio-économiques et communautaristes: Paris, Edilivre, 462 p. », Cahiers d'Outre-Mer, vol. LXX, no 275, , p. 231–238 (ISSN 0373-5834 et 1961-8603, DOI 10.4000/com.8197, lire en ligne, consulté le )
- Mandy Treagus, Andrea Wright, Laura Sedgwick et Max Quanchi, « Reviews », Journal of New Zealand & Pacific Studies, vol. 7, no 1, , p. 95–129 (DOI 10.1386/nzps.7.1.95_5, lire en ligne, consulté le )
- https://www.edilivre.com/?s=angleviel p
- https://pacific-bookin.nc/histoire/1101-histoire-illustree-de-la-nouvelle-caledonie-ecrit-par-frederic-angleviel-editions-footprint-pacifique-beaux-livres-pacific-book-in-librairie-en-ligne-noumea-9782908186567missionnaires-colonisation-societe-kanak-peuplement-chefferie-austronesien-peuple-premier-bataillon-du-pacifique-decolonisation-accords-de-noumea-comite-signataire-enjeux-miniers.html?search_query=angleviel&results=25
- Jean-Marc Regnault, « Angleviel Frédéric, Brève histoire politique de la Nouvelle- Calédonie contemporaine (1945-2005) », Outre-Mers. Revue d'histoire, vol. 94, no 354, , p. 398–400 (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Historiographie de la Nouvelle-Calédonie », sur proquest.com (consulté le ).
- Gérard Cholvy, « Angleviel (Frédéric) : Les Missions à Wallis et Futuna au XIXe siècle. », Outre-Mers. Revue d'histoire, vol. 83, no 310, , p. 159–159 (lire en ligne, consulté le )
- https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses1-2011-4.htm
- Malogne-Fer, Gwendoline, « Frédéric Angleviel, (dir.), Rivalités coloniales et missionnaires e... », Archives de sciences sociales des religions, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, no 152, , p. 9–242 (ISBN 9782713223013, ISSN 0335-5985, DOI 10.4000/assr.22617, lire en ligne, consulté le ).
- (en) « Wallis et Futuna - ouvrage collectif sous la dir. de Atoloto Malau,… », sur nla.gov.au (consulté le ).
- DELISLE Philippe (dossier dirigé par), Histoire et Missions Chrétiennes N-005. Acculturation, syncrétisme, métissage, créolisation (Amérique, Océanie. XVIe-XIXe s.), , 208 p. (ISBN 978-2-8111-4271-1, lire en ligne), p. 197.
- « Une femme du monde à la nouvelle-zélande », sur editions-harmattan.fr (consulté le ).
- « Essai sur la nouvelle-calédonie », sur editions-harmattan.fr (consulté le ).
- Angleviel, Frédéric, « La Nouvelle-Calédonie. Histoire. CM », Outre-Mers. Revue d'histoire, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 80, no 301, , p. 665–666 (lire en ligne, consulté le ).
- https://core.ac.uk/download/pdf/39848539.pdf
- Frdric Angleviel, « Trois millénaires de migrations et de métissages en Nouvelle-Calédonie. Réalité biologique et déficit culturel », International Journal of Francophone Studies, vol. 11, no 4, , p. 523–537 (DOI 10.1386/ijfs.11.4.523_1, lire en ligne, consulté le )
- https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2002-1.htm
- F. Angleviel, « "Take one, take all!": Media coverage of the first Chinese boat people's case in New Caledonia », Asia Pacific Media Educator, vol. 1, no 6, , p. 40–48 (ISSN 1326-365X, lire en ligne, consulté le )
- https://www.persee.fr/docAsPDF/jso_0300-953x_1998_num_106_1_2038.pdf
- Frédéric Angleviel, « Wallis-et-Futuna (1942-1961) ou comment le fait migratoire transforma le protectorat en TOM », Journal de la Société des Océanistes, nos 122-123, , p. 61–76 (ISSN 0300-953x, DOI 10.4000/jso.541, lire en ligne, consulté le )
- Frédéric Angleviel, « Wallis 1825-1858. Contacts, mutations, permanences », Outre-Mers. Revue d'histoire, vol. 76, no 284, , p. 95–110 (DOI 10.3406/outre.1989.2744, lire en ligne, consulté le )
- https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2012-3-page-657.htm
- Frédéric Angleviel, « Environnement et anthropisation dans le Pacifique, dégradations et mutations », Journal de la Société des Océanistes, nos 126-127, , p. 113–126 (ISSN 0300-953x, DOI 10.4000/jso.5332, lire en ligne, consulté le )
- https://www.clio.fr/espace_culturel/frederic_angleviel.asp
- « Frédéric Angleviel - Biographie, publications (livres, articles) », sur www.editions-harmattan.fr (consulté le )