Rivière Niagarette
La rivière Niagarette est un affluent de la Sainte-Anne qui coule dans les municipalités de Saint-Ubalde, Saint-Thuribe et Saint-Casimir, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
| Rivière Niagarette | |
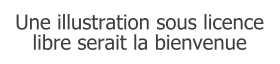
| |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Longueur | 20,3 km [1] |
| Bassin | 54,31 km2 [2] |
| Bassin collecteur | Estuaire fluvial du Saint-Laurent |
| Régime | Nivo-pluvial |
| Cours | |
| Source | Petit lac non identifié |
| · Localisation | Saint-Ubalde |
| · Altitude | 138 m |
| · Coordonnées | 46° 44′ 15″ N, 72° 12′ 48″ O |
| Confluence | Rivière Sainte-Anne |
| · Localisation | Saint-Casimir |
| · Altitude | 30 m |
| · Coordonnées | 46° 39′ 08″ N, 72° 08′ 28″ O |
| Géographie | |
| Principaux affluents | |
| · Rive gauche | Décharge du lac Saint-Léon |
| · Rive droite | (à partir de l'embouchure) Petite rivière Niagarette, rivière du Rang Saint-David |
| Pays traversés | |
| Province | |
| Région administrative | Mauricie |
| Municipalité régionale de comté | Portneuf |
Le premier segment de 5,4 km du cours de la rivière Niagarette est de zone forestière ; le reste de son parcours coule en milieu agricole, tout en passant au sud du village de Saint-Casimir en fin de parcours[3].
La surface de la rivière Niagarette (sauf les zones de rapides) est généralement gelée de début décembre à fin mars, mais la circulation sécuritaire sur la glace se fait généralement de fin décembre à début mars.
Géographie
Le bassin versant de la rivière Niagarette couvre une superficie de 54,31 km2[2].
La rivière Niagarette prend sa source d'un petit lac non identifié (altitude de 138 m), situé en zone forestière dans la partie est de la municipalité de Saint-Ubalde. Ce lac est situé à 4,8 km à l'est du centre du village de Saint-Ubalde et à 10,8 km au nord-ouest de la confluence de la rivière Niagarette et de la rivière Sainte-Anne.
À partir de sa source, le cours de la rivière Niagarette coule sur 20,3 km avec une dénivellation de 108 m. Elle reçoit les eaux de son principal affluent, la Petite rivière Niagarette, à 1,6 km[4] de son embouchure. La pente moyenne de la rivière Niagarette est de 6,6 m/km. Outre les cinq premiers kilomètres à l'amont qui ont une pente de 1,42 %, la pente du reste de la rivière est faible avec 3,8 m/km[1].
À partir de sa source, le cours de la rivière Niagarette coule sur 20,3 km avec une dénivellation de 108 m, selon les segments suivants :
- 1,7 km vers l'ouest ;
- 3,7 km vers l'est jusqu'à la limite de la zone forestière ;
- 4,1 km vers le sud-est jusqu'à la confluence de la rivière du Rang Saint-David (venant de l'ouest) ;
- 3,5 km vers le sud-est en serpentant en zone agricole jusqu'au chemin du 3e rang de Saint-Thuribe ;
- 3,7 km vers le sud-est en serpentant en zone agricole jusqu'au pont du chemin de fer ;
- 2,0 km vers le sud-est en serpentant en zone agricole et en coupant la route 363 jusqu'à la confluence de la Petite rivière Niagarette (venant de l'ouest) ;
- 1,6 km vers l'est en formant quelques boucles en passant au sud du village de Saint-Casimir, jusqu'à son embouchure[5].
Après avoir coupé la route 354 qui longe la rive nord-ouest de la rivière Sainte-Anne, la rivière Niagarette se déverse sur la rive ouest de cette dernière à 0,4 km au sud du pont du village de Saint-Casimir. De là, le courant descend sur 0,9 km vers le sud en suivant le cours de la rivière Sainte-Anne (Mauri, jusqu'à la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent[3].
L'agriculture couvre 60% du bassin de la rivière. Il s'agit du sous-bassin de la rivière Sainte-Anne dont l'utilisation du sol est le plus agricole[1].
Histoire
Deux inondations majeures ont été rapportées dans l'histoire de la rivière Niagarette, soient en 1939 et en 1973[6]. Le , l'érosion des berges de la rivière Niagarette avait endommagée les murets de ciments et l'enrochement des berges près des immeubles au sud du village de Saint-Casimir[7]. La crue subite du 10 août 1973 a endommagé la route 363 et a emporté les résidences des familles de Réjean Lépine et de Rolland Duchesneau, situées près du cours de la rivière ainsi qu'une partie de leur terrain respectif. Les maisons de MM. Victorin Naud et Lévis Tessier ont aussi été endommagées[8].
Le , la Gazette officielle du Québec publiait le décret 1512-86 sur la requête de la municipalité de Saint-Casimir pour la reconstruction d'un barrage pour fins d'aqueduc sur le lit de la rivière Niagarette[9].
En 1998, la municipalité de Saint-Casimir avait un projet de détournement de la rivière Niagarette en lui donnant un parcours plus rectiligne afin de régler ses problèmes d'inondation. La rivière Niagarette comportait alors un méandre de plus de 200 mètres de long, propice à la formation d'embâcles lors de la fonte des neiges[10].
Toponymie
La graphie du toponyme prenait à l'occasion la forme rivière Naigarette remontant à la fin du XIXe siècle et peut-être même auparavant. Ce toponyme pourrait s'expliquer comme étant un diminutif des célèbres chutes Niagara. Le terme iroquois niagara signifie résonner, faire du bruit[11].
Le toponyme rivière Niagarette a été officialisé le à la Banque des noms de lieux de la Commission de toponymie du Québec[6].
Notes et références
- CAPSA 2014, p. 42.
- CAPSA 2014, p. 32.
- Mapcarta - Rivière Niagarette
- « Petite rivière Niagarette », Commission de toponymie du Canada, sur Ressources naturelles Canada (consulté le ).
- Atlas du Canada - Ministère des ressources naturelles du Canada - Rivière Niagarette
- Commission de toponymie du Québec - Rivière Niagarette
- Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) - Érosion à Saint-Casimir - Photo de 1939 au village
- Article "À Saint-Casimir, la solidarité alimente l'espoir", par Roger Noreau, Journal Le Nouvelliste, 14 août 1973, p. 11
- Gazette officielle du Québec - Décret 1512-86 du 8 octobre 1986 - Reconstruction du barrage de la rivière Niagarette
- Articles Inondations - Saint-Casimir veut détourner la Niagarette, par Michel Godin, Journal Le Nouvelliste, 30 mars 1998, p. A5.
- Source: Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme d'un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d'un cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à partir de ce dictionnaire.
Annexes
Articles connexes
Bibliographie
- CAPSA, Plans directeurs de l’eau des secteurs d’intervention de la zone de gestion de la CAPSA: Sainte-Anne, Portneuf et La Chevrotière, Québec, , 691 p. (lire en ligne)
Liens externes
- « CAPSA »
- Ressources relatives à la géographie :