Gasbert de Valle
Gasbert de Valle, de La Val ou de Laval, dit aussi Guasbert Duval, Guisbert de la Vallée[1] ou Gaubert du Val, (né en 1297 dans le Quercy - mort le à Avignon) était un religieux français du Moyen Âge, qui fut évêque ou archevêque de Marseille (1319-1323), d'Arles (1323-1341), puis de Narbonne (1341-1347). À partir de 1316, il exerça diverses fonctions à la Cour pontificale d'Avignon, sous les pontificats de Jean XXII, Benoît XII et Clément VI.
| Gasbert de Valle dit aussi Guasbert Duval | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom de naissance | Gasbert de La Val ou de Laval | |
| Naissance | Quercy |
|
| Ordination sacerdotale | ||
| Décès | Avignon |
|
| Évêque de l'Église catholique | ||
| Dernier titre ou fonction | Camérier sous les pontificats de Jean XXII, Benoît XII et Clément VI | |
| Archevêque de Narbonne | ||
| – | ||
| Archevêque d'Arles | ||
| – | ||
| Évêque de Marseille | ||
| – | ||
| Autres fonctions | ||
| Fonction religieuse | ||
| Curé de l'église paroissiale de Bovenac au diocèse de Narbonne Chanoine de la cathédrale de Meaux Archidiacre de Cahors Administrateur de l'église d'Avignon |
||
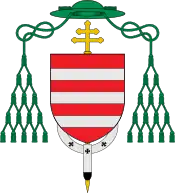 | ||
| .html (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||
Biographie
Origines et premières années
Avant l'élévation de Jean XXII à la papauté le , Gasbert faisait partie de sa maison. Deux jours après son couronnement, le pape lui conféra à la fois l'église paroissiale de Bovenac au diocèse de Narbonne et un canonicat de la cathédrale de Meaux, en attestant sa qualité de familier (« familiari nostro »). Il lui donna ensuite l'archidiaconé de Cahors.
Le prélat à Avignon
Dès 1316, Jean XXII en fit son trésorier, fonction que Gasbert partagea collégialement avec Adhémar Amiel[2].
Le , à partir de la mort suspecte (attentat qui aurait en fait visé le pape) du cardinal Jacques de Via, il eut l'administration de l'église d'Avignon que le pape retenait à sa main, sans y nommer de titulaire, avec le titre et les pouvoirs de vicaire-général de l'évêché. En réalité, il n'y eut point d'autre évêque d'Avignon que lui pendant les dix-huit ans du règne de Jean XXII.
Évêque de Marseille
Il fut nommé évêque de Marseille le et quelques jours plus tard, le , devint camérier du pape, charge qu'il conserva sous les papes Jean XXII, Benoît XII et Clément VI et ce jusqu'à sa mort, soit pendant plus de 27 ans (du au )[3]. Comme tous les camériers de cette époque, il était un proche du pape, mais fut le seul, avec Étienne Cambarou, a en avoir les compétences techniques par sa fonction précédente de trésorier[4].
En réalité, le nouveau prélat demeura bien plus à Avignon et gouverna son diocèse par des grands vicaires. Il s'entoura de familiers ; on connait un notaire du pape, Raymond de Laval, qui fut probablement son frère et un neveu, secrétaire de la Chancellerie papale. Plus tard, en 1348, un de ses cousins fit valoir cette relation pour obtenir un poste de scribe[5].
Archevêque d'Arles
Le , il est nommé archevêque d'Arles[6].
Il reçoit le pallium le 8 septembre et fait hommage entre les mains du roi Charles IV le Bel le . Il a alors plus de facilité pour gouverner son diocèse, tout en continuant à demeurer à Avignon et à y exercer les mêmes fonctions. En 1326[7] et 1337, il préside le concile d'Avignon. (Saint Ruf, près d'Avignon)
Archevêque de Narbonne
Le , il est nommé archevêque de Narbonne sous le règne du pape Benoît XII.
Le , il reçoit le serment de fidélité du jeune vicomte de Narbonne Aymeri VI, pour la moitié occidentale de la cité narbonnaise, tenue en fief des archevêques[8].
Le , il achète une maison à Toulouse, près de la faculté de droit, pour y fonder un collège afin de recevoir des écoliers de son ordre qui iraient étudier dans cette ville. Le , il fonde le collège de Narbonne, en l'honneur de la Sainte-Vierge Marie, des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul et de Saint-Trophime, patron de l'église d'Arles. Il ordonne que douze écoliers étudiant à l'université de Toulouse y seraient nourris et entretenus.
On rapporte également une étrange histoire à son sujet qui éclaire les mœurs de la curie de l'époque. Il est dit en effet que « pour racheter les péchés de la chair[9] perpétrés (sic) à la curie », Gasbert de Laval consacra en 1343 une partie de sa fortune à installer dans une maison neuve l'œuvre des Repenties qui accueillait les courtisanes et prostituées désireuses de se repentir[10].
Il meurt le à Avignon. Il avait fait construire un mausolée dans l'Église Saint-Trophime d'Arles mais fut enterré à Narbonne[11].
Armoiries
Ses armes sont de gueules à trois fasces d'argent[12].
Notes et références
- Abbé Nadal, Essai historique sur les Adhémar et madame de Sévigné, Valence 1858, page 45
- Bernard Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 1309-1376, Éditions E. de Boccard, Paris, 1966, p. 281.
- Bernard Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 1309-1376, Éditions E. de Boccard, Paris, 1966, p. 278.
- Bernard Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 1309-1376, Éditions E. de Boccard, Paris, 1966, p. 279.
- Bernard Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 1309-1376, Éditions E. de Boccard, Paris, 1966, p. 482.
- Émile Fassin, Bulletin archéologique d’Arles, 1889, no 7, p. 107-110, Le 8 juillet 1323, le chapitre métropolitain nomme à l'archevêché d'Arles l’évêque de Marseille, Guasbert de Laval.
- Paul Guérin, Les Conciles généraux et particuliers, Palmé, , III + 646 (lire en ligne), p. 636-639
- Marie-Laure Jalabert, « Chapitre I - Gloire et crises de l’archevêché de Narbonne jusqu’au xive siècle », dans Le Livre Vert de Pierre de la Jugie : Une image de la fortune des archevêques de Narbonne au XIVe siècle. Étude d’une seigneurie [en ligne], Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2009 (page consultée le 15 juillet 2015)
- Les maisons de jeux et la prostitution étaient en effet présentes à Avignon
- Bernard Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 1309-1376, Éditions E. de Boccard, Paris, 1966, p. 486.
- Congrès Archéologique de France - 134e session 1976 - Pays d'Arles, page 364 qui fait référence à J.-M. Trichaud.
- Abbé Joseph Hyacinthe Albanés, Armorial & sigillographie des Évêques de Marseille avec des notices historiques sur chacun de ces Prélats, Marius Olive, Marseille, 1884, p. 66.
Voir aussi
Bibliographie et Sources
- Guillaume Lafon, Histoire des archevêques de Narbonne (manuscrit du XVIIIe siècle)
- Abbé J-H Albanes, Armorial et Sigillographie des Évêques de Marseille, Marseille 1884, pp. 65-66
- Edmond Albe, Prélats originaires du Quercy, dans Annales de Saint Louis des Français, 1905
- Bernard Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 1309-1376 — Étude d'une société, 807 p., Éditions De Boccard, 1966