Charles-Théodore de Dalberg
Charles-Théodore de Dalberg, né à Mannheim (Palatinat du Rhin) le et mort à Ratisbonne (Royaume de Bavière) le , est prince primat de l'Église catholique romaine d'Allemagne.
| Charles-Théodore de Dalberg | ||||||||
 Le prince-archevêque de Dalberg | ||||||||
| Biographie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Mannheim (Palatinat du Rhin) |
|||||||
| Ordination sacerdotale | ||||||||
| Décès | 10 février 1817, Ratisbonne (Royaume de Bavière) |
|||||||
| Évêque de l'Église catholique | ||||||||
| Ordination épiscopale | ||||||||
| Ratisbonne | ||||||||
| – | ||||||||
| ||||||||
| Mayence et Worms | ||||||||
| – | ||||||||
| Constance | ||||||||
| – | ||||||||
| ||||||||
| Tarse (de) en Cilicie | ||||||||
| – | ||||||||
| Autres fonctions | ||||||||
| Fonction religieuse | ||||||||
| Primat d'Allemagne | ||||||||
| Fonction laïque | ||||||||
| Grand duc de Francfort (1810-1813) | ||||||||
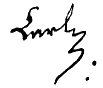 | ||||||||
| .html (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||||||||
Biographie
Issu d’une des plus anciennes familles nobles d’Europe (voir : Dalberg) dont les membres remplissent pendant plusieurs siècles les fonctions de trésorier du chapitre de Worms, il opte pourtant de lui-même pour une carrière ecclésiastique. Très doué pour l'étude, il reçoit dans les écoles catholiques une instruction très variée. Tout jeune encore, il part étudier le droit à Heidelberg (1761), puis à Mayence. À la fin de l'année 1762, il se lance dans un Grand Tour en Italie et en France, qui dure deux ans : à Rome il fait la connaissance de l'archéologue Johann Joachim Winckelmann et à Pavie, il consolide ses études juridiques. Au début de 1765, il se met au service de l’Électorat de Mayence, où son talent d'administrateur paraît bientôt : élu dès 1754 chanoine domicellaire de Mayence, il devient en outre en 1779 chanoine de Wurtzbourg, puis enfin en 1786 chanoine en titre de la cathédrale de Mayence. Il détient d'autres bénéfices à Worms et Constance. Le prince archevêque de Mayence le nomme en 1771 gouverneur civil d’Erfurt (1771–1802), qui lui donne l'administration des fiefs de Thuringe de l’Électorat. En 1780, il devient avoué de l'abbaye de Wechterswinkel, recteur de l’Université de Wurtzbourg puis finalement en 1797 vidame de Wurtzbourg.
Ces années 1770-1780 à Erfurt sont les plus heureuses pour le chanoine Dalberg, marquées par la fréquentation assidue du Salon de Weimar, la réorganisation de l’Université d'Erfurt, la mise en place d'une éducation populaire et d'institutions de charité publiques dans l’esprit des Lumières. Mais de toutes les réformes, celles de l'éducation religieuse, de la formation des prêtres, de la liturgie et de la catéchèse sont celles qui lui tiennent le plus à cœur. Il est membre des Illuminati sous le pseudonyme de Bacon de Verulam et avait même rang de préfet des Illuminati d’Erfurt[1]. Il est d’ailleurs cité par Friedrich Nicolai en tant que membre des Illuminés de Bavière[2]. Contrairement à ce que l'on peut lire sous la plume de certains historiens, Dalberg n'est pas franc-maçon, même s'il partage en partie les convictions de cette obédience et les trouvent conformes à la doctrine chrétienne ; on lui attribue à ce propos le mot d'esprit suivant : « Un chrétien qui se fait franc-maçon est comme un chevalier qui chercherait son cheval alors qu'il est déjà assis dessus[3] ».
Le , il est nommé à l'instigation de la diplomatie prussienne coadjuteur de l’archevêque de Mayence. Le suivant, il est élu coadjuteur de l'évêque de Worms et un an plus tard, jour pour jour (le ) coadjuteur de l'évêque de Constance. Le , Dalberg se fait ordonner prêtre à Bamberg puis, le pape l'ayant fait évêque titulaire de Tarse en Cilicie (), il est consacré à Aschaffenbourg le .
D'évêque de Constance, il devient en 1802 archevêque et prince-électeur de Mayence[4] (à ce titre, il est également archichancelier du Saint-Empire romain germanique), évêque de Ratisbonne, où il fait aménager la Arnulfsplatz.
Il préside les dernières diètes de l'Allemagne, et tente d'abord de s'opposer aux projets de Napoléon Ier; mais, voyant que toute résistance est inutile, il se rallie à la France. Il est élu associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1804. Il est nommé président de la Confédération du Rhin, grand-duc de Francfort, et désigne Eugène de Beauharnais pour son successeur.
Resté fidèle à Napoléon dans ses revers, il est dépouillé par les alliés d'une partie de ses États, ne conservant que l'évêché de Ratisbonne.
Aussi bon écrivain que savant éclairé, il laisse plusieurs ouvrages, dont le principal, Méditation sur l'univers, connait jusqu'à dix éditions.
Dalberg est le mécène du célèbre peintre français Joseph Chabord. Pour lui rendre hommage, l'artiste s'est peint à côté du buste de Dalberg sur son autoportrait.
Bibliographie
- L'élection du coajuteur de Mayence en 1787. dans: Le Rhin Illustré, année 1919/20, Nr. 51 de 24.
- Karl von Beaulieu-Marconnay (de): Karl von Dalberg und seine Zeit. Zur Biographie und Charakteristik des Fürsten Primas. Zwei Bände, Weimar 1879.
- Günter Christ: Theorie und Praxis in der Bildungspolitik Karl Theodors von Dalberg. In: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte (de) 50 (1998), S. 317–335.
- Karl Hausberger (de) (Hrsg.): Carl von Dalberg. Der letzte geistliche Reichsfürst. Schriftenreihe der Universität Regensburg 22, Regensburg 1995, (ISBN 978-3-930480-40-1).
- Herbert Hömig (de): Carl Theodor von Dalberg. Staatsmann und Kirchenfürst im Schatten Napoleons. Schöningh, Paderborn 2011, (ISBN 978-3-506-77240-4).
- Michael Ludscheidt: Aufklärung in der Dalbergzeit. Literatur, Medien und Diskurse in Erfurt im späten 18. Jahrhundert (Schriften der Bibliothek des Evangelischen Ministeriums (de) Erfurt, Bd. 1), Erfurt 2006.
- Georg Schwaiger (de): Carl Theodor von Dalberg. Erzbischof von Regensburg (1805–1817). In: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg. 23/24 (1989) 489–494.
- Martin A. Völker (de): Raumphantasien, narrative Ganzheit und Identität. Eine Rekonstruktion des Ästhetischen aus dem Werk und Wirken der Freiherren von Dalberg, Aufklärung und Moderne, Bd. 5. Hannover-Laatzen: Wehrhahn Verlag, 2006. (ISBN 978-3-86525-205-0)
- (de) Karl Georg Bockenheimer (de), « Dalberg, Carl Theodor Freiherr von », dans Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), vol. 4, Leipzig, Duncker & Humblot, , p. 703-708
- (de) Ludwig Lenhart (de), « Dalberg, Carl Theodor », dans Neue Deutsche Biographie (NDB), vol. 3, Berlin, Duncker & Humblot, , p. 489–490 (original numérisé).
- Friedrich Wilhelm Bautz, « Dalberg, Carl Theodor », dans Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), vol. 1, Hamm, (ISBN 3-88309-013-1, lire en ligne), col. 1195-1197
Notes et références
- D'après (de) Hermann Schüttler: Die Mitglieder des Illuminatenordens
- Lettre à Niels Höpfner sur les Illuminés (1794)
- Texte original : Wer als Christ Freimaurer werden wolle, gleiche einem Reiter, der sein Pferd sucht, obgleich er schon auf ihm sitzt
- Les princes-évêques de Mayence étaient, comme la plupart des évêques allemands, à la fois seigneurs spirituels de leur diocèse et seigneurs temporels d'une série de possessions territoriales.
Sources
- Cet article comprend des extraits du Dictionnaire Bouillet. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées, s'il satisfait aux exigences linguistiques actuelles et s'il ne contient pas de propos qui vont à l'encontre des règles de neutralité de Wikipédia.
Liens externes
- Ressources relatives aux beaux-arts :
- Royal Academy of Arts
- (de) Académie des arts de Berlin
- (en) Bénézit
- (en) British Museum
- (en + sv) Nationalmuseum
- (en) Union List of Artist Names
- Ressources relatives à la musique :
- Ressource relative à la recherche :
- Ressource relative à la religion :
- (en) Catholic Hierarchy
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :