Marie Crous
Marie Crous (c. 1620-fl. 1641[1]) est une mathématicienne française du XVIIe siècle.
| Naissance |
Après |
|---|---|
| Activité | |
| Période d'activité |
XVIIe siècle |
Biographie

D'origine modeste, soutenue par son père, Marie Crous est la maîtresse d'écriture et la préceptrice de Charlotte de Caumont La Force[2].
Elle publie, en 1636[3] (le privilège à la fin du livre est du [4]), puis en 1641, une étude sur le système décimal qu'elle dédie à « la princesse au teint de safran », Madame de Combalet, duchesse d'Aiguillon, nièce du Cardinal de Richelieu, mécène reconnue et amie de Marin Mersenne.
Pour autant, Marie Crous ne semble pas connue des membres de l'académie du père Mersenne et n'est pas dans la liste des femmes savantes célèbres de cette époque[5].
Contribution
Une arithmétique innovante
Son ouvrage va bien au-delà de ce qu'on trouve dans les manuels élémentaires d'initiation aux calculs. Il inclut en effet une présentation des fractions décimales, décalquée de la Disme de Simon Stevin : « il ne se trouvera aucun livre premier que celuy-cy où cette invention soit enseignée, estant toute deue aux veilles de votre tres humble servante. » Elle introduit dans cet ouvrage un changement important par rapport à Stevin : le point (aujourd'hui la virgule en France) pour séparer la mantisse de la partie décimale. Ce faisant, elle adopte la forme actuelle des nombres décimaux. Elle appelle les zéros des « nuls », à la manière allemande.
Maîtresse d'écriture et de calcul, elle développe par ailleurs la méthode connue ultérieurement sous le nom de Pestalozzi, et ce qu'elle nomme la division de dénomination[6], très utile pour les calculs mentaux, notamment dans son application à la règle de trois.
Un esprit indépendant
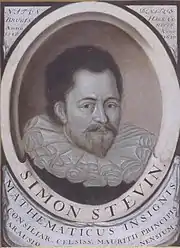
L'ouvrage (une première version date de 1635-1636) commence par une épître à sa noble protectrice. Elle la remercie en ces termes : « Vous savez, à l’imitation de ce grand Dieu, relever les simples à bas (de quoi je suis du nombre, je le confesse ingenument). » Pour autant, elle ne lui attribue pas le mérite de ses inventions[7]. Dans la préface de son Abrégé recherche, Marie Crous assure qu'elle fait ce livre pour « soulager celles des filles qui s'exercent en cette science tant pour la nécessité de leurs affaires que pour le contentement de leur esprit ». Le « contentement de l'esprit » semble donc être sur le même pied que l'utilité pratique.
Une visionnaire
Dans sa préface à Charlotte de Caumont, elle écrit : « Il me semble que c'est aux souverains de changer la division de leurs monnaies, poids et mesures, car pour l'ausneur et le toiseur, avoir marqué leurs mesures en dixième sur le côté où les marques du souverain ne sont… »
Dans son « Advis », Marie Crous propose donc l'adoption d'un système métrique[8] décimal, qui ne sera mis en place en France et ailleurs que beaucoup plus tard.
Œuvres
- Abbrégée recherche de Marie Crous. Pour tirer la solution de toutes propositions d'arithmétique, dependantes des regles y contenues. Avec quelques propositions sur les changes, esconptes, interests, compagnies, associations, payemens, departemens des deniers, meslanges, bureau des monnaies et thoisages, divisé en trois parties. Ensemble[9] un advis aux filles exersantes l'arithmétique sur les dixmes ou dixiesmes du sieur Stevin, Paris, Jacques Auvray, 1641. — Le second ouvrage avait déjà paru séparément :
- Advis de Marie Crous aux filles exerçantes l'arithmétique sur les dixmes ou dixiesmes du sieur Stevin…, Paris, 1636.« Marie Crous ne fait pas usage des signes adoptés par Stevin, l'inventeur de la numération décimale écrite. Elle sépare, dit M. Regnard, la partie décimale des entiers par un point, et remplace par des zéros les unités décimales manquantes : changement fondamental, qui a donné à la numération décimale sa véritable forme. » — Pierre Larousse
- Advis de Marie Crous aux filles exerçantes l'arithmétique sur les dixmes ou dixiesmes du sieur Stevin…, Paris, 1636.
Bibliographie
- Olry Terquem, « Notice bibliographique sur le calcul décimal », p. 200. Aussi dans : Nouvelles annales de mathématiques, vol. 14, p. 200, 1852. — L'article porte sur Stevin et sur Marie Crous ; la section sur Crous commence à la page 200.On trouve chez Terquem un résumé de l'ouvrage de Crous.
- Pierre Larousse, « Crous (Marie) », dans Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, vol. 5, 1868, p. 595.
- Georges Maupin, Opinions et curiosités touchant la mathématique (deuxième série) d'après les ouvrages français des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Naud, 1898, p. 230–243.
- (de) Catherine Goldstein, « Weder öffentlich noch privat : Mathematik im Frankreich des frühen 17. Jahrhunderts », dans Beiträge zum Wandel der Geschlechterbeziehungen in der Wissenschaft vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bielefeld, Theresa Wobbe, , p. 41-72.
- (en) « Neither public nor private : mathematics in early modern France » — Traduction
Annexes
Postérité
Marie Crous demeure une inconnue. Le mathématicien Olry Terquem regrettait qu'on n'ait pas donné son nom à une rue de Paris. Plus récemment, Catherine Goldstein lui a consacré une partie d'un article[5].
Notes et références
- Jean Pierre Poirier, Histoire des femmes de science en France: du Moyen-Âge à la Révolution, 1997, p.380.
- Luc Capdevila, Le genre face aux mutations : masculin et féminin, du Moyen Âge à nos jours, Presses universitaires de Rennes, 2003, p.132.
- Larousse 1868
- Terquem, p. 203
- Goldstein 2003
- Pour une explication, voir Terquem.
- Goldstein 2003 fait remonter cette habitude à François Viète dans la préface de son Isagoge à Catherine de Parthenay.
- Jean-Pierre Poirier, Histoire des femmes de science en France : du Moyen Age à la Révolution, Pygmalion—Gérard Watelet, 2002, p. 380.
- On dirait aujourd'hui : « De plus », « Dans la même publication ».
Liens externes
- Nathaniel Herzberg, « Marie Crous : son précis de maths de 1636 accessible à la bibliothèque Mazarine », sur Le Monde, (consulté le )