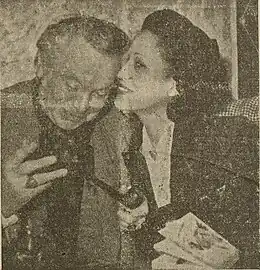Mayotte Capécia
Mayotte Capécia, pseudonyme de Lucette Ceranus-Combette, (1916-1945) naît en Martinique dans la ville de Carbet. Elle est romancière et reçoit le prix France-Antilles en 1949.
Biographie
Mayotte Capécia naît avec sa sœur jumelle en 1916, d'une mère célibataire. Sans éducation, dès l’âge de quatorze ans, elle commence à travailler et devient mère à dix-sept ans[1]. Elle apprend à écrire grâce à Frantz Fanon, Etiemble et quelques admirateurs parisiens et elle n'est reconnue dans le monde des lettres qu’en 1993[1]. Ses deux romans en partie inspirées du journal du lieutenant de marine qu'elle fréquente sont des créations collectives avec d'autres auteurs anonymes [2].
Mayotte Capécia divise le monde des lettres. Selon Myriam Cottias et Madeleine Dobie, pour certains intellectuels, elle est la «première femme de couleur à raconter sa vie » et « exprime la vision authentique d'une femme antillaise »[3]. Tandis que, pour d'autres « elle démentait l’effervescence politique de l’ère de la négritude, de la départementalisation et de la décolonisation, promouvant une vision nostalgique des Antilles et de l’Empire français »[3].
Christiane Makward dans Mayotte Capécia ou L'aliénation selon Fanon estime qu'elle est victime d'une « exécution sommaire » de la part de Frantz Fanon et s'attache à révéler les exceptionnelles qualités de femme de Mayotte Capécia[4]. Selon Albert James Arnold, Frantz Fanon reproche à Capécia « d’avoir proclamé dans Je suis Martiniquaise sa haine de l’homme noir auquel elle préférait « un blond avec des yeux bleus, un Français » »[5] - [6]. Arnold écrit, lui, que Je suis une Martiniquaise est le résultat d’une supercherie montée par l’éditeur parisien Corrêa (Edmond Buchet)[5].
Œuvres
- Je suis Martiniquaise, Paris, Éd. Corrêa, (OCLC 252229752, lire en ligne).
- La Négresse blanche, Corrêa ; (Impr. de Chassaing), , 190 p. (OCLC 459069443, lire en ligne).
Prix
- 1949, Prix France-Antilles, pour Je suis martiniquaise.
Bibliographie
- Myriam Cottias et Madeleine Dobie, Relire Mayotte Capécia : une femme des Antilles dans l'espace colonial français, Colin, (ISBN 978-2-200-27712-3 et 2-200-27712-1, OCLC 823521457, lire en ligne)
- Myriam Cottias et Madeleine Dobie, « Joséphine Baker et Mayotte Capécia : race et genre dans deux biographies transcoloniales », dans Le postcolonial comparé, Presses universitaires de Vincennes, (ISBN 978-2-84292-407-2, DOI 10.3917/puv.joub.2014.01.0243, lire en ligne), p. 243
- Albert James Arnold, « « Mayotte Capécia » : De la parabole biblique à Je suis Martiniquaise », Revue de littérature comparée, vol. 305, no 1, , p. 35 (ISSN 0035-1466 et 1965-0264, DOI 10.3917/rlc.305.0035, lire en ligne, consulté le )
- Albert James Arnold, « Frantz Fanon, Lafcadio Hearn et la supercherie de « Mayotte Capécia » », Revue de littérature comparée, vol. 302, no 2, , p. 148 (ISSN 0035-1466 et 1965-0264, DOI 10.3917/rlc.302.0148, lire en ligne, consulté le )
Références
- « Mayotte Capécia », sur Île en île, (consulté le )
- « Mayotte Capécia : Martinique A nu », sur martiniqueannu.com (consulté le )
- Myriam Cottias et Madeleine Dobie, Relire Mayotte Capécia - Une femme des Antilles dans l'espace colonial français (1916-1955), Armand Colin, , 272 p. (EAN 9782200277123, lire en ligne)
- Christiane Makward, Mayotte Capécia ou L'aliénation selon Fanon, Karthala, , 230 p. (ISBN 2-86537-860-8, lire en ligne)
- Albert James Arnold, « Frantz Fanon, Lafcadio Hearn et la supercherie de « Mayotte Capécia » », Revue de Littérature comparée, vol. 2, no 302, , p. 148-166 (DOI 10.3917/rlc.302.0148, lire en ligne)
- « Symbole de la Noire aliénée pour Frantz FANON, Mayotte CAPECIA n’était pas celle qu’il croyait », sur Montray Kréyol, (consulté le )
- Ressource relative à l'audiovisuel :